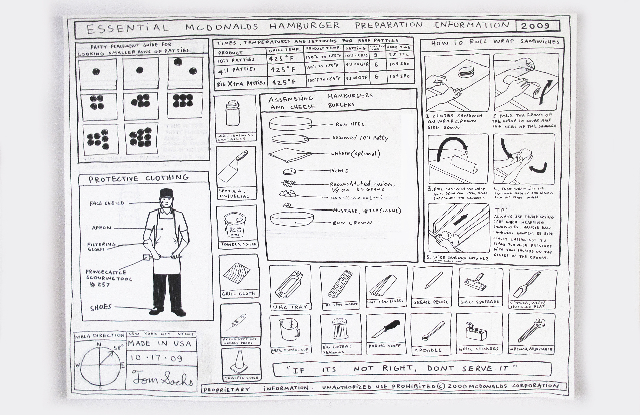Avez-vous déjà été happé par l’image fugace d’un être qui, au moment même où vous pensiez l’avoir saisi, se dérobait ? Un « être de fuite », pour reprendre les mots de Proust. La fuite comme fantasme, comme promesse poétique, et l’être comme objet étonnamment évanescent, aimé parce qu’insaisissable. La femme en fuite, surtout, topos éternellement renouvelé et image chérie des auteurs masculins ; celle d’une chevelure ou d’une robe qui s’éloigne au gré du vent, celle d’un éclat de liberté, quelque chose comme une irruption de grâce dans un réel trop statique…
Mais ne faut-il pas remettre en perspective cette mythologie, aussi belle soit-elle, et aller voir ces femmes ? D’où fuient-elles ? Quelle littérature, quel avenir pour elles ?
Deux lectures : La Vagabonde de Colette, et Monique s’évade d’Édouard Louis. Deux lectures dont je tire une première chose : de la même façon que la femme n’existe pas, la femme en fuite n’est pas. Il y a desfemmes, des femmes en fuite.
Une fuite toujours recommencée
Avec son roman La Vagabonde, publié en 1910, Colette nous livre l’histoire de l’une d’entre elles. Après avoir quitté son mari, un pastelliste mondain qui la trompait et la battait, Renée Néré, double romanesque de Colette, devient mime et danseuse de music-hall.
La Vagabonde est bien l’histoire d’une fuite. Une fuite douloureuse, éternellement recommencée, portée par le flot d’une prose elle-même vagabonde. Une fois ma lecture terminée, j’aurais aimé pouvoir affirmer que ce livre était daté et déclarer avec aplomb que la violence – symbolique comme réelle – à laquelle était exposée Renée n’avait plus rien à voir avec ce que je pouvais observer aujourd’hui au travers de mes lunettes de jeune femme. Comme j’aurais aimé pouvoir railler ses tiraillements ! Sauf que chaque page, en plus d’être d’une grande force littéraire, m’a semblé d’une vertigineuse justesse.
C’est que Renée, même après avoir rencontré son nouvel « amoureux », Maxime, nous dit que celle qui aime les hommes mais qui refuse de se laisser prendre au piège du couple – « Tu serais prise ! », lui dit Max, amoureusement, en évoquant son désir personnel d’enfant – est condamnée à une fuite sans fin. Comme s’il fallait, pour refuser la soumission, devenir une solitaire apatride : plus d’identité sans allégeance au règne masculin. Comment, alors, ne pas penser à une sorte de malédiction, toute féminine, qui nous condamnerait à amputer l’unité de notre désir ? Être amoureuse d’un homme ET libre, quelle idée ! On pourrait gentiment nous répondre, à Colette et à moi, que tout ceci est trop simple et qu’il ne faut pas exagérer : l’opposition renvoyant amour et liberté dos à dos n’est pas nouvelle, et encore moins genrée… Et l’on aurait certainement raison de nous le rappeler. Sauf qu’une question subsisterait, malgré tout : au fond, le sacrifice amoureux coûte-t-il vraiment autant aux hommes qu’aux femmes ? J’entends déjà des voix s’élever, qui me sermonnent : de nos jours, couple hétérosexuel ne rime plus avec asservissement, voyons ! Je leur réponds : certes, mais si vous le voulez bien, adressons tout de même une petite pensée à Monique qui, comme des milliers de femmes, s’évade encore… en 2024.
Monique s’évade, c’est le titre du roman d’Édouard Louis paru ce printemps, dans lequel il parle de l’évasion de sa mère. Comme Renée, elle a fui un homme violent. Lui aussi l’humiliait, lui aussi souhaitait l’enfermer. Même schéma, donc, à cent quatorze ans d’écart, après Veil, après Badinter, après Despentes, après au moins quatre vagues féministes.
Dire la fuite et ses horizons
Même schéma, mais à une exception près : contrairement au roman d’Édouard Louis, récit d’une fuite littérale, celui de Colette dit surtout une fuite poétique et introspective. La séparation de Renée a déjà eu lieu quand le livre commence. Malgré la condition – féminine – qu’elles partagent, Monique et Renée n’effectuent pas le même périple. Et elles ne trouveront pas non plus les mêmes horizons.
Pour Renée, la question clé semble être la suivante : où fuir si le seul horizon possible est celui d’une errance solitaire ? Dans la troisième partie du livre, celle qui se définit comme « une femme de lettres qui a mal tourné » part en tournée à travers la France, sans Maxime qu’elle décidera finalement de quitter. Face aux paysages chatoyants du Midi, elle dit alors la liberté d’une femme qui, soudain, retrouve sa voix, une voix longtemps étouffée, annihilée par un ex-mari au verbe hégémonique, une voix qui soudain fuse pour dire l’urgence de la fuite. En la lisant, j’ai compris ceci : seuls les mots peuvent donner sens à l’errance, eux seuls peuvent embrasser l’absence et le manque. Et c’est de là que renaît le désir. Colette m’a murmuré à l’oreille : l’unique moyen d’habiter le monde quand on veut nous en exclure, c’est de posséder une voix, une voix refuge pour dire la fuite toujours recommencée. Comme Renée, nous avons besoin de ces mots vagabonds qui, dans le sillage même du désir, jaillissent de la métaphore pour assumer, fougueux et même téméraires, l’impossibilité d’une destination finale. Et c’est là le seul horizon possible. Car c’est bien l’élan du verbe qui métamorphose la fuite en désir. Oui, ce sont ces mots retrouvés qui sauvent Renée – ou Colette, ou toutes les vagabondes qui la lisent – et qui embrassent la promesse du monde.
Dé-sir. La première syllabe dit l’absence. La seconde signifie : sidéral. Désirer, c’est regretter les astres et c’est s’élancer, toujours, pour les retrouver. L’élan, Renée l’a retrouvé dans les bras d’un homme. Mais les astres, seuls ses mots désormais peuvent aller les frôler, pour un jour, peut-être, venir les cueillir.
Mais si Monique nous lisait, elle nous répondrait certainement par une question, moins poétique que vitale : où fuir quand on ne possède rien, pas même les mots ?
Car Monique est une femme pauvre. Et là où la fuite de Renée a une forte portée symbolique, la sienne est parfaitement pratique, résolument concrète. En effet, après avoir chassé de sa vie un premier homme, le père de ses enfants, Monique ne s’est pas réfugiée dans la littérature pour retrouver sa voix, sa liberté, son désir ou même la promesse du monde – rappelons que si Renée a eu le loisir de le faire, c’est parce qu’elle a hérité d’une rente, en plus de son salaire. Alors non, les jolis mots, la poésie et sa liberté, Monique ne les a pas trouvés. Elle ne les a même pas cherchés. Comment aurait-elle pu ne serait-ce qu’y penser, sans diplôme, sans salaire, sans rien ?
« Rien » – définition par Édouard Louis : « Rien au sens de rien, de l’absence totale, du néant, ce rien que dans les classes privilégiées on ne peut pas comprendre, parce que quand eux disent qu’il ne leur reste plus rien, il leur reste toujours quelque chose,
il leur reste des diplômes,
il leur reste la culture,
il leur reste quelques pièces,
il leur reste des relations pour les aider,
il leur reste la volonté que confèrent les privilèges. »
Bref, Monique ne possédait rien au sens de rien. Jusqu’au jour où, par chance (?), elle a rencontré un nouvel homme, avec qui elle a emménagé. Sauf qu’après quelques années, il a fallu fuir de nouveau. Foutue malédiction. Et c’est ce moment qu’Édouard Louis raconte. Dans une langue simple, sincère. Une langue qui parvient à dire sans écraser. Une sincérité du dire et une intelligence d’équilibriste, celle d’un fils qui a grandi dans une famille pauvre du nord de la France et qui essaie de dire avec des mots-frontières, appris à l’université, auprès de la bourgeoisie, l’histoire d’une femme qui l’a élevé et qui n’a jamais pu faire entendre sa voix. Ce livre est un porte-voix – ou peut-être plutôt un prête-voix – tendu à Monique, un prête-voix perçant la foule des autres ouvrages qui s’amoncellent en librairie, pour crier, comme un manifestant révolté : « Monique s’évade ! »
Car il y a urgence. Urgence politique. Sans le soutien financier de son fils, jamais Monique n’aurait pu partir. Que deviennent toutes celles qui n’ont pas pu fuir, quels destins pour ces milliers de Moniques oubliées ? (« Oubliées », le mot est-il juste ? Pour être oubliée, ne faut-il pas un jour avoir été (re)connue ?) Je me souviens d’amis qui m’ont demandé, alors que je venais de le terminer, ce que j’avais pensé de ce roman. Et je me rappelle avoir peiné à formuler un avis clair, avec des mots. Car ce qui tapait contre mes lèvres encore closes, ce qui pressait au seuil de ma parole, c’étaient des chiffres. Une foule de chiffres :
200 euros pour l’évasion (taxi pour fuir, premières courses),
1100 euros de caution pour le nouveau logement,
300 euros pour la gazinière,
500 euros pour le réfrigérateur.
Dans Monique s’évade, il est question du coût de la fuite. Et cette fuite est existentielle. Édouard Louis, plein de bon sens, nous rappelle ceci : avant d’être philosophico-poétique, l’existentiel est prosaïque et il est fondamentalement politique. Sans argent, sans aide, pas de fuite, pas d’horizon. Encore moins de Littérature (celle qui arbore, suffisante, un grand L dans les salons).
Et pourtant, pour que cette fuite systémique existe à nos yeux, il faut bien la dire ! De là l’idée originelle et provocatrice de faire de Monique s’évade une immense liste de tout ce qu’aurait coûté son évasion, soit l’exact opposé « de ce que prétend souvent être une œuvre littéraire : un acte noble, pur et désintéressé. » Édouard Louis aurait alors adressé une sorte de pied de nez à la Littérature, en disant ce que cette dernière se plaît à mépriser : le trivial, le concret, le vulgaire, l’antiromanesque, l’antipoétique, le chiffre à la place de la lettre. Plus que cela, son geste aurait été radicalement politique : il aurait dégagé un coût moyen de la fuite qui aurait un jour peut-être – qui sait ? – été réutilisé dans une perspective d’aide sociale à ces femmes abandonnées. Sauf que ce choix n’était pas suffisamment esthétique (trop novateur, peut-être), et c’est un roman autobiographique, certes ponctué de chiffres et de réflexions politiques, mais un roman tout de même, qui l’a remplacé. Pied de nez, oui, mais encore timide.
« Est-ce que la littérature peut tout dire ?
Si oui, alors j’ai échoué.
Si non, alors la littérature ne suffit pas. »
Peut-être que la littérature ne suffit pas, ou ne suffit plus. Peut-être aussi qu’elle ne suffit pas encore, mais qu’elle suffira demain. En attendant, je me représente l’œuvre d’Édouard Louis comme un pont, un pont permettant à chacun des passants qui l’empruntent de se diriger vers un horizon nouveau, métalittéraire – ici, celui, politique et social, de la fuite des femmes, dont Monique est devenue le symbole.
Voici pour finir quelques-uns des mots de son fils, entendus à la fin d’une émission littéraire : « Utilisez la lecture comme le point de départ de vos colères et d’un monde nouveau. Il n’y a pas de plus bel hommage qu’on puisse rendre à la littérature que celui-ci : la faire résonner au-delà d’elle-même. Partout, dans les rues, dans nos voix, dans nos têtes, dans nos corps et dans nos cris. »