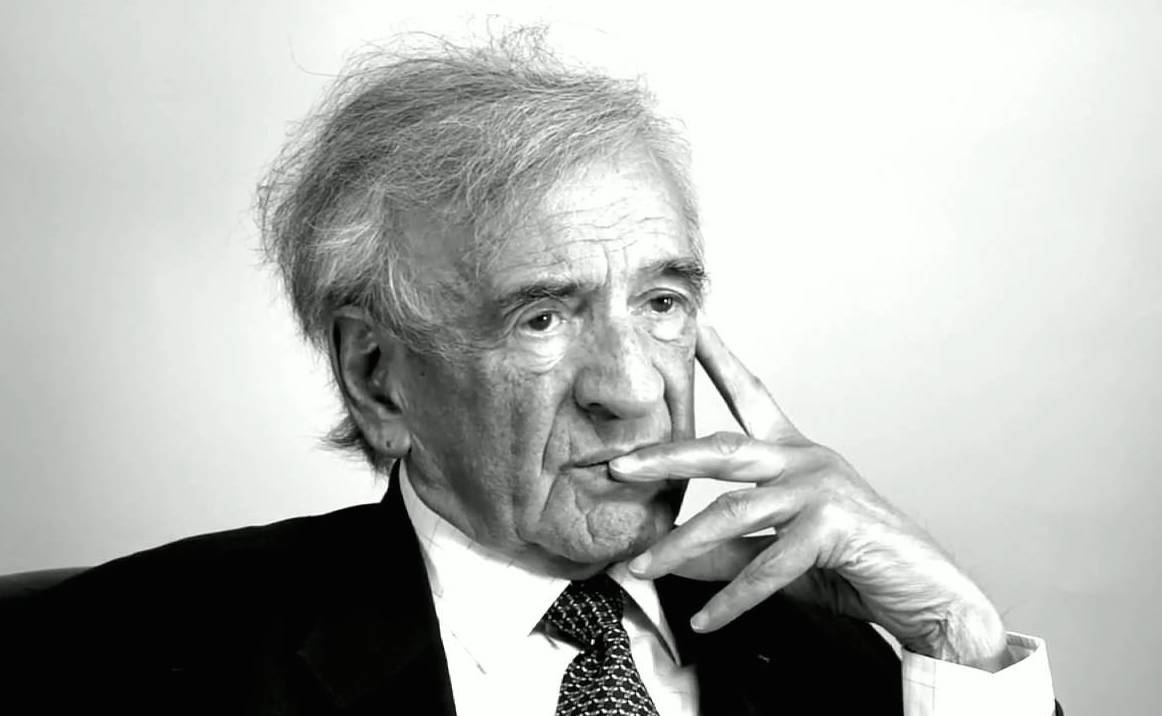Matthieu Peck signe son second roman, Déjà les mouches, paru chez Gallimard. Une plume nouvelle et rare qui figure sur la « sélection de printemps » du prix Renaudot. Une formule de John Giorno résume parfaitement Déjà les mouches : « Chacun est une déception totale ».
Gilles Krafft, industriel de cinquante ans et des poussières, croise le chemin d’Angèle, la vingtaine aux dents longues, au cynisme déjà bien amorti, à la candeur calcinée, mais pas tout à fait éteinte. Gilles se confie à son ami, William, époux de Janice, bourgeoise capricieuse aux traits flous, aussi prévisible qu’une crise économique ; pierre de rosette d’une passion sans grand intérêt que deux hommes fatigués se disputent. L’argent seul sert de principe régulateur à ces amours et ces amitiés invertébrées, pris dans la spirale du vide occidental lambda.
Déjà les mouches est un livre impeccablement gênant. Bien construit, il débute dans une cellule de dégrisement, se poursuit dans de belles demeures bourgeoises, de belles tables de restaurants, de suites de palaces, et se termine dans un bordel. Le rythme est doux, tout en mélopées organiques, un peu comme celui des Vagues de Virginia Woolf, version microplastique et pesticides ; il épouse à la perfection la corruption intrinsèque de chaque personnage. Peck explore la dynamique de la compromission. La mauvaise foi, dans ce livre, est reine. L’on s’enfonce dans les sables mouvants des rêves et des illusions perdues, emporté par le style de Peck, langoureusement angoissant, limpide, minimaliste et disruptif à la fois, ponctué de maximes, celles d’un moraliste qui aurait lu et aimé Nietzsche. « L’époque était fascinante dans son renoncement hyperactif ».
Un livre qui pique les yeux, une atmosphère nauséabonde, et pourtant inodore. « Avec un peu d’inventivité, les remontées d’épuration n’ont pas le goût que l’on s’imagine ». Matthieu Peck invente l’humour gris. Son sens de l’ironie, très fin, culmine dans la description fétichiste d’un fauteuil de designer italien des années soixante-dix, dont on sent bien que l’auteur n’en a rien à foutre. Auteur au mépris élégant, Peck ne cède pas sur son amour de la poésie : l’on devine parfois l’influence de Léon-Paul Fargue à quelques figures de style proto-surréalistes, savamment espacées, justes, et jamais décoratives. On pense inévitablement à Houellebecq, un Houellebecq non résigné, qui n’aurait jamais craché sur son premier amour : la poésie, romantique qui plus est. Matthieu Peck est un aède brutaliste. Gordon Matta Clark passé scribe, c’est à dire, un univers de ruines qui coûtent cher. Avec son style très syncrétique, il restitue précisément l’ennui passionnant toujours caractéristique du quotidien d’un bourgeois sans envergure. On pense aussi à Drieu La Rochelle : « La singularité est un mirage tendu au suicide de l’espèce ».
En écrivant Déjà les mouches, Peck avait un livre bien précis en tête : l’immoraliste de Gide. En témoigne la citation de La Rochefoucauld en exergue du livre « Il y a des héros en mal comme en bien ».
Comme dans les romans psychologiques de Simenon, une atmosphère transparente et crépusculaire, où rien ne se passe ou presque, mais où l’odeur du meurtre n’a de cesse de se faire sentir, nous étouffe lentement façon boa constrictor, sans que l’on comprenne que s’il en est ainsi, c’est parce que le lecteur est laissé seul juge de la valeur des personnages et de leurs actions. Le lent, le subtil, le gastronomique déclin physique et moral de chaque personnage est dépeint avec une neutralité empirique si ronde qu’elle en devient suspecte, et donc ironique. Une ironie de tueur à gage. Une cruauté quasi imperceptible, comme une torture japonaise. Déjà les mouches ressemble à un triangle des Bermudes dont les trois côtés s’appellent donc Drieu, Gide et Houellebecq, et dont l’aire s’appelle Peck ; triangle à l’intérieur duquel l’humanité sombre sans laisser de traces, et que rien ni personne ne saurait sauver. Schopenhauer aurait aimé ce livre. Kierkegaard aussi. Cioran l’aurait peut-être trouvé trop dur. Emmanuel Bove, sans pitié.
Matthieu Peck a la radicalité douce et poétique d’un chanteur de post-punk anglais, par exemple, lorsqu’il compare une profession à une infection, un métier à un virus. « Il n’ignorait pas que la meilleure manière de passer pour ce qu’on nomme un snob était de dire la vérité. »
La beauté fait bien quelques apparitions, fantomatiques, effacées à l’instar de celles de la poésie : « Autour d’une femme qui se rhabille est contenue l’entièreté de la beauté ». À la fin, un « je t’aime » tombe comme un astéroïde ; ou bien s’envole, comme un oiseau couvert de pétrole.
Trop de comparaisons dans cette critique, mais enfin, vous saurez maintenant où ranger Matthieu Peck dans votre bibliothèque.