L’anti-intellectuel (première partie)
Le 7 novembre 1892, Proust invita son ami Fernand Gregh « à venir dîner ce soir lundi, à 7 heures précises, seul avec M. Bergson et surtout pas en habit[1]. » Gregh ne s’attendait pas à ça. Il venait tout juste d’avoir dix-neuf ans, sidéré à l’idée d’être présenté à un tel philosophe.
Henri Bergson, professeur alors au lycée Henri-IV, le mari d’une des cousines de Marcel, faisait beaucoup parler de lui depuis qu’il avait fait paraître son Essai sur les données immédiates de la conscience, sa thèse de doctorat.
Il appartenait, par ailleurs, à l’une des plus grandes familles juives de Varsovie. Son arrière-grand-père, Samuel Zbitkower, finançait le mouvement hassidique, un mouvement mystique très populaire parmi les Juifs d’Europe orientale. Il construisait des synagogues, des écoles, des académies rabbiniques où l’on enseignait la Cabale selon les vues du Baal Shem Tov (le « maître du saint Nom »), le fondateur du mouvement.
L’instinct, concept fondamental chez Bergson, restitue précisément ce que les cabalistes appelaient le rouah, c’est-à-dire le souffle émané de Dieu, l’élan vital, l’énergie créatrice, porteuse d’une félicité ineffable, mais perpétuellement contrariée par des forces attristantes, décourageantes, accablantes, liées à l’intelligence humaine et à ses limites.
Depuis la fin du XVIIIe siècle, les rabbins hassidiques s’opposaient avec véhémence aux autorités juives acquises à la Haskala, c’est-à-dire aux Lumières modernes, les Lumières kantiennes en particulier, les Lumières que l’on enseignait dans les universités allemandes auxquelles les Juifs avaient accès désormais, des Lumières abominables aux yeux des disciples du Baal Shem Tov.
Bergson reprenait le même discours, en l’adaptant à la culture française. Il dénonçait notamment « l’erreur de Kant » qui, selon lui, confondait le temps avec l’espace – ce qui revenait à confondre la vie avec la mort[2].
Bergson s’attaquait ainsi à toute la philosophie allemande issue des Lumières kantiennes.
Dans un pays comme la France, qui souffrait d’un complexe d’infériorité par rapport à l’Allemagne depuis la défaite de 1870, il produisait un anti-intellectualisme lié à un antigermanisme qui eut une influence considérable sur les intellectuels que fréquentait Proust, de quelque bord qu’ils soient, de l’extrême gauche à l’extrême droite : Daniel Halévy, Emmanuel Berl, André Gide, aussi bien que Maurice Barrès, Charles Maurras ou Léon Daudet.
« Quant aux “joies de l’intelligence”, remarquait Proust, pouvais-je ainsi appeler ces froides constatations que mon œil clairvoyant ou mon raisonnement juste relevaient sans aucun plaisir et qui restaient infécondes[3] ? »
L’idée de remettre en cause les « joies de l’intelligence », cette idée, Proust la trouva dans l’Essai sur les données immédiates de la conscience.
Paradoxalement, Bergson incarnait l’intellectuel anti-intellectuel. Mais, attention, il ne se souciait que de philosophie, il ne s’engageait pas en politique.
À la fois introverti et rebelle, mais avec une allure on ne peut plus conventionnelle, déjà doté d’une calvitie imposante, très bien élevé, très discret, il évitait de se laisser manipuler par quelque parti que ce soit, ni par l’extrême gauche, ni par l’extrême droite, ni même par l’extrême centre, comme on dirait aujourd’hui.
C’est justement ce qui permettait à Bergson de fonder ce que Bernard-Henri Lévy appellera l’idéologie française – l’idéologie majoritaire en France, aussi bien dans les universités que dans les cabinets ministériels, aussi bien dans les clubs socialistes que dans les salons littéraires, et cela durant plus d’un demi-siècle[4].
C’est précisément chez Léontine de Caillavet, l’un des modèles de Mme Verdurin, une Juive antisémite qui tenait l’un des salons littéraires les plus prestigieux de Paris que Proust rencontra Charles Maurras au début des années 1890.
Il avait à peu près le même âge que lui – une vingtaine d’années. De petite taille, mais assez beau garçon, costaud et nerveux, Maurras servait de secrétaire à Anatole France qui l’avait pris en pitié. Maurras était sourd. Les cornets acoustiques, dont on se servait alors pour améliorer l’audition, ne lui faisaient aucun effet.
Dans un salon, il fallait que quelqu’un se dévoue pour lui souffler à l’oreille ce dont il était question dans les débats afin qu’il puisse y participer. Mais il entendait à peine le son de sa propre voix. Elle s’enrayait sans qu’il puisse la contrôler.
Il arrivait tout de même à tenir une conversation en tête-à-tête dans un lieu silencieux. Et sans doute eut-il l’occasion d’échanger des confidences avec Proust.
Ils partageaient le malheur d’être infirme l’un et l’autre. Ils se comprenaient bien. La surdité pour l’un, l’asthme pour l’autre, les contraignaient à faire l’expérience de l’isolement et à se replier, par nécessité, sur la littérature.
Mais, s’ils se découvraient toutes sortes d’affinités, ils ne restaient pas moins en désaccord sur un point fondamental : Maurras ne croyait plus en Dieu depuis qu’une maladie lui avait crevé les tympans à l’âge de quatorze ans.
Lors de la parution des Plaisirs et les Jours en 1896, Maurras consacra un article très favorable à Proust – le tout premier article véritablement élogieux qu’il ait jamais reçu – car alors son livre était très mal accueilli par la presse aussi bien que par le public.
Maurras ne prédisait pas moins : « M. Marcel Proust nous sera un témoin de la vérité retrouvée[5]. »
Proust lui apparaissait comme un romancier bergsonien. Seulement ce qui relevait de la thèse philosophique chez Bergson – avec quelque chose qui restait malgré tout assez abstrait et assez sec – se métamorphosait avec un art admirable, aux yeux de Maurras, dans « l’allégresse poétique » des Plaisirs et les Jours.
Chez Proust, « aucune sécheresse ». « Il n’est rien qu’il ne conte avec quelque émotion. Et son ironie elle-même paraît jaillir d’une source de sympathie tenue secrète », observait Maurras[6] en faisant allusion à la puissance immanente et télépathique à la source de toute vie, selon Bergson.
L’article apporta un réconfort d’autant plus précieux à Proust que Maurras commençait alors à se classer parmi les critiques littéraires de premier ordre.
* * *
« Je n’oublie pas qu’un des premiers, jadis, vous avez parlé d’une façon délicieuse des Plaisirs et les Jours. Je vous ai toujours gardé de cet article une reconnaissance infinie », confiait Proust à Maurras en décembre 1919[7].
À l’ombre des jeunes filles en fleurs venait alors d’obtenir le prix Goncourt grâce à Léon Daudet, le complice de Maurras à la tête de L’Action française, le principal quotidien d’extrême droite.
Tout le monde s’attendait à ce que l’Académie Goncourt couronne Les Croix de bois de Roland Dorgelès – un hymne à l’héroïsme de l’armée française écrit par un héros de la guerre –, le roman que la critique et le public plébiscitaient. L’attribution du prix au roman de Proust entraîna une avalanche d’articles hostiles.
On ne comprenait pas qu’on ait pu couronner un livre aussi difficile à lire. Et voilà que L’Action française, pourtant si anti-intellectuelle, le portait aux nues. Quel paradoxe !
Daudet lui faisait une publicité retentissante dans son journal, ce qui n’aurait pas été possible sans l’accord de Maurras.
En reprenant contact avec lui, Proust ne pouvait faire autrement que de le remercier, et pour son soutien passé, et pour son soutien actuel :
« Je suis d’autant plus à l’aise pour vous dire mon admiration profonde que je ne peux plus rien attendre de L’Action française qui m’a comblé », précisait-il[8].
* * *
Il avait connu Léon en 1894, lors d’une soirée chez Alphonse et Julia Daudet, ses parents, qui tenaient également l’un des salons littéraires les plus prestigieux de Paris.
Proust – Juif par sa mère – ne craignait pas de conclure une amitié avec un antisémite comme Léon.
Il ne déplorait pas moins « l’affreux matérialisme » qui s’imposait chez les Daudet. « Différence entre Musset, Baudelaire, Verlaine, expliquée par la quantité d’alcool qu’ils buvaient, caractère de telle personne par sa race (antisémitisme) », constatait Marcel dans une lettre à Reynaldo Hahn, son mari en quelque sorte[9].
Léon avait une particularité : Brun, frisé, moustachu, et d’ailleurs assez beau, il ressemblait à un Arabe ou à un Juif séfarade. Il avait tout à fait cet air-là, qu’il devait aux origines provençales de sa famille. Ses détracteurs le comparaient à un « épicier de Mostaganem »[10].
L’ensemble des peuples méditerranéens passaient alors pour des Sémites. Un racisme spécifique se développait en France qui dénigrait les gens du Midi, ce qui expliquait pourquoi Léon, à la suite de son père, se faisait autant remarquer par son antisémitisme, par compensation, pour affirmer sa francité.
Leur allure méridionale n’empêchait nullement les Daudet de former une famille française classique, aux yeux de Marcel.
Il se rendit plusieurs fois en vacances dans leur maison de campagne à Champrosay (près de Draveil en Essonne), une grande villa comparable à celle de sa propre famille à Auteuil, mais sans les efforts de décoration dans le style grandiose qui caractérisait son grand-oncle Louis Weil, le maître de maison que l’on surnommait par ironie « le châtelain d’Auteuil » dans la famille, précisément à cause de son goût déplorable pour les décors clinquants.
Les pièces de réception ne croulaient pas sous les dorures, les draperies et les palmiers en pot, chez les Daudet. Proust y observa probablement les intérieurs que l’on retrouve dans la maison familiale de son narrateur, avec les mêmes rites, les mêmes habitudes, les mêmes réflexions antisémites.
Déjà en 1905, quand il écrivait Sur la lecture – c’est-à-dire l’esquisse de ce qui deviendrait Du côté de chez Swann –, Proust ressentait le besoin d’inventer un narrateur issu de la classe moyenne et inscrit dans un milieu tout à fait clérical.
« Pour des raisons esthétiques », expliquait-il, « et aussi pour réagir sur cette manie des littérateurs qui, dès qu’ils se peignent dans un roman, s’y donnent des chevaux, un château, une famille dans le Berri, etc., j’ai baissé d’un cran mon enfance[11]. »
Ainsi se décidait-il à concevoir un narrateur « ordinaire ». Et de qui pouvait-il s’inspirer ? Sinon des Daudet.
Il n’y avait que Léon, et son frère cadet Lucien, parmi ses proches, qui correspondaient plus ou moins au profil sociologique qu’il recherchait pour se remettre en mémoire l’atmosphère de la bonne bourgeoisie française d’origine provinciale.
Marcel n’appréciait pas pour autant la vie en province. Il ne s’y rendait qu’en romancier. Il n’y restait jamais longtemps. « Proust déteste la campagne », précisait Léon[12].
En décembre 1897, en pleine affaire Dreyfus, Alphonse succomba à une attaque cérébrale.
Dès qu’ils apprirent la nouvelle, Marcel et Reynaldo se précipitèrent au domicile du défunt, accueillis à bras ouverts par sa famille. « Ils arrivèrent dans la soirée, fraternels et désespérés, et, les trois jours qui suivirent, j’eus sans cesse près de moi le secours de leur présence », précisait Lucien dans ses Souvenirs[13].
Malgré l’affrontement qui faisait rage alors entre dreyfusards et antidreyfusards, Proust ne cessait pas d’entretenir des relations avec les Daudet.
« Marcel était un ami incomparable », assurait Lucien. « Que de soirées passées avec lui pendant notre deuil, soit qu’il restât une heure ou deux avec ma mère et moi », « soit qu’il voulut bien me consacrer une soirée chez lui sans recevoir personne[14]. »
Proust s’attachait aux Daudet. Et, en retour, les Daudet s’attachaient à lui, comme d’ailleurs à Reynaldo. L’un et l’autre faisaient quasiment partie de la famille.
Marcel entretenait avec Léon une amitié d’autant plus forte que leurs positions politiques les contraignaient à se voir en privé, presque en cachette, chez l’un ou chez l’autre, sans que leurs proches ne s’en doutent.
Léon livrait des articles à toutes sortes de journaux, pourvu qu’ils soient de droite ou d’extrême droite – au Figaro, au Gaulois, à La Libre parole, etc. Il adorait la presse. Il courait les salles de rédaction. Il répandait les nouvelles. Il savait tout avant tout le monde.
On ne peut plus obsessionnel, il revenait sans cesse à la charge, il s’exaltait, il bouillonnait, il ne tenait pas en place. Il ne cessait de se donner en spectacle. Il faisait tout son possible pour passer pour une brute. Il s’empiffrait. Il se saoulait. Il tenait des propos orduriers, ce à quoi on reconnaissait précisément son style.
Comment Marcel pouvait-il être attiré par un type pareil ? Qui sait ?
Léon prenait de plus en plus d’importance chez les antidreyfusards. Voilà sans doute ce qui le rendait intéressant aux yeux de Proust.
Jusqu’en 1908 L’Action Française n’était qu’une revue bimensuelle. Même si elle se faisait déjà beaucoup remarquer, elle ne touchait qu’un public restreint.
Léon avait convaincu Maurras d’en faire un grand journal (Maurras assurant sa direction politique et Léon dirigeant concrètement sa rédaction).
Mais ses qualités d’homme de presse ne suffisaient pas, il avait fallu beaucoup d’argent à Léon pour faire de L’Action française l’un des plus grands quotidiens du pays.
Alors, en 1908, il venait d’hériter de la fortune de la comtesse de Loynes, une ancienne courtisane qui, après s’être dotée d’un titre de noblesse, avait tenu l’un des principaux salons littéraires d’extrême droite.
Toutefois les chroniqueurs mondains ne commencèrent à s’intéresser à elle que lorsque l’affaire Dreyfus éclata, précisément parce que son salon devenait du même coup le quartier général des antidreyfusards, grâce à Léon précisément.
Le salon d’Odette, devenue Mme Swann, se forme de la même manière dans le roman, en profitant des mêmes événements, à ceci près que c’est Mme Verdurin qui en donne l’idée à Odette – « Mme Verdurin chez qui un antisémitisme bourgeois et latent s’était réveillé et avait atteint une véritable exaspération[15] ».
Jusqu’alors la comtesse de Loynes ne recevait que des hommes. Les femmes dites respectables ne pouvaient évidemment pas entretenir des relations avec une ancienne prostituée. Il en va de même pour Mme Swann, une femme que les Guermantes n’auraient jamais reçue avant l’Affaire.
Il suffit désormais d’écrire « Mort aux Juifs ! » sur son ombrelle pour intégrer le faubourg Saint-Germain, constate la duchesse de Guermantes. La judéophobie n’ouvrait pas seulement les portes des salons de l’aristocratie à d’anciennes prostituées, elle permettait aux ténors de l’antisémitisme de prendre le contrôle du parti royaliste.
Les grands seigneurs comme le comte d’Haussonville, ou le marquis de La Tour du Pin, qui jusqu’alors dirigeaient naturellement ce parti, cédaient sa direction à des tribuns radicalisés – justement des hommes comme Léon, ou comme Maurras, ou comme Barrès, issus de la gauche ou de l’extrême gauche – de même que dans le roman Mme Verdurin finit par devenir princesse de Guermantes.
L’expression « Action française » ne s’associait pas qu’à un journal, elle désignait également le parti royaliste en France, de peu d’importance sur le plan électoral, mais très actif, en revanche, en matière de militantisme, et prêt à prendre le pouvoir.
L’extrême droite changeait de nature. Elle cessait de représenter la monarchie traditionnelle pour préfigurer le fascisme.
Ainsi, ce n’est pas seulement le besoin d’« universaliser » son narrateur qui poussa Marcel à s’inspirer des Daudet dans son roman. C’est aussi parce qu’ils lui permettaient de comprendre comment se renouvelait l’extrême droite en France.
Hannah Arendt, dans son essai sur Les Origines du totalitarisme, faisait de la Recherchel’ouvrage majeur qui témoignait de l’histoire des Juifs au tournant du XIXe et du XXe siècles. Des déterminations « cachées sous la surface des événements », qui échappaient à l’attention des historiens classiques, apparaissaient grâce à Proust, selon Arendt[16].
« Si nous avions un gouvernement plus énergique, tout ça devrait être dans un camp de concentration. Et allez donc ! » songe Mme Verdurin, le modèle à sa manière des dictateurs modernes dans la Recherche[17].
Cependant cette dimension du roman, compressée dans ses profondeurs, ne se révélait que dans les années 1930.
* * *
« Marcel est génial, mais c’est un insecte atroce, vous le comprendrez un jour ! » assurait Lucien Daudet à son amant, Jean Cocteau[18].
Effectivement, « la vérité sur Proust ne peut se dire sans scandale », précisait Cocteau. « Il obligeait, par exemple, L’Action française à le suivre, à lire des horreurs[19]. »
Mais pourquoi L’Action française s’était-elle laissée faire ? Pourquoi lui fallut-il des années avant de comprendre ce dont il est réellement question dans la Recherche ?
1. Marcel Proust, Lettre à Fernand Gregh, 7 novembre 1892, Correspondance I, Plon, p. 190.
2. Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, PUF, p. 102 et suivantes.
3. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, p. 444.
4. Bernard-Henri Lévy, L’Idéologie française, Grasset, p. 153.
5. Charles Maurras, Revue encyclopédique, août 1896, cité par Philip Kolb, dans Marcel Proust, Correspondance II, Plon, p. 109.
6. Charles Maurras, Revue encyclopédique, août 1896, cité par Jacques-Henry Bornecque, Un autre Proust, Nizet, p. 53. (C’esr moi qui souligne.)
7. Marcel Proust, Lettre à Charles Maurras, 26 décembre 1919, Correspondance XVIII, Plon, p. 561.
8. Marcel Proust, Lettre à Charles Maurras, 26 décembre 1919, Correspondance XVIII, Plon, p. 561.
9. Marcel Proust, Lettre à Reynaldo Hahn, 15 novembre 1895, Correspondance I, Plon, p. 441.
10. Cité par Ghislain de Diesbach, Proust, Perrin, p. 183.
11. Marcel Proust, Lettre à Hélène de Chimay, 20 juin 1905, Correspondance XXI, Plon, p. 605.
12. Léon Daudet, Salons et Journaux, réédité dans Souvenirs littéraires, Grasset, p. 226.
13. Lucien Daudet, Autour de soixante lettres de Marcel Proust, N.R.F., p.34.
14. Lucien Daudet, Autour de soixante lettres de Marcel Proust, Gallimard, p. 35.
15. Marcel Proust, Le Côté de Guermantes, Pléiade, p. 549.
16. Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme (trad. Jean-Louis Bourget, Robert Davreu et Patrick Lévy), Gallimard, p. 325.
17. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, p. 344.
18. Lucien Daudet, cité par Jean Cocteau, Le Passé défini, Gallimard, p. 308.
19. Jean Cocteau, Journal 1942-1945, Gallimard, p. 45.





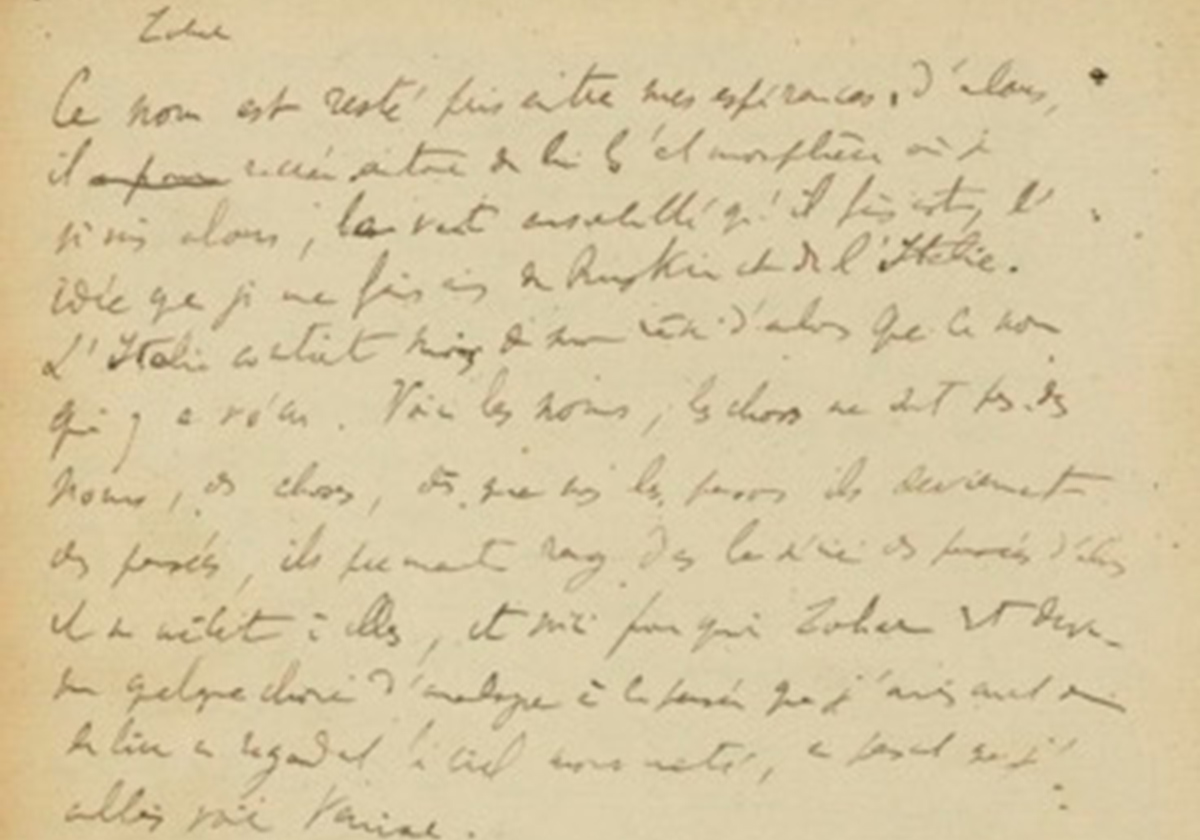


Mais le salon de Mme Verdurin n’est-il pas au contraire un haut lieu du Dreyfusisme ?
? Quant à celui d’Odette je ne m’en souviens pas mais Swann est un dreyfusard fanatique !d
Chez Proust, le dreyfusisme ne contredit pas nécessairement l’antisémitisme. C’est le cas pour la Verdurin (comme c’était le cas pour la Caillavet). C’est le cas également pour Bloch.
Ainsi Bloch (l’incarnation de l’israélite antisémite) est particulièrement flatté par l’antisémitisme de Mme Sazerat, la « preuve de la sincérité de sa foi et de la vérité de ses opinions dreyfusardes ».
À traiter dans « Proust et l’extrême gauche »…