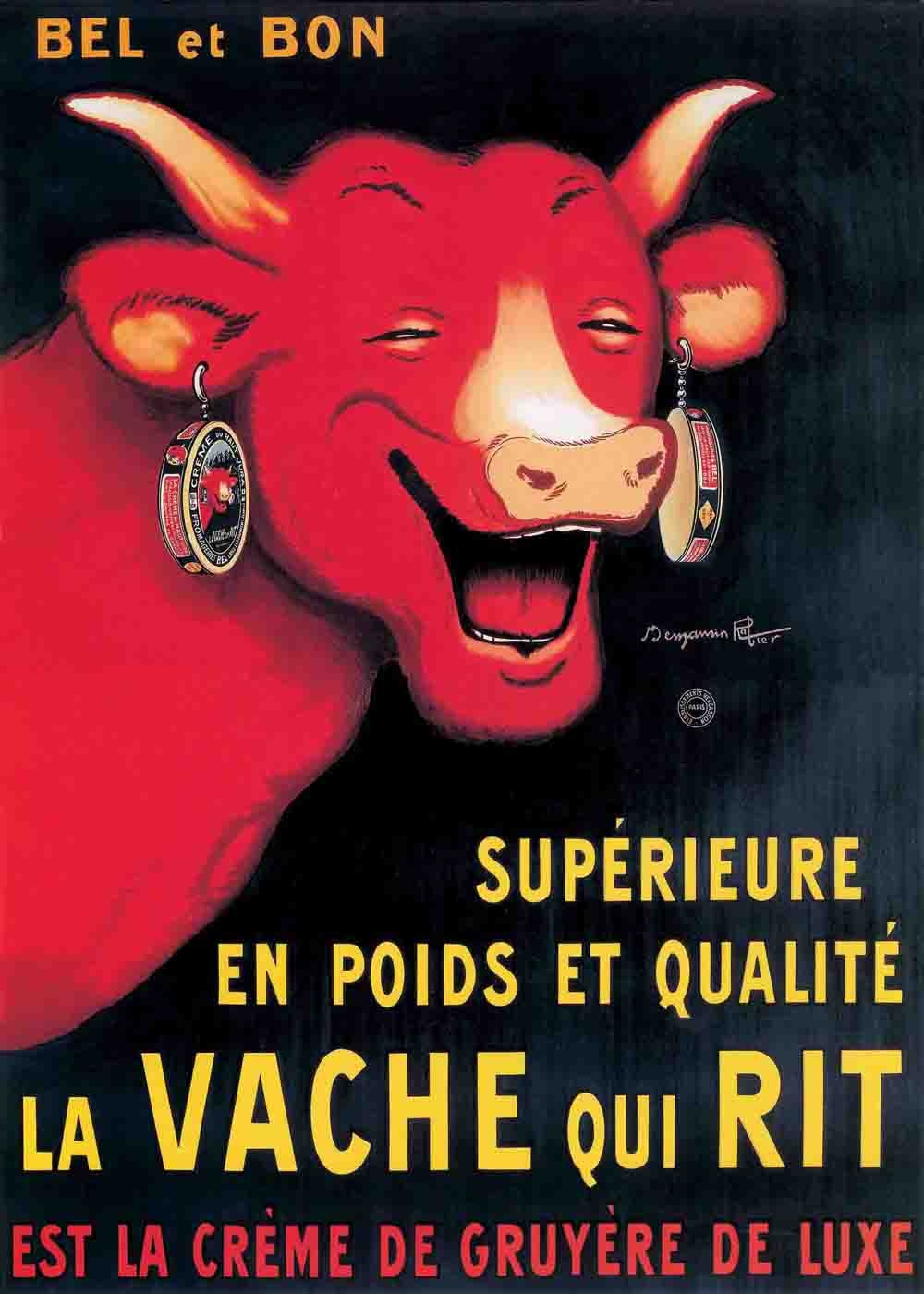Le signe
La baronne Nathaniel de Rothschild (la grand-mère d’un ami d’enfance de Proust) rassemblait une collection d’objets d’art juif.
Exposée dans son hôtel du faubourg Saint-Honoré, cette collection – unique en son genre alors – formait le fonds original de l’actuel musée du Judaïsme de Paris. La baronne l’ouvrait volontiers à des visiteurs. On y voyait un objet minuscule dont on se demandait ce qu’il faisait là, sauf si on l’observait à la loupe.
Il s’agissait de deux grains de blé sur lesquels un rabbin avait gravé le texte du Schema Israël. Les lettres s’y imprimaient si finement qu’elles restaient invisibles à l’œil nu. Voilà un objet que Proust eut sans doute l’occasion d’observer.
Si rétréci, si comprimé qu’il soit, l’objet ne disparaissait pas. Il résistait à la pression que l’espace et le temps faisaient peser sur lui. Une pression qui n’est jamais plus forte que lorsqu’on atteint le degré où l’on devient invisible, sauf à la loupe. Sans image, désormais, l’objet ne constituait plus qu’un signe. Il passait, en quelque sorte, du côté de chez Swann.
La plupart des membres de la société des études juives fréquentaient le salon de Geneviève Straus, boulevard Haussmann, notamment Adolphe Franck, le plus prestigieux d’entre eux, le premier Juif agrégé de philosophie en France, membre de l’Institut, professeur au Collège de France, spécialiste de Platon, mais également un ami intime de la maîtresse de maison. Proust l’a connu chez elle dès son adolescence.
Franck avait publié un ouvrage monumental sur la Cabale où il établissait le lien entre la mystique juive et la mystique platonicienne. Il provoquait un séisme dans la société israélite de Paris. Depuis près d’un siècle, aucun Juif éclairé n’avait jamais osé réhabiliter publiquement la littérature cabalistique.
Une réhabilitation que Samuel Cahen n’accueillait pas favorablement, mais qu’il tolérait volontiers là encore – néo-marranisme oblige –, puisque cette réhabilitation n’affectait qu’un tout petit milieu dans la communauté juive.
L’ouvrage de Franck – La Kabbale ou la philosophie religieuse des Hébreux – ne permettait pas seulement de s’initier au mysticisme juif, il offrait une vue d’ensemble sur l’histoire de la littérature rabbinique.
Or les rabbins mêlaient deux formes littéraires dans leur texte : une forme conceptuelle, théorique et discursive, dite halakhique, afin de concevoir la politique dont dépend l’existence matérielle d’Israël, et une forme mystique, ésotérique et poétique, dite aggadique, dont dépend l’existence spirituelle d’Israël, et qui constitue le corpus des chroniques, des légendes, des paraboles de la tradition talmudique, mais toujours entrelacé au corpus théorique pour former un même ensemble.
Proust observait précisément l’entrelacement de deux formes littéraires comparables à celles du Talmud dans son propre texte, sous la pression de deux tendances opposées.
Cette opposition fondamentale renvoie aux deux cotés de l’Arbre de vie selon la Cabale, un arbre symbolique à deux branches : du côté gauche, la branche théorique, et du côté droit, la branche poétique.
L’auteur du Zohar remarquait que les deux côtés ne cessent de se quereller, au risque de provoquer une catastrophe. Eh oui ! Lorsque le côté gauche (le côté théorique) impose son autorité au détriment de l’autre côté (le côté poétique), alors la pensée s’assèche et devient déprimante, voire dangereuse.
« Chaque jour j’attache moins de prix à l’intelligence », affirmait Proust[1]. La véritable puissance, ce n’est pas l’intelligence. Il ne suffit pas d’être intelligent pour accéder à la vérité.
« Quant aux “joies de l’intelligence”, songeait-il, pouvais-je ainsi appeler ces froides constatations que mon oeil clairvoyant ou mon raisonnement juste relevaient sans aucun plaisir et qui restaient infécondes[2] ? »
L’intelligence se compare à la vue. Elle ignore ce qui se passe dans les profondeurs de la pensée, consciente ou inconsciente.
Cette idée, issue du Zohar, est fondamentale pour Proust. Elle ne l’est pas moins pour Freud ou pour Kafka.
La maison de la rue La Fontaine, la maison familiale disparue à la suite du percement de l’avenue Mozart, cette maison où Proust était né et où il avait passé les étés de son enfance, cette maison, il n’en gardait qu’un souvenir faussé par son intelligence, puisqu’elle ne prend en compte que l’extériorité des choses.
Et voilà qu’en se nourrissant par hasard d’un petit morceau de pain grillé imbibé de thé, il découvrait ce que c’est que le passé, c’est-à-dire l’intériorité que l’intelligence laisse nécessairement passer.
« Alors je me rappelai : tous les jours, quand j’étais habillé, je descendais dans la chambre de mon grand-père qui venait de s’éveiller et prenait son thé. Il y trempait une biscotte et me la donnait à manger. Et quand ces étés furent passés, la sensation de la biscotte ramollie dans le thé fut un des refuges où les heures mortes – mortes pour l’intelligence – allèrent se blottir, et où je ne les aurais sans doute jamais retrouvées, si ce soir d’hiver, rentré glacé par la neige, ma cuisinière ne m’avait proposé le breuvage auquel la résurrection était liée[3]. »
Or, en traversant la cour d’un immeuble, il se laissait stupéfier par la même sorte de sensation lorsque son pied heurta soudain un pavé.
« Je sentais au fond de moi-même tressaillir un passé que je ne reconnaissais pas : c’était en posant le pied sur ce pavé que j’avais éprouvé ce trouble. Je sentais un bonheur qui m’envahissait…[4] »
Le phénomène qui s’était produit quand le goût du petit morceau de pain grillé l’avait ramené dans la maison de son enfance, en lui offrant par un acte suprême de générosité le pouvoir de retrouver le passé qui échappe à l’intelligence, ce phénomène se reproduisait en le transportant comme par enchantement à Venise dans le temps retrouvé depuis cette cour d’immeuble. Et, si ce phénomène se reproduisait, c’est que quelque chose agissait en lui pour le guider jusqu’au seuil où il accéderait enfin à la littérature.
En somme, la littérature, c’est ce que l’auteur du Zohar appelait la « couronne suprême », kether en hébreu, la sphère mentale la plus proche de Dieu.
« Cette infériorité de l’intelligence, c’est tout de même à l’intelligence qu’il faut demander de l’établir », observait Proust. « Si l’intelligence ne mérite pas la couronne suprême, c’est elle seule qui est capable de la décerner. Et si elle n’a dans la hiérarchie des vertus que la seconde place, il n’y a qu’elle qui soit capable de proclamer que l’instinct doit occuper la première[5]. » L’instinct, c’est-à-dire la générosité dans ce cas de figure.
Proust ne cessait de se référer à l’Arbre de vie cabalistique dont les deux branches se rejoignent précisément à son couronnement. Ces deux branches, c’est ce qu’il appellera le côté de Guermantes et le côté de Méséglise – Guermantes, l’intelligence, et Méséglise, la générosité.
Roland Barthes remarquait que Proust en 1908, au moment de se lancer dans la Recherche, se trouvait à la croisée de deux voies, tiraillé entre deux côtés : « le côté de l’Essai (de la Critique) et le côté du Roman[6] ».
Barthes ne songeait nullement à la croisée de la forme halakhique et de la forme aggadique. Comment aurait-il pu y songer ? C’était un universitaire français. Il ignorait tout de la littérature rabbinique. Ce qui ne l’empêchait pas pour autant de retrouver chez Proust – sans le savoir – la trace des deux formes littéraires entrelacées dans le Talmud.
« Ce n’est qu’à la longue que le lecteur apprend à distinguer deux puissants courants dans ce livre, courants qui parfois suivent des directions parallèles, parfois semble se croiser et se contrarier l’un l’autre ; l’un jaillit du cerveau, et l’autre du cœur ; le premier est de la prose, l’autre de la poésie », notait Arsène Darmesteter à propos du Talmud[7]. Mais tout cela, bien sûr, on pourrait le dire de la Recherche.
« Nous disons déchiffrer, et l’image n’est pas exagérée ; c’est bien un véritable texte de hiéroglyphes ou d’inscriptions en caractères inconnus que l’on a devant soi », expliquait Darmesteter, toujours devant une page du Talmud[8].
Écoutez Proust : « Déjà à Combray je fixais avec attention devant mon esprit quelque image qui m’avait forcé à la regarder, un nuage, un triangle, un clocher, une fleur, un caillou, en sentant qu’il y avait peut-être sous ces signes quelque chose de tout autre que je devais tâcher de découvrir, une pensée qu’ils traduisaient à la façon de ces caractères hiéroglyphes qu’on croirait représenter seulement des objets matériels. Sans doute, ce déchiffrage était difficile, mais seul il donnait quelque vérité à lire[9]. »
Proust connaissait très probablement l’ouvrage de Darmesteter sur le Talmud, de même qu’il connaissait l’ouvrage de Franck sur la Cabale.
Il commença à lire le Zohar en hiver 1900, au moment où il abandonna Jean Santeuil, alors qu’il projetait de partir pour Venise[10]. Or on n’aborde pas le Zohar sans s’y préparer par d’autres lectures.
Les grands textes juifs ne se présentent jamais clairement. Ils exigent de leurs lecteurs un effort de déchiffrage qui représente un enjeu bien plus important que les informations qu’ils fournissent, quitte à défier la rhétorique classique.
En 1920, peu avant sa mort, Proust apprit que s’était créé un club à son nom dans la capitale britannique. Un Club Marcel Proust ? Oui, un reading group, un cercle de lecture fondé par de simples particuliers, où l’on donnait des conférences sur son œuvre et où l’on en débattait.
Les Juifs traditionnels procèdent de la même manière en ce qui concerne le Talmud ou le Zohar. Mais lui, Proust, n’a jamais étudié qu’en solitaire (et donc en secret) la littérature rabbinique.
Il croyait à la « religion de la beauté », c’est-à-dire à une religion qui s’appuierait sur la faculté de se laisser émouvoir par quelque chose de beau. Cependant, pour lui, la véritable beauté ne peut pas être contemplée de l’extérieur, c’est-à-dire par les yeux. « On doit la pressentir et l’aimer comme une âme à travers des ombres infinies, plutôt que de la saisir matérielle[11]. »
Il ne contredisait pas le judaïsme pour autant. Mais, enfin, il se distinguait d’un Juif traditionnel.
Toutefois les reading groups, les cercles de lecture consacrés à Proust, se sont multipliés dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis. Un phénomène extraordinaire dont on ne se fait guère idée en France.
Les membres d’un reading group se réunissent généralement tous les quinze jours, chacun convenant qu’il aura lu entre temps un certain nombre de pages de la Recherche afin d’en débattre avec les autres membres du groupe. La lecture intégrale du roman proustien dure ainsi deux ou trois ans. Et habituellement, une fois accomplie, elle reprend à son début pour un nouveau cycle de lecture, car – après avoir lu Proust une première fois – on le redécouvre d’une toute autre façon la seconde fois, précisément comme s’il s’agissait du Talmud ou du Zohar.
« Sans doute, votre livre est composé à merveille selon les lois de votre propre sensibilité. Mais il me semble qu’il ne l’est pas selon celles qui ont présidé à la composition de la plupart des œuvres de “chez nous” », faisait remarquer un critique français à Proust[12].
« À l’observation, il oppose la sensibilité. À la philosophie, la pensée. Aux mots, les noms. Aux significations explicites, les signes implicites et les sens enroulés », remarquait Gilles Deleuze à propos de Proust.
Tout à la fois fasciné et révulsé par le mysticisme proustien, Deleuze repérait justement dans la Recherche « l’opposition d’Athènes et de Jérusalem »[13], autrement dit le clivage entre la culture gréco-romaine fondée sur la raison, et la culture judéo-chrétienne fondée sur la révélation.
Parmi les érudits qui fréquentaient la maison des Weil, rue La Fontaine, on remarquait Salomon Munk, qui avait débuté comme précepteur chez les Rothschild, avant de devenir conservateur des manuscrits hébraïques à la Bibliothèque nationale, puis professeur d’hébreu au Collège de France. Il est surtout connu pour sa traduction en français du Guide des égarés, l’ouvrage de Maïmonide, l’un des plus grands talmudistes médiévaux.
Munk employait un jeune secrétaire nommé Moïse Schwab, qui après la mort de son maître, en 1868, se consacra à la tâche de traduire en français le Talmud de Jérusalem. Tâche considérable. Il lui fallut plus de vingt ans pour achever sa traduction en douze volumes.
Schwab siégeait évidemment au comité directeur de la Société des études juives, et vraisemblablement fréquentait-il la maison de la baronne James-Édouard de Rothschild, avenue de Friedland, où Proust l’a peut-être connu.
L’épisode du dallage inégal du second Temple se trouve dans sa traduction du Talmud de Jérusalem, dans une version qui diffère un peu de celle consignée dans le Talmud de Babylone.
Il est possible que Proust en ait entendu parler par Schwab, ou par l’un de ses lecteurs. Mais, plus simplement, sans doute s’est-il procuré sa traduction du Talmud et a-t-il découvert lui-même l’épisode.
« Des rabbins disent que l’Arche était enfouie [au Temple] dans la cellule du magasin au bois. Comme il était arrivé un jour à un cohen [un prêtre], atteint d’un défaut corporel, de fendre du bois dans cette pièce sur le sol, il remarqua à un endroit la bizarrerie du dallage. Il alla faire part de son observation à un compagnon ; mais, avant d’avoir achevé son récit, il rendit l’âme, et dès lors on sut avec certitude que l’Arche de l’Alliance était enterrée là[14]. »
Le texte traduit par Schwab apporte une précision intéressante : le prêtre qui découvrit la bizarrerie du dallage, souffrait d’une infirmité, de sorte que, selon la tradition, il avait été exclu du service d’honneur dans le sanctuaire, interdit aux infirmes, et affecté à des travaux plus humbles, comme celui de couper du bois.
Un détail qui alerta probablement l’attention de Proust, souffrant lui-même d’une infirmité. Cette malédiction se retournait soudain en bénédiction dans le récit talmudique, puisqu’elle prédestinait son héros à découvrir quelque chose d’essentiel.
1. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve (version Fallois), Gallimard, p. 53.
2. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, p. 444.
3. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve (version Fallois), Gallimard, p. 53.
4. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve (version Fallois), Gallimard, p. 55.
5. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve (version Fallois), Gallimard, p. 59. (C’est moi qui souligne.)
6. Roland Barthes, « Longtemps je me suis couché de bonne heure », Œuvres V, Le Seuil, pp. 460-461.
7. Arsène Darmesteter, Le Talmud, Allia, p. 35.
8. Arsène Darmesteter, Le Talmud, Allia, p. 44.
9. Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Pléiade, p. 457.
10. Marcel Proust, Cahier 5 du manuscrit de la Recherche, folio 53 verso, édité en ligne sur le site de la BNF : editions.bnf.fr . .
11. Marcel Proust, « La beauté véritable », dans Contre Sainte-Beuve, Pléiade, p. 342
12. Jacques Boulanger, Lettre à Marcel Proust, 29 décembre 1919, dans Marcel Proust, Correspondance XVIII, Plon, p. 568. (C’est moi qui souligne.)
13. Gilles Deleuze, Proust et les signes, PUF, pp. 128-129.
14. Talmud de Jérusalem, traité Shequalim, VI, 1, traduit par Moïse Schwab.