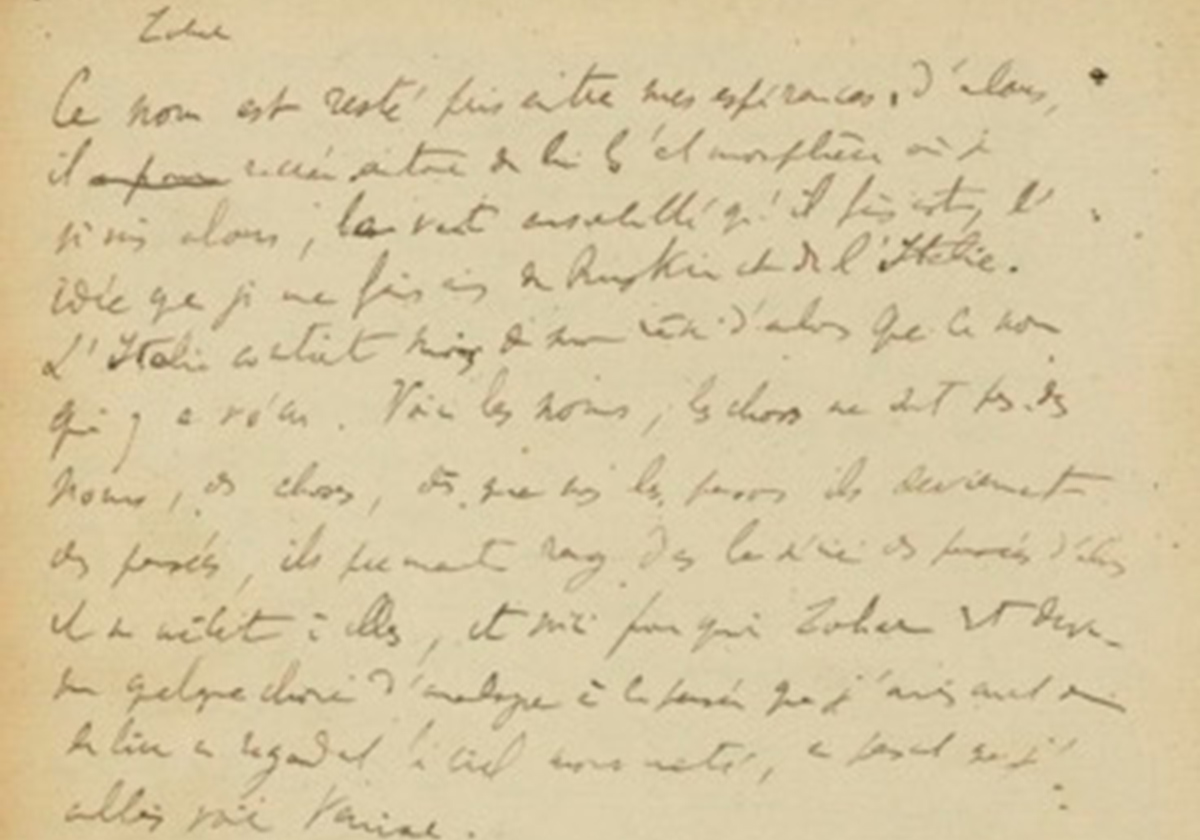Plutôt que d’écrire un article sur le dernier livre de Patrick Mimouni consacré à Proust (Proust amoureux, Grasset), j’ai désiré délaisser l’exercice social, vaguement culturel – réputé, pour peu qu’on y croie encore, germanopratin – et le canevas si rebattu et si stérilisant (tant les mots y perdent tout sens) de la recension journalistique – pour inviter le lecteur à partager, suscités par le livre, des « moments épistolaires ».
Pascal Bacqué
Pascal Bacqué à Patrick Mimouni
Cher Patrick,
Je finis à l’instant de lire ton livre, qui fut un événement aussi important pour moi, en matière de lecture, que la découverte de Malaparte il y a quatre ou cinq ans, mais pour des raisons précisément inverses. Les deux fois, des raisons personnelles, mais il n’y a qu’elles, tu le sais mieux que quiconque, qui soient vraiment généreuses et méritent d’être communiquées. Malaparte, parce qu’il activait une irréductible résistance de la poésie à une culture occidentale qui l’avait sciemment tuée, tout particulièrement en France ; et Proust élucidé par toi, par la destination qu’il donne à la prose française, malgré elle, si je puis dire. Car ton Proust est tout, immensément, sauf un poète ; je dirais d’une certaine manière qu’il a trop de choses à prendre en charge pour recevoir en plus le fardeau d’être un poète, que sut être, plus ascétiquement (et gnostiquement) Genet, et que Malaparte est devenu, lui, comme me l’avait suggéré mon admirable ami Ghislain Uhry, « à son corps défendant » – et au prix ou au moyen d’un viol, celui de l’histoire absolutiste du 20e siècle.
D’où le scandale qu’il provoqua chez les roquets journalistiques ; j’eus la faiblesse d’un article à ce sujet…
Car Proust, lui, avait eu à faire quelque chose d’absolument inouï que toi, le premier, as su mettre entièrement au jour, et de façon magistrale :
Faire exister le retournement de la culture occidentale en avatar de l’être juif.
Non pas le juif comme autre de la culture. Pas du tout. Mais ce que fait au juif, et à son autre, que le non-juif soit l’autre du juif.
Partir de l’évidence radieuse de l’être juif, radieuse d’ailleurs pour le juif et pour le non-juif, à son corps défendant. Radieuse car libératrice : il n’a jamais été question d’autre chose, chez le juif.
Cette évidence effrayante (pour la culture) et profondément optimiste (pour tout talmudiste, bibliste ou cabaliste qui médite sur la relation paradigmatique d’Israël et d’Edom – tant pis si les ignares associent ces mots à des avatars de la marque onusienne), tu en as donné, dans le plus grand écrivain du 20e siècle, une démonstration absolument renversante.
Tu vois, je m’agaçais de lire un certain amateur faire le malin, après d’autres, dans la revue K, sur Proust et le judaïsme, en me demandant comment il avait si honteusement pillé dans tes travaux précédents sans même te citer – il me semble qu’il a fini par rajouter une note de bas de page où il t’évoque – mais cette fois, la démonstration est si grande, dans ce livre, que tu ne risques plus rien des rages immanquables, des pillages cruels et des dissimulations calculées que tu subiras nécessairement. Parce que ton travail est si intelligent, à son tour si proprement radiographique, qu’il laisse loin derrière tout ce qu’on a écrit sur Proust. Tu as bien raison de te moquer finement de Deleuze, car ses affabulations philosophantes sur Proust ne sont rien à côté de ce travail intus et in cute que tu opères dans la chair du petit Marcel, où, à l’inverse de Spinoza, tu ne maquilles pas de la haine pure en amour et en joie, mais où tu démaquilles des misères intimes en pures intuitions de la révélation.
Je ne saurais manquer de te dire, cher Patrick, que la crudité de tes élucidations homosexuelles, absolument nécessaires par ailleurs pour la démonstration elle-même, m’ont personnellement gêné. Par exemple, je ne pourrai pas faire lire ce livre à mon fils, pour cette seule et unique gêne, dont je te parle. Ce qui veut dire qu’il y a une minuscule bordure de tes lecteurs naturels (ceux qui, chez les juifs de l’étude, se penchent aussi, aux heures de loisir, sur les textes littéraires ; gardons tout de même la mémoire des proportions) qui ne pourront pas rentrer, du moins pas sans mal, dans ton livre. Cela tient, dans le fond, à ce que tu convertis la langue d’Esope de Proust en langue de la crudité de ce qui fut jadis la militance gay, langue du coming out et de l’explicitation de l’implicite ; – langue qui, tu le sais bien, est d’ores et déjà en train de disparaître, comme la puissance de l’identité gay, remplacée par l’idéal d’asexuation délatrice qui triomphe. Mais ce point n’est qu’un détail en regard de l’extraordinaire pénétration de ton livre, et de son intelligence. Ton dernier chapitre, sur la radiographie et l’explication du mot vert-èbre est effectivement un bouquet final éblouissant.
C’est un cadeau que tu fais au lecteur, en tant (reprenons à Proust ce qui ne revient pas à Proust ) qu’il vit la signifiance du Temps retrouvé, lui, ce lecteur, en somme, du temps réel de l’intelligence une fois que sera tuée, radicalement, comme Proust l’a fait, le moment français de l’adoration proustienne, idolâtre comme tout moment national l’est par définition ; bref, ce lecteur de la fonction M au cœur de l’être juif (pour une définition de la fonction M, il faudrait les inviter à taper à la porte d’une maison d’étude ; je préfère la bizarrerie de cette expression, maintenant que je sais que cette lettre sera publiée, plutôt que la violence faite à une langue catholique qui déchirerait le sens de mon mot), laquelle fonction M n’est pas plus à venir que ne l’est le Olam haba, le « monde qui vient » (où un remarquable talmudiste découvrit un jour le signe chez Proust ; « monde qui vient » immanent-transcendant au temps, « minute affranchie à l’ordre du temps) : nous assistons, sur une œuvre-clé, à laquelle tu associes généreusement celle de Racine finissant par Phèdre et Athalie, au dévoilement de son sens dans l’économie du monde : celui d’une libération, d’une sortie de l’Égypte française. Que le croisement d’une homosexualité si singulière et d’une langue si hantée en même temps que si douée, ait accompli ce paradoxal affranchissement, c’est ce que tu as donné à tous ces lecteurs que Proust, dès lors, perdra en partie grâce à ton geste. Car c’est une bien pâle et piteuse Égypte qui s’obstine aujourd’hui à demeurer, quand s’effondrent et se boursouflent l’Histoire mourante et ses idolâtries, ne laissant plus au présent présentable (après tout, nous sommes en France, patrie de la bienséance) que des gestionnaires, défenseurs d’une frilosité post-nationale mais tellement française, tellement amiénoise, en somme – vastes historiens du collège de France hâtivement convertis à l’Amienité, puissants administrateurs d’institutions littéraires à La Baule, ou encore écrivains de leur faiblesse muséographiée – mais, cette fois, au Musée de la chasse et de la nature où ils promènent leur chienchien. De ce type (j’évoque ici mon expérience), qui tente désespérément de faire tenir la culture, alors que Proust, sciemment, et toi, son clairvoyant glossateur, la dynamitez. Car dans le fond, ton livre, et c’est là son plus grand mérite, arrache Proust à la culture française, et fait, dans les derniers chapitres, le récit de son kidnapping français pour des raisons atroces qui, en définitive, se termineront par Bernard Arnault ; raisons atroces de l’industrie du luxe dont Proust a été, tu le montres magistralement, le premier otage, voire le mythe fondateur, sous les espèces du « snobisme » et du « Faubourg Saint Germain » alors que tout son geste était ce jet d’acide à la gueule d’une idole. De l’idole française – dont tout véritable locuteur de la géniale langue, à travers les siècles, a été, plus ou moins officiellement l’ennemi, le contempteur, le massacreur.
Je l’appellerai, moi, cette idole, Edom et non de la France, car la France n’est jamais qu’un territoire expérimentalqui aurait pu être l’Angleterre par exemple – mais alors, évidemment, l’expérience eût été tout autre. Du même coup, la question de la langue française (j’ai longuement échangé avec M. sur la destruction de l’idolâtrie du style par Proust, de même que sur son néoplatonisme, comme tu sais) devient : est-il possible d’arracher la langue française à son idolâtrie de la langue française dont la forme finale est le « roman Gallimard », si structuré, si raisonnable et finalement si nihiliste ( Mauriac, Gide, etc.) pour faire vivre, à partir d’une apparence de forme-roman cachant en fait un traité de désappartenance, un manifeste d’être-juif, bref, une langue française de la fonction M ?
Tu comprends pourquoi cette question est si importante pour moi, et donc pourquoi ton livre m’a constamment renvoyé à moi-même. Non par narcissisme, non par jouissance d’être renvoyé à moi, mais seulement par souci de faire exister mon propre geste, et qu’importe s’il ne concerne en fait que de très rares amis. Tu sais, rare parmi les rares lecteurs, que tout mon sentiment, et mon désir, sont de faire exister une langue-française-étrangéisée, donc fidèle à Moïse, fidèle à la Leçon que ne recouvre pas la haute rhétorique gallicane, laquelle, si grande en janséniste et si puissante en jésuitique, est morte, ce qui veut dire que la littérature française telle qu’elle se pense est morte et enterrée, et, en fait, depuis Proust ; il suffit de regarder le nouveau roman pour s’en persuader, alors que dire des écrivains du jour…
Fidèle à la leçon d’abord poétique d’une liberté souveraine de la langue à l’égard de sa culture. De son public. De sa bourgeoisie.
Tout ce que fuit comme la peste l’écrivain contemporain et son éditeur expert.
Ce poète que ne fut pas Proust, quelques-uns doivent tenter de l’être, jusqu’à réussir là où les phases alanguies de sa prose ne montèrent pas au dernier assaut. En tous cas, ce que tu m’as permis d’assumer en toute tranquillité désormais, c’est qu’en miroir de celle de Proust, la difficulté architectonique qui fonde mon travail ressortit à des motifs existentiels, comme chez Proust, et non scolastiques, comme chez Joyce. Il est doux d’en être conforté du dehors. Difficulté que, pour notre part – nous qui tentons ce que je tente – nous devons dépasser en poème, parce que nous avons choisi le camp de la poésie, mais au même degré de désappartenance que la prose proustienne dans sa sortie de l’Égypte littéraire.
Un « nous » passé par la solitude du « je » ; mais d’un « je » en recherche, un jour, d’un « nous » perdu.
Je sais qu’en exprimant tout cela dans une lettre désormais publique, je semblerai prétentieux (« hyperbolique dans la forme », comme dirait ton ami N.). Mais une ambition n’est pas une réussite ; en revanche, pour rendre à ton grand geste sur Proust quelque effet, quelque témoignage de ce qu’il offre, il me semblait que non seulement toi, mais un autre qu’on inviterait délicatement à lire cet échange, deviez mesurer ce qu’il remue dans un sujet quelconque – en l’occurrence, ma pomme plus ou moins mûre.
Sans aucun doute, comme d’autres très grandes intelligences, Proust aurait jugé à l’idolâtrie de la poésie, car elle existe. Elle est grecque (M. me citant : « Le dieu de Delphes ne parle ni ne se tait ».) Mais depuis l’étude, on sait qu’il existe une poésie non-idolâtre, qui justement prolonge, avoisine, dialectise l’étude elle-même. La France hait, désormais, du haut en bas, la poésie de langue française. Ce n’est pas grave : nous aimons la langue, à quelques-uns, et nous laisserons la France et la Suisse à leurs votations.
En revanche, nous avons à faire avec l’Histoire ce que Proust a fait avec un Moi, à savoir son renversement de conscience captive du monde (le « nourrisson captif », le tinok che-nishba, traduisant dans le Talmud le juif otage de la culture) en résurgence nouvelle, purement vivante, d’une parole au monde. Que le motif « gay » ait été l’outil de ce renversement ne peut manquer d’une part de fasciner, d’autre part de gêner un juif de la Torah, et enfin de le laisser sur une immense question qui n’appartient qu’au Sage. Ce que je ne suis pas – si bien que sur la question gay, je ne peux que suspendre mon jugement.
Pardonne-moi de t’avoir invité ainsi dans mes questions propres, mais elles te montrent à quel point ta lecture m’a importé.
P.
PS : Deux choses encore.
La première : là où Proust est au plus près du poète, c’est dans le signe qui rappelle (et équivaut) la « suggestion » mallarméenne. Mais chez Mallarmé le signe est strictement vide et déplore le tombeau d’Anatole (lis, si tu ne les connais pas, les splendides « profils perdus » de Milner) comme il se doit. Car cela se doit. Chez Proust, le signe est au contraire trop-plein, comme tu le montres en devant produire des sur-interprétations, c’est-à-dire des drachot du texte proustien, inévitablement plein. Edom et Israël au temps impressionniste, au temps du triomphe du rien.
Dès lors, tu m’autoriseras à voir dans ce dernier mot donné à la littérature, ou bien un geste de soumission au rien, car la littérature n’est rien et Proust l’avait pastichée pour cela (qu’il se soit ensuite pris au piège, finalement, peu importe) – ou bien, à ta manière, un signe ultime, celui qui dans la littera-ture, derrière les cercles joachimites où il enferme les personnages de son expérience pour les boucler « dans le quinzième tome », retrouve et annonce la Lettre abandonnée sur le rivage, qui n’était que lui, qui était faite pour lui… qui était son genre.
Deuxième chose : cette Recherche remplie de gays, dans le fond, comment n’est-elle pas le « Notre-dame-des-fleurs » du poète Genet ? Parce que précisément, la ritualité – et la poésie – de Genet sont abolition du « monde du mal », soit l’enfer du démiurge qui s’appelle la France des ingénieurs et des flics (on dirait aujourd’hui des France-Cu-Monde et des Arnault) ; ce qui veut dire que Genet détruit Edom sans un instant chercher la trace de la lettre sous sa propre écriture enfouie. Mallarmé et Genet, deux vis-à-vis du petit Marcel, pleurent des larmes rouges quand lui sourit à pleurer.
Patrick Mimouni à Pascal Bacqué
Cher Pascal,
Un ami m’a récemment appris qu’il existait dans le Talmud (Yoma 54a), un passage étonnant : « Un jour, il y eut un incident au Temple impliquant un prêtre qui, occupé par diverses affaires, aperçut une dalle différente des autres. L’un des carreaux du sol en marbre était plus élevé que les autres, suggérant qu’il avait été retiré et remplacé. Ce prêtre en déduisit que l’Arche d’alliance y était enterrée. » Ce passage se rattache à la théorie selon laquelle l’Arche d’alliance a été enterrée sous le premier temple de Jérusalem afin d’échapper à la destruction lors de la conquête de la ville par Nabuchodonosor. Un passage qui fait évidemment penser à l’épisode du pavé disjoint dans la cour de l’hôtel de Guermantes.
Voici qu’au moment où le narrateur proustien atteint le seuil le plus désespérant, il lui arrive quelque chose d’extraordinaire. Il reçoit une espèce de grâce en heurtant du pied ce pavé disjoint, tandis que lui revient la mémoire d’un séjour à Venise des années auparavant. Soudain, il se rend compte que le temps n’est qu’une espèce d’illusion, et précisément il éprouve alors une joie dont il sent qu’elle est à jamais durable. Voilà comment il accèdeà la véritable religion, c’est-à-dire à la littérature, au sens où il l’entend.
Passage étonnant, en effet. Il est tout à fait possible que Proust ait entendu parler de cet épisode dans le Talmud. Il fréquentait des spécialistes du judaïsme, des gens comme Adolphe Franck, Théodore Reinach ou Zadok Kahn, tous membres de la Société des études juives, qui auraient très bien pu lui en parler.
J’ai consulté cet épisode dans les aggadoth du Talmud de Babylone, où l’on précise : « Le prêtre de service remarqua une dalle qui n’était pas au même niveau que les autres ; il alla en informer ses compagnons, mais il mourut subitement, avant d’avoir pu achever ce qu’il avait à dire. » Le rédacteur de ce passage ajoute mystérieusement : « C’est ainsi qu’on sut avec certitude que l’Arche avait été cachée là. »
L’Arche est donc cachée dans une cavité creusée sous le temple, à un emplacement que signale, précisément, la dalle un peu plus haute que les autres.
Remplace le mot « Arche » par « Temps retrouvé », et tu seras transporté chez Proust, justement sur le dallage inégal de l’hôtel de Guermantes, relayé par le souvenir de celui de la basilique Saint-Marc jadis, quand se produit la réminiscence qui ouvre au narrateur proustien les portes de la littérature en lui donnant l’idée de son œuvre.
Cependant, arrivé là, il éprouve deux sentiments contradictoires : d’une part, la conviction qu’il accède soudain à la vie éternelle ; et de l’autre, la conscience qu’il peut mourir d’un jour à l’autre, sans avoir eu le temps d’accomplir son œuvre.
« Il mourut subitement, avant d’avoir pu achever ce qu’il avait à dire. C’est ainsi qu’on sut avec certitude que l’Arche avait été cachée là. » À ce mystère dans le Talmud, répond le commentaire de Proust dans la Recherche, c’est-à-dire précisément les deux sentiments contradictoires éprouvés pourtant par la même personne.
Il y a beaucoup à dire sur la présence du Talmud dans la Recherche, comme d’ailleurs il y a beaucoup à dire sur la présence du Talmud dans ta propre œuvre, mon cher Pascal. Question qui en appelle forcément une autre, de mon point de vue : « Comment l’as-tu éprouvée, toi, cette vocation, comprise elle-même contradictoirement entre ce qui relève de l’étude, d’un côté, et de la littérature, de l’autre ? »
J’espère que nous aurons bientôt l’occasion d’en parler de vive voix.
Amitié. Patrick