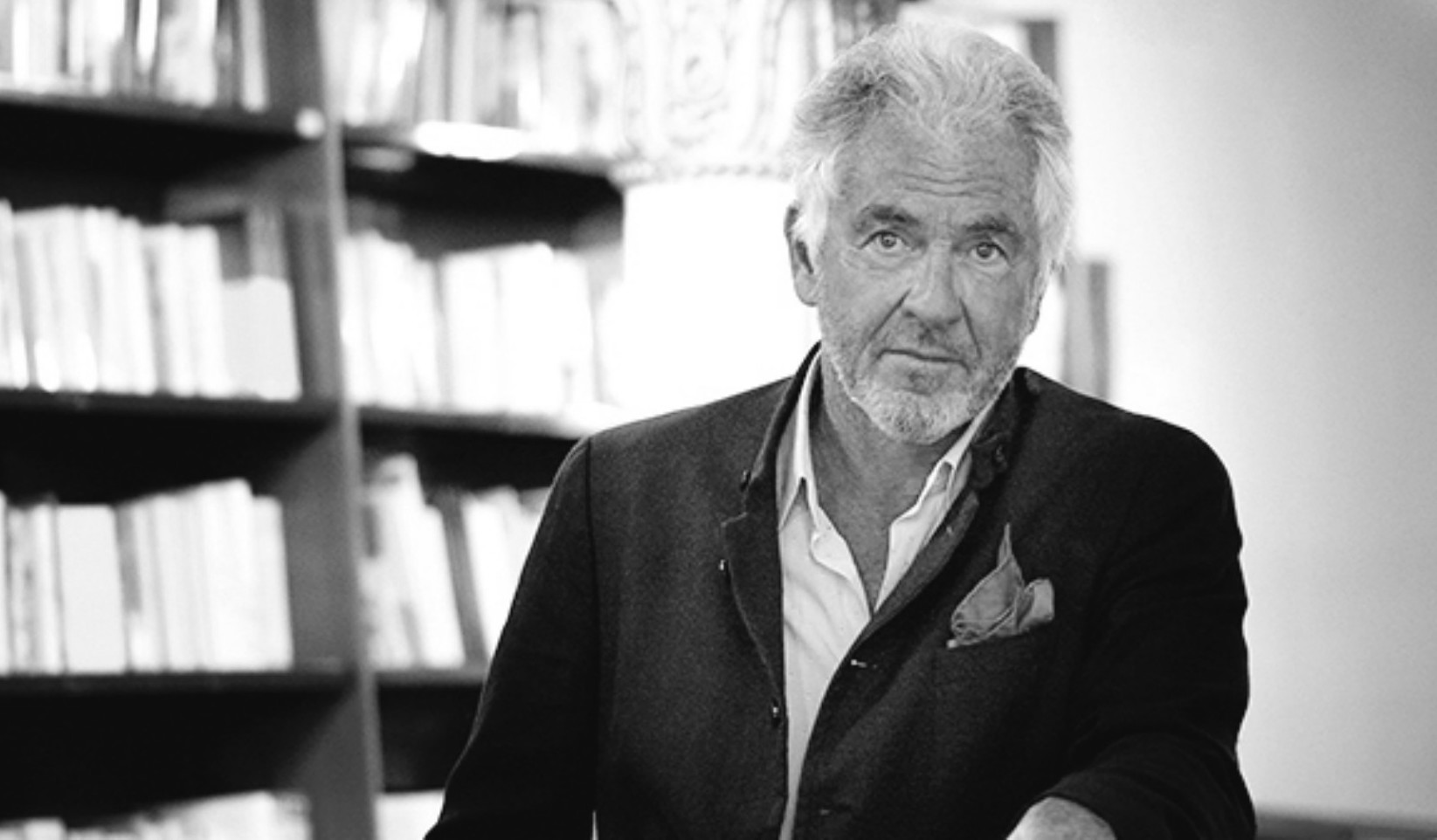La vie peut être aussi malveillante qu’une balle de tennis. Tentant de rattraper celle que lui expédie avec malice son ami Archi, mais dont il pressent dès le premier rebond la charge belliqueuse, en ce beau dimanche d’automne, Jean-Paul Enthoven perçoit instantanément la perte de repère, la vanité de sa course, l’instabilité de sa position, si chèrement acquise et défendue, la chute fatale qui l’expédie d’un coup au tapis, sur l’aire ocre et moelleuse de la terre battue.
Finie la frivolité dont il se rengorge et se délecte, filet de protection parant à ses fissures, à ses beaux échanges de séducteur sur le retour, qui n’abusent (et n’amusent) que lui-même, sans qu’il n’en soit dupe.
En un tournemain, le forcené du bonheur, l’ubiquiste obstiné, le chantre futile du beau geste et de la prose chantournée, qui se targue en souriant de n’être qu’un « imprimeur de papier », se retrouve allongé sur un billard à trois bandes dont il n’est pas écrit d’avance qu’il en sorte vainqueur.
Fini de rire !
L’heure des comptes a sonné…
Le play-boy en short, tombeur patenté, mondain énamouré, sportif accompli, accroc de ses performances, gît étendu sur le dos, nimbé de sueur froide, inerte et sans réaction, le thorax fendu en deux sur toute sa longueur, comme le bœuf de Rembrandt.
Le survivant en sursis, sans connaissance, sans âge et sans ego, ne sait même plus son nom. Tom Hanks, l’interne de service, insiste : « Je m’appelle… e,n,t,h,o… usiasme… » Quelle trouvaille ! Le livre en est plein. Il déborde de saillies, d’associations, de surprises et d’audaces stylistiques qui sont la sève de ce texte virevoltant, coloré et chatoyant, qui ne s’apparente à aucune des précédentes créations de l’auteur.
Déraillant à plein tube, la tête dans le brouillard, perdant les goût des convenances et le sens des usages littéraires, Enthoven lâche la bride consciente pour remuer la moire des sensations floues, nébuleuses, indécises, flottantes, qu’insuffle l’abord du néant, l’approche du grand saut dans le vide, le trou béant qui lui tend les bras et que tout le monde appréhende.
Il y est, les pieds dans l’au-delà, le cerveau dans l’ouate, les neurones dilatés par les narcotiques, la drogue et la morphine tandis qu’on esquinte son poitrail, sort le cœur de son enveloppe de chair, et puis non, l’y laisse, blotti au chaud, calé dans la poitrine.
Cela dure huit heures.
Evita, son grand amour à son chevet, le patient hagard, charcuté tel un coquelet, se sent partir au loin. Valve sciée. Aorte nouée. Rustine de porc. « Va falloir remettre un peu d’ordre dans tout ce bordel », assène, jovial, le Grand Ponte, plombier de l’âme intime.
Le p’tit Jean-Paul, dans le cirage, a le temps de revoir des souvenirs décrits comme des cartes postales éternisées, la Thunderbird de son père, un baiser volé comme chez Truffaut, le sourire de Sagan, qui couche avec Ava Gardner, bouffie d’alcool et de désespoir, à Courchevel. Qu’est-ce qui est vrai ? Inventé ? La vie elle-même a-t-elle existé ? Ce qu’on raconte est-il plus réel que ce qu’on lit, ressent, se rappelle ? Et le chapeau d’Aragon dans une rue d’Avignon, les initiales de Modiano qui sont les mêmes que celles de Marcel Proust, « son ancêtre protecteur », au souffle court, qu’il convie sur le court, sa mandoline servant de raquette.
Il confie ses regrets : acteur de cinéma, chanteur de variété comme Michel Berger, l’ami au cœur brisé, frère de sang, avec qui il se trouve un air de famille, au souvenir indissolublement lié aux allées du parc Monceau. « Michel a été mon premier mort. » Il en brosse un portrait aussi étonnant qu’émouvant.
« Avant de crever », il dresse la liste des choses qu’il faudrait encore réussir, rien de plus normal, confesse au passage son dédain des stoïciens (« des faux culs vertueux par défaut ») et, surtout, il reçoit ses amis, l’énergique Bernard, l’être vital, son autre frère, fougueux aventurier, qu’il appelle « LesVies » qui lui enseigne qu’il ne faut pas être prêt et déconseille fermement la fréquentation de la Dame Visiteuse, « la Mort salope », et de garder le cap du bonheur. Avanti ! A contre-courant des idées reçues, l’écrivain mort-vivant fait un éloge magnifique de cet ami fidèle ; superbe dialogue, le tutoiement ici n’est pas un vain mot.
Parmi ceux qu’il étreint, en nombre restreint, s’avance aussi son éditeur, Olivier, généreux, intègre et pessimiste, qui lui remonte les bretelles et prédit l’échec de son dernier roman : « Tu te balades chez les heureux du monde, dans un parc à la française, parmi tentures, jet set et bois doré… Ca, c’est plus possible. »
Au pilon, l’archange aux charmes archaïques.
Figure majuscule de ce livre éblouissant, celle de L’acteur Célèbre, non nommé, mais reconnaissable entre tous, installé dans la chambre à côté, ogre obscène et attachant, qui hurle, vocifère et drague les infirmières. Index pointé : « Je vais le mettre dans ton minou, après il sentira la pomme… ». L’auteur en personne se retrouve à ses côtés, en pantelant état ; Cyrano langé tel un marmot, Obélix plein comme une barrique d’hydromel, le Camion de Duras dans un fauteuil roulant.
Même mort, il reste le plus grand.
En 8 heures d’opération, et 4 semaines de clinique, on a le temps d’en faire des rêves, d’avoir des visions comme Fellini ou Goya, des délires, des songes et des apparitions comme celle, en état insomnieux, de la Vilaine Dame aux regard sombre, à la voix enjôleuse, mais sans faux, qui lui caresse la joue, puis le délaisse.
A plus tard, peut-être ?
La guérison est proche. Joyeux tintamarre du thorax. C’est bien le moins lorsque le cœur cesse de battre 155 minutes, montre en main, un record !
L’auteur reprend des couleurs.
La cicatrice à la Fontana le tient droit.
Valvule rapiécée, torse recousu au petit point (un Vermeer), buste raccommodé, gonflé à bloc, plus d’attaque que jamais, et très performant, sex included.
L’été revient.
Ce livre étincelant n’est pas un récit, un document, un témoignage, une tranche de vie, mais un morceau de choix, une fable fantasque et rieuse, une ode splendide à la vie, portée par une langue évanescente, tour à tour grave et légère, leste, enlevée, joyeuse et (très) drôle.
Il y a de la poésie dans ce tableau clinique, oscillant entre Bacon et Soutine. Sincérité sans défaut. Lucidité implacable. Vérité sans concession. Ironie au scalpel.
Revenu de loin, parti dans des contrées incertaines d’où l’on ne revient pas, Jean-Paul Enthoven a jeté tous ses masques pour revenir à lui-même et écrire ce livre unique par la forme, la langue et le ton qui n’existait pas.
Auteur de sa propre vie, délivré de lui-même, maître de la fiction, il fait de l’émotion une pure création du cœur et de l’esprit, ce qui donne raison à Jean-Luc Godard : « Il faut vivre les histoires pour les inventer. »
PATRICK ROEGIERS
Saint-Siffret, 30 septembre 2021.
Jean-Paul Enthoven, Les raisons du cœur, 201 p, Grasset.