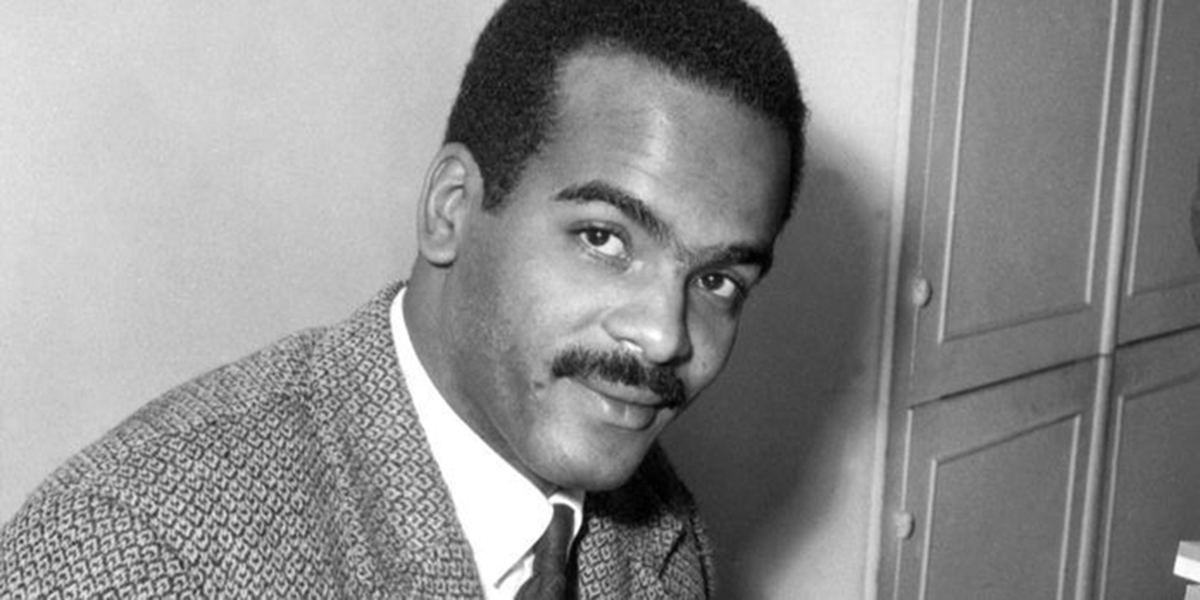« Rien ne m’engageait à une recherche sur ma filiation » annonce le narrateur, qui s’exclame : « Avoir un passé, soit, mais être son passé, non ! ». Au cœur de ce passé, comme un vide, un trou, l’histoire douloureuse du grand-père, depuis la Première Guerre mondiale jusqu’au début des années 1940, époque de sa mort. Ce jadis se confond avec la mémoire anonyme des patients de Sainte-Anne.
Fils de Beila et d’Abraham, Chaïm Mendel Noudelmann est âgé de 23 ans lorsqu’il participe à la Grande Guerre. Venu de Lituanie dans une roulotte pour gagner la France, il est admis à l’hôpital par l’assistance psychiatrique aux armées, après une exposition au gaz moutarde. Quelle est la vie de Chaïm ? « Les fous n’ont pas d’histoire », précise le narrateur. Mais que faire de ces vingt-deux ans à l’asile, de ces vingt-deux ans d’internement ? Entre histoire de la médecine, administration asilaire et épreuves psychiatriques des malades, le roman explore les troubles mentaux nés de la guerre et plonge dans les traumatismes causés par la Grande muette.
Après avoir traversé l’Europe d’est en ouest, après avoir connu les tranchées du nord de la France, Chaïm se retrouve au milieu des meurtris et des délirants. D’abord Sainte-Anne, puis Ville-Evrard, un pavillon de santé de banlieue, et transféré ensuite à l’asile de Cadillac, en Gironde, à partir de 1929. Cet ancien hospice fondé au XIVe siècle accueillait infirmes, miséreux et pèlerins. Traité pour syndrome mélancolique et hallucination auditive, Chaïm se trouve interné avec les étrangers, des Italiens et des Polonais. « Je l’imaginais dépressif », précise le narrateur, « car mon père évoquait les yeux tristes, l’air hagard d’un être déboussolé aimant contempler la lune ». Alors que Chaïm, mutilé du cerveau, est diagnostiqué incurable en 1926, il obtient la nationalité française par décret en 1927.
François Noudelmann raconte la vie dans ce lieu étrange, une cellule psychiatrique qui évoque le régime carcéral : occupations journalières, rares activités, accès au tabac ou au vêtement. Chaïm y est enfermé au pire moment, en pleine pénurie alimentaire. Telle Camille Claudel, morte de faim au bout de 30 ans d’asile, Chaïm meurt le 21 mars 1941, à l’âge de 50 ans, au bout de ses vingt-deux ans d’internement. Cette année-là, six cent six aliénés meurent à Cadillac, dans cet asile sordide et corrompu. Au milieu des docteurs et psychiatres, comme le neurologue Henri Claude, assailli du sentiment d’angoisse et d’abandon, loin de sa femme Marie née Schlimper, en Autriche, et de son fils Albert, Chaïm garde-t-il espoir ? A-t-il encore du désir ? Rêve-t-il ? « Aliéné, c’est-à-dire étranger aux autres et à lui-même, éloigné, sans lien. » Le roman fait ressentir l’être déraciné et hors du temps de Chaïm, qui mène une vie obscure, égayée par de maigres loisirs, comme un spectacle de musique ou une sortie dans le jardin de l’asile. Dans ce lieu disciplinaire, l’auteur imagine des rencontres fictives entre Chaïm Noudelmann et Antonin Artaud, diagnostiqué paranoïaque, ou avec Jacques Lacan, venu rendre visite aux malades : « Si j’étais écrivain, j’imaginerais bien une scène de rencontre, elle commencerait par une cigarette que Chaïm voudrait lui taper car Lacan ne se gênait pas pour fumer. » Enterré dans le carré des fous avec les prostituées et les vagabonds, abandonné au cimetière des oubliés, Chaïm est mort seul à Cadillac. Ni tombe ni sépulture.
Père affectueux, Chaïm donna beaucoup de tendresse au « petit Albert », le père du narrateur. Un jour, des années plus tard, pendant dix heures, Albert enregistre le destin de sa vie sur un petit magnétophone à cassettes, afin d’y déposer sa voix pour son fils et d’y faire le récit de sa propre vie. Jeune militant anarchiste dans l’entre-deux-guerres, Albert a vingt ans en 1936 et s’enrôle sous l’uniforme pour huit ans. Au milieu du combat, armé d’une mitrailleuse, le soldat Albert revit ce qu’a subi son père, vingt-trois ans plus tôt. Dans l’horreur de la guerre, Albert perd l’ouïe suite à l’explosion d’un obus. Fait prisonnier par les Allemands, il est emmené sur les routes de Belgique vers la Silésie, marchant entre vingt et trente kilomètres à pied par jour, mangeant des racines de pissenlit, buvant l’eau des ruisseaux. Arrivé au camp de prisonniers Stalag VIII C, dénoncé comme Juif par l’un des codétenus, Albert est exclu du baraquement des Français et subit les pires humiliations. Trompant la vigilance des miradors, il s’enfuit et prend le nom de Philippe Garnier, agriculteur, pour échapper aux ennemis. Capturé à nouveau, il est forçat dans une ferme agricole polonaise à Kotzenau. Le soir, les détenus chantent et jouent de la musique. Le narrateur évoque ce souvenir qui remonte à la surface au moment où son père le met dans la confidence : « Tu t’es levé, oubliant le magnétophone posé entre nous, et tu fais ton numéro de chanteur, avec une gaieté nostalgique. Lors de ces spectacles du camp, tu t’es tellement pris au jeu que tout le monde t’appelle désormais Antostome le chansonnier. »
Les souffrances de l’enfermement reprennent et Albert, avec deux amis Beti et Bertou, s’évade de nouveau. Les trois compagnons traversent les champs, évitent les patrouilles allemandes. Alors que l’Armée rouge gagne du terrain, et que la peur commence à changer de camp, Albert et son nouvel ami, Théo Le Guelaff, traversent l’Europe pour regagner la France d’abord en luge et en landau : « Vous arrivez en Tchécoslovaquie, et ragaillardis par ce passage de frontière, vous volez des bicyclettes pour accélérer votre course vers la liberté ». Comment sortir du chaos meurtrier et trouver une terre hospitalière ? La rencontre avec les troupes russes est une fête – « Franssouski ! Franssouski !, chantent-ils en écho, lyriques et fraternels ». Mais le répit est de courte durée, car des Allemands rôdent encore. La capture par un char Panzer est tragique : « Brusquement les SS vous mettent un pistolet sur la tête. Le cercle du canon s’imprime sur ton cuir chevelu et dessine le trou qui va perforer ta tête. » Echappant de peu à l’exécution, Albert finit son périple en voiture et à cheval. Entre désastre et espoir, l’épopée à travers la folie assassine de la guerre s’achève en découvrant la pancarte « Metz », synonyme de liberté.
L’arrivée à la gare de l’Est, la montée des marches pour sonner à l’appartement rue Duhesme et retrouver Huberte, son épouse ; le retour a un goût amer pour Albert, déçu : « Tu es dans un décor de théâtre et tu doutes de ton propre personnage. Tu ne te reconnais plus, ni ta ville, ni toi-même. » Les retrouvailles manquées, le père du narrateur sombre dans un mutisme mélancolique, sauvé un temps par l’amour : « Tu te réconcilieras avec la vie grâce à une passion amoureuse pour une femme qui deviendra ma mère. » Le malheur frappe à nouveau, et un 16 juillet, Albert se suicide, par balle.
De Chaïm et d’Albert à François, que s’est-il transmis de la judéité et de l’amour pour la France à travers trois générations ? « Français, je porte le prénom de mon pays, François désigne la qualité de français, françoué même, comme on le prononçait autrefois. » A l’enfance, marquée par la lecture des Pieds nickelés ou de L’Appel de la forêt par son père, le soir, au moment du coucher, ou par l’écoute de disques de Serge Reggiani, succède une vie de bohème, liée au vagabondage amoureux du père. Dans une écriture sensible et douce, François Noudelmann évoque ses souvenirs personnels. Sa plume se fait discrètement sartrienne, du côté de La Nausée – « Sans milieu, sans attache, nous étions une molécule robuste qui se déplaçait et se liait à d’autres corps » –, ou vers Les mots – « Le temps de l’enfance m’apparaît telle une superposition de durées éclatées ». La musique, qui le touche autant que les livres, conduit le narrateur à l’étude du piano, expérience essentielle dans sa vie. Une autre étape importante est son séjour de deux mois en Israël, l’année du bac, au kibboutz de Beït-Keshet. L’autogestion et l’égalité entre hommes et femmes unissent une jeunesse passionnée et libre. « La filiation cédait la place à l’alliance », et le narrateur se sent heureux dans « cette abbaye de Thélème sans religieux ».
Des années plus tard, devenu Professeur à l’Université – « agrégé de français, je l’annonçai fièrement à mon père », un séisme se produit à la fin de l’année 2008, qui fait prendre conscience au narrateur de l’existence de sa judéité. Lors d’une manifestation à Paris, les cris de « Mort aux Juifs » dans la foule glacent le sang et figent le narrateur. « Quelque chose d’inimaginable s’était glissé dans les oreilles des Parisiens. Je pensai alors aux Noudelmann qui avaient dû porter l’étoile jaune à Paris […]. Leur anxiété ou terreur me devint soudain plus proche et tangible. Soixante-cinq ans après, sur les boulevards de la capitale, on pouvait entendre de nouveau la haine des Juifs. »
Résidant désormais à New-York, le narrateur saisit le point d’origine, qui le relie à son père et à son grand-père : le besoin de partir, une disponibilité à se déplacer, à accepter les mondes et leurs différences. Vivre sans programme, être libre et sans attache, pour ne pas étouffer ni demeurer trop longtemps : « Se rendre perméable à l’inconnu, vivre hors de soi, être dérouté par des affinités imprévisibles, ainsi vont les errants, juifs ou non. »
Alors que Chaïm, au début du XXe siècle, quitte les pays baltes pour venir en France, cent ans plus tard, son petit-fils termine le parcours, traverse l’Atlantique pour réaliser son destin d’émigré juif aux Etats-Unis. Autre terre d’asile.
François Noudelmann, Les enfants de Cadillac, éd. Gallimard, 225 p., 19 €.