Christophe est mort. Si Polnareff est Dieu, Christophe était le Christ. D’où son nom. Nous attendrons sa résurrection. Nous devions nous voir. Nous étions de ces amis qui, comme le jour et la nuit, ne se voient jamais. Nous tournions autour de l’autre. Nous n’osions pas. Je ne connaissais de lui que ce que tout le monde connaît, et réciproquement. Sans doute, alors que nous attendions chacun de notre côté que ce soit l’autre qui appelle le premier, nous contentions-nous de savoir que nous étions là, vivants. Mais Christophe n’est plus vivant : il est mort.
Si Polnareff est américain, Christophe était anglais. Il avait appris le chic londonien comme on apprend la mécanique, le solfège ou l’albanais : ça ne coulait pas de source ; ses origines ne le prédisposaient pas à devenir anglais. Le Frioul et Juvisy, au mitan des années cinquante, produisent plus volontiers des garagistes et des maçons. Christophe a donc dû inventer sa vie, un peu comme ces mythomanes qui, après avoir annoncé leur gloire, décident finalement de l’embrasser, de la déclencher, de la faire advenir pour se simplifier la vie.
J’aurais dû l’appeler en octobre, lorsqu’il a laissé à une amie commune le soin de me transmettre son numéro de téléphone ; je gardai le numéro à la fois comme une aubaine, une possibilité et un talisman. Il m’assurait de son soutien parce qu’il savait que je traversais une période difficile ; Christophe voulait s’assurer que j’allais bien. Il y a, dans cette génération, qui est celle aussi de Michel Polnareff, un rapport à l’amitié qui est dur comme l’acier. On ne juge pas ; on essaie de comprendre. Christophe n’était pas tombé dans le panneau.
Christophe eût pu faire partie des Beach Boys ; cette voix de gospel, de satin et de sépulcre, cette voix de caresse et de lune, d’oscillations diaphanes et de coulée de diamants ; Christophe chantait comme un cierge qui vient à peine de s’allumer ou de s’éteindre – c’était une nuit à lui seul, une chapelle solitaire et bleutée. Il semblait opérer, avec ses longs ciseaux, quelques découpages dans le silence. Il faut l’imaginer la nuit (la nuit était pour lui un pays, une contrée, sa véritable nation, sa seule patrie) à découper tout et n’importe quoi dans des magazines, pour faire des collages – ces mêmes collages qu’il pratiquait sur ses consoles et ses synthétiseurs. Christophe n’était pas un homme d’improvisation ni d’improviste. C’est pourquoi il préférait la nuit au jour et le silence au bruit : pour leur perfection.
Méticuleux, maniaque, infiniment patient, Christophe, tel Brian Wilson, pouvait descendre dans sa crypte, son bunker interdit et nuiteux, pour chercher un son. Parfois, au bout de cinq ans, de dix peut-être, il le trouvait. C’était un fa dièse doté d’une larme, un ré bémol sorti d’un cri d’enfant – il avait trouvé l’intonation qu’avait cherché son génie. Alors, ce son, il n’avait plus qu’à l’étirer, à le manipuler dans son laboratoire, mélangeant les apocopes et les harmonies, travaillant ses mélodies comme Thomas Mann à ses gros romans.
J’aurais dû aller le voir, dès décembre, sonner à sa porte et partager avec lui de la fatigue et des heures lentes, jusqu’à ce que le petit matin vienne nous piquer les yeux comme une épingle. Nous aurions écouté notre musicien préféré, Robert Johnson, du blues du Delta – cette musique lavée de toute scorie, épurée par la sueur et la souffrance, cette musique acide et déchirante, artisanale et aussi pleine de firmament qu’une sonate de Mozart. Celui qui aime la nuit aime le blues de Noirs qui pleurent. Il y a une mystique de la nuit blanche – derrière ses lunettes fumées, Christophe refusait de regarder la réalité avec ses vraies couleurs, parce qu’il savait la laideur des choses et des hommes. Tandis que la nuit, pour lui, c’était comme si tous les hommes étaient morts ou bien gentils : il était épargné, seul dans l’univers, débarrassé du temps qui passe, cette hérésie qui ne devrait s’appliquer qu’aux brutes, aux adultes, aux salauds, trois catégories si souvent confondues. Christophe était un enfant : aller se coucher le soir, c’eût été affronter le noir et le néant qui habite dedans. Il faut toujours se méfier du sommeil : il peut nous emporter avec lui, pour toujours.
Christophe s’était, alors, créé un monde sur mesure et un temps à part. Il y régnait comme un satrape yéyé, au courant de tout, mais retranché. Retranché dans les souvenirs du ciel souvent bleu des sixties, appelant Aline sur sa plage ; ce tube a tout ravagé simplement parce que c’est un tube proustien. La plage rappelle celle des petits amoureuses, celles qui à Balbec s’ébrouent dans les flots et courent sur le sable, la peau frottée par le vent. Mais la chanson évoque aussi l’amour enfui, celui qui ne revient que pour nous agonir de coups dans le ventre, au réveil, quand nous avions, l’espace d’une sieste, oublié la rupture. Aline ne reviendrait jamais, nous le savions bien. Christophe ou Swann chez les Beach Boys.
Christophe chantait aussi magnifiquement qu’il s’exprimait mal. Toute son épure musicale, dans les interviews, se transformait en une cacophonie que les timides connaissent bien. Il était également complexé, comme ces autodidactes qui finissent par se convaincre que l’intelligence rime avec la scolarité et la réflexion avec les diplômes. J’en aurai croisés, dans ma vie, des êtres à l’intelligence suraigüe qui eussent tout donné pour avoir la preuve (scolaire, universitaire) qu’ils valaient quelque chose. Le plus souvent, sans aucun souci de vengeance, mais avec la foi de ceux qui se sentent une légitimité à exister quand même, ils compensent ce qu’ils intitulent leurs lacunes par une sensibilité extrême, une curiosité infinie, une ardeur magnifique au travail.
Christophe avait, dans sa manière de s’exprimer, cette hésitation perpétuelle de ceux qui eussent voulu être géniaux dans un autre domaine que le leur – il se sentait relégué dans la chanson ; c’est alors qu’il avait décidé d’en faire une transcendance. D’une chansonnette, d’un petit air avec ses dérisoires et anodines petites paroles, on pouvait faire un monument – de beauté, de pureté, de subtilité. On pouvait passer deux ans, trois ans, à peaufiner l’intro, à lisser la sonorité des mots, à faire sonner la fin du pont, à adoucir la mélodie, à affermir les chorus. Il s’agit donc, pour lui, soudain, de rendre infiniment sérieux quelque chose qui ne pouvait décemment pas l’être. Michel Polnareff, les Beatles, les Beach Boys, Christophe : la famille de ceux pour qui l’univers entier doit pouvoir pénétrer dans une chanson ; la famille de ceux pour qui l’approximation est une insulte, une démission, un suicide.
La chanson n’est pas simplement une plaisanterie. Qui se souvient de qui occupait Matignon quand sortit Aline ? Qui se souvient de qui dirigeait l’Allemagne à la sortie des Mots bleus ? J’aimais, chez Christophe, l’importance qu’il plaçait dans une ritournelle, le soin qu’il mettait dans ses compositions. Daisy, les Paradis perdus, comme tant d’autres, comme presque toutes les autres, sont des chansons « fractales » : chaque fragment du morceau ressemble à sa totalité. Christophe a élaboré une mathématique de la variété – c’était un fou de cohérence interne. C’était un logicien. Un logicien des larmes.
Il donnait l’impression de composer des théorèmes, donnant la sensation qu’il n’avait pas créé ses mélodies, mais qu’il les avaient découvertes. C’était un compositeur platonicien. Les Mots bleus existaient avant lui : il n’avait fait que les extraire de leur éther. J’ai d’ailleurs toujours pensé que Christophe n’avait qu’un air dans la tête, un seul, et qu’il avait passé toute son existence, toute sa carrière à tourner autour. A la recherche de la chanson bleue, comme on désire accoucher, en blues, de la note bleue. Tous ses morceaux sont une approche, une esquisse, une quête du morceau qu’il voulait découvrir et sans arrêt lui échappait, ainsi que l’arc-en-ciel échappe à l’enfant qui veut le toucher.
Les productions, les œuvres, les compositions de Christophe ne font pas partie du même monde que nous : elles semblent n’avoir été commises pour personne, et presque par personne, livrées dans leur gratuité insondable et leur écrin spécial, souillées d’aucune critique ni d’aucun applaudissement. Christophe a construit une cathédrale de verre, un assemblage cristallin et virginal, un monde de neige inviolée, une discographie insouillable. Ses opus sont immaculés. Quand je l’écoute, je comprends que je n’étais pas censé l’écouter ; que cette musique était d’une certaine façon faite pour rester seule avec elle-même, dans les ondes concentriques d’un univers totalisé : le studio de Christophe enveloppé de nuit.
Ses chansons sont inimitables. Celui qui voudrait « en faire autant » serait immédiatement frappé de ridicule. On reconnaît les géants à ce que, repris par d’autres, pastichés par d’autres, incarnés par d’autres, leurs créations deviennent creuses et risibles. Un compositeur moyen peut être interprété par n’importe qui : cela sonnera toujours à peu près comme l’original. La déperdition n’aura pas été très importante. Chez le génie, il en va autrement : on ne peut reproduire la part de risque qui a été la sienne quand il a décidé de pousser le courage, la folie, l’outrance et le scandale (bravant justement la peur du ridicule) jusqu’à être lui-même. Etre soi, rien que soi, soi et personne d’autre : voilà qui est une percée dans le monde, un remue-ménage, un événement – un avènement. Répliquer un avènement, recommencer une naissance, c’est fossiliser le mouvement, assécher l’océan ; et c’est vider l’originalité risquée du départ pour la conformer à une nature, un style qui n’est pas, ne pourra jamais être son écosystème. La Joconde serait ridicule recommencée au feutre et placardée dans une station-service. Reprendre du Christophe (ou reprendre du Polnareff) cela s’apparente à du détournement de génie, comme on parle du détournement d’un avion. C’est faire dépérir un edelweiss en le plantant dans son jardin.
Christophe aimait les voitures de sport et rester chez lui. J’ai toujours été fasciné par les êtres de confinement collectionnant les moyens de transport, les cloués amassant les bolides, les sédentaires s’offrant les jouets de l’évasion nomade. Mais c’est qu’il savait la perfection des beaux modèles, l’amour du travail bien fait que recelait ses carcasses fines et arrondies ; il savait comment le vent se modelait aux chanfreins, comment les formes, les voussures, les arabesques de la carrosserie sculptait le mistral et l’aquilon.
Il avait décidé, enfermé parmi ses découpages, que la réalité n’existait pas ; Et il avait bien raison, parce que tel est le cas. Comme il y a un Dieu par personne, il y a une réalité par personne. Le réel est une farce ; nul n’est contraint de s’y livrer. On oublie trop souvent que la vie humaine n’a pas à se conformer aux injonctions de la société, de la mode, ni même de l’histoire en train de se faire. L’actualité n’a de sens que celui qu’on lui donne. Il se passait peut-être davantage de révolutions dans une seule nuit de Christophe que dans une année du monde. La liberté est un don. Il faut en user sans s’excuser, sans se laisser asphyxier par le dehors, qui est aussi une fiction. Au lieu de saturer l’espace du discours, Christophe sera resté ébloui jusqu’au bout, seul avec sa paire de ciseaux à la main – se demandant bien ce que pouvait faire la mort, pendant ce temps.






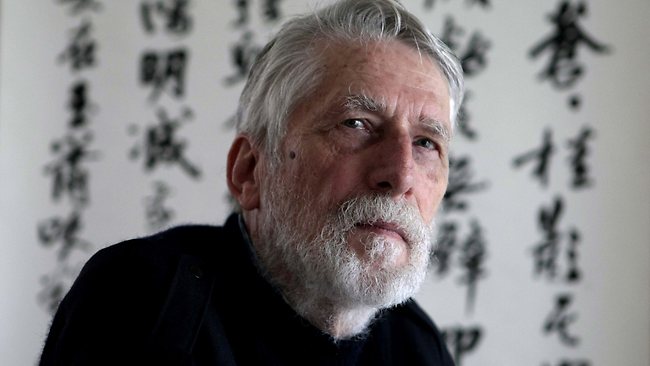

Je retiens que vous l’honorez … Et ça me convient vraiment. Merci à vous.
Vous traduisez bien la fragilité et la force de cet immense artiste qui nous laisse un grand vide. Et en ce moment cela est encore plus marquant …
Bien à vous.
Beau texte mais pas d’accord sur « il s’exprime mal »
il « s’exprime mal »car il ne parle pas comme tout un chacun, dans le sens courant. C’est heureux . Lacan parle du « disque courant ».
A voix nue sur France culture, il faut l’écouter parler de son travail, même s’il croit ne pas savoir en parler. Il y a de multiples perles …
ce soir : » une belle inconscience » .
Le plus bel hommage encore jamais écrit sur cet artiste…
Chaque article de Yann Moix est un coup de poing. On en reste sonné, émerveillé…
Le Christ est unique, cessez vos parallèles toxiques et usurpés ! Merci.
Ma grand-mère aussi !
Bonjour,
Paix à son âme, votre hommage est sincère.
Je dis toujours l’Artiste ne meurt jamais.
Saïda
« Christophe chantait comme un cierge qui vient à peine de s’allumer ou de s’éteindre. » Il y a dans ce texte plusieurs phrases comme celle-ci, des phrases qui contiennent en si peu de mots presque tout.
A vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce a vous retirer du jeu… Merci
QUEL HOMMAGE A CHRISTOPHE ! MERCI YANN
Très bel article. Mais… Christophe était auteur-compositeur et chanteur français. Avec toutes les nuances et les subtilités de la création française.