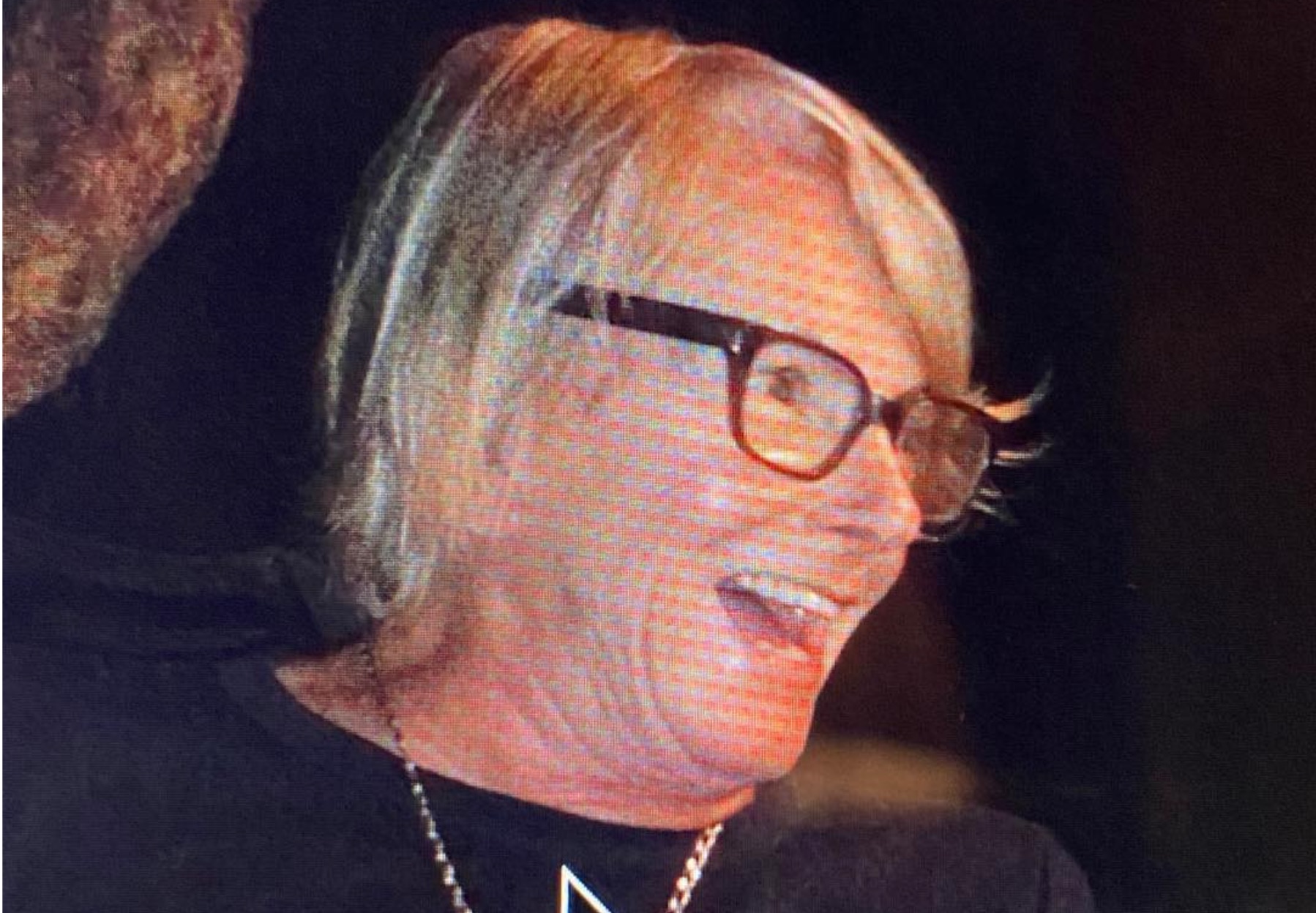Roger Vailland, à la date du 16 août 1964, écrit dans son journal : « Jean-Claude Fasquelle et Nicky, j’aime qu’elle rie fort et parle italien avec l’accent rude du Tyrol, que son père soit géant et que sa mère blessée lui téléphone de Rome toute la journée. » J’aime, moi, que l’ami de Roger Gilbert-Lecomte et de René Daumal, ait été l’ami de Nicky. Ce qu’il retient d’elle, et que je retiens, c’est ce rire. Un rire qui perforait le silence et giflait la bêtise. Nicky n’était pas la femme de Jean-Claude Fasquelle ; c’est Jean-Claude Fasquelle qui était le mari de Nicky. Elle était d’abord un laser : les êtres défilaient devant elle, qu’elle déshabillait de son acuité. Ses jugements, toujours excessifs, étaient paradoxalement d’une justesse de fléchette. Elle piquait la cible dans le mille ; les cuistres n’étaient pas son genre. Son rapport à la vie était fait d’alcools forts, d’émotions plus fortes encore, de quelques bouteilles de vin célèbre, de fulgurances imprononçables en large comité et de saillies incorrectes. Mais, surtout, elle aimait la littérature ; elle la vivait comme un événement. Les mauvais livres lui donnaient des envies de tuer ; les grands livres, un besoin d’admirer. Elle n’avait pas son pareil pour n’être pas d’accord avec vous. Elle adorait vous prendre en flagrant délit de trahison avec vous-même. Elle exigeait de la fidélité : mais d’abord de soi à soi. Celui qui déviait vers la facilité, la démagogie, le bâclage ou le cirque prenait une engueulade au bourbon, ou à la prune qui cogne, puis était achevé de plusieurs rafales d’un rire qui ne rigolait pas. Quand mon téléphone sonnait et que le nom de Nicky s’affichait sur l’écran, c’était soit pour une invitation, soit pour un savon. D’ailleurs, quand elle me complimentait pour un article (rien ne lui échappait, elle voyait tout, lisait tout) son ton était le même, à la virgule près, que celui des engueulades. Ne savait-elle pas féliciter ? Ou bien ne savait-elle pas vilipender ?
Ce que je sais, c’est qu’il ne fallait jamais faire l’erreur, avec elle, de n’être pas soi. Les imposteurs, les crâneurs : dehors. Elle préférait qu’on se radinât chez elle avec une chaude pisse plutôt qu’en compagnie d’un pisse-froid. Elle eût décapité celui qui gâchait l’un de ses dîners à la truffe : elle seule avait le droit de bavarder ; et c’est vrai qu’elle mitraillait du verbe. Elle en envoyait des phrases. Mais c’étaient d’étonnants solos, tantôt de guitare, tantôt de batterie – jamais de violon, rarement de piano. Quant à la mandoline : au feu, avec les triturations romantiques et les problèmes de cœur, qu’elle ne prenait pas au sérieux. « Toi, tu nous emmerdes » me balançait-elle si me saisissait l’obscène tentation de me plaindre, dans son gilet éclaboussé de rhum rare, d’une millième rupture. Puis son rire éclatait, comme les cymbales d’un clown. L’amour, pour elle, ce n’était pas des lettres romantiques et des pleurnicheries : c’était être assise à côté de Jean-Claude, dans l’avion, ou sur leur canapé, ou sur un bateau devant la mer qui finissait tôt ou tard par l’emmerder.
Sa couleur de prédilection n’était pas le bleu du ciel ni le vert des flots ; c’était le jaune d’œuf, celle de la magnifique couverture des éditions Grasset, qui était sa vraie terre d’asile, son lieu de rencontre, et finalement le centre de toutes ses aventures. Sa scansion était secouée, le débit de ses paroles soutenu, et sa cervelle fonctionnait comme une usine à charbon à deux doigts d’exploser ; combien d’idées, plus ou moins folles, souvent horriblement nouvelles, sortaient de ce crâne qu’aucun cliché n’encombrait jamais. C’était une hippie doublée d’une grande bourgeoise, le tout enrobé dans la psychologie d’un punk. Elle ne tombait dans aucun panneau. Les modes, elles les avaient inventées avant qu’elles ne nous accablent. Pour elle, le féminisme n’était qu’une étape sur le chemin de la femme, le simple étage d’une fusée. Les femmes méritaient mieux que ça. Ce qu’elle adorait, par exemple, chez son amie Benoîte Groult, c’était tout sauf son combat féministe. Elle adorait les gens pour leurs qualités non-officielles.
Elle faisait semblant d’aimer les écrivains malgré leurs œuvres, ou en dehors d’elles, mais c’était une astuce ; elle avait le goût trop sûr pour faire une distinction proustienne entre le moi social et le moi créateur. Elle savait bien que les vrais écrivains sont des enfants et c’étaient du coup les siens, elle qui n’en avait biologiquement pas eus. Mais si je lui avais dit « Nicky, je te considère comme ma mère », elle m’aurait répondu (je vous le signe) : « Ah non ! Parce que si j’étais ta mère, je t’aurais filé une gifle pour ce que tu as dit l’autre jour à la télé ! Et je n’ai pas envie de te gifler ! Donc je ne veux pas être ta mère ! »
Son sujet de conversation favori était Jean-Claude Fasquelle ; et le sujet préféré de Jean-Claude Fasquelle était Nicky. Ils étaient les biographes l’un de l’autre. Mais rien ne coïncidait jamais dans les versions qu’ils donnaient de leurs souvenirs. Les deux disaient la vérité pourtant. Jean-Claude avait créé une Nicky idéale – et la Nicky réelle venait détruire cette interprétation trop poétique de l’événement. Nicky donnait aux souvenirs de grands coups de réel ; elle n’embellissait pas : elle cherchait, dans toute situation, non pas le panache (ça c’était le rôle de Jean-Claude) mais le ridicule, le risible, le pathétique. Pourquoi ? Eh bien parce que tout, je dis bien tout, devait être prétexte à venir poser son long rire sonore derrière, la seule véritable ponctuation qui pour elle en valait la peine. Rire, rire, rire.
Son pire ennemi, après la cuistrerie, la prétention, le manque de talent, la sobriété et la lâcheté, était l’esprit de sérieux. Non pas tant l’ennui, qu’elle ne connaissait pas ou qu’elle avait pour habitude de faire raccompagner à la porte de son jardin, mais l’esprit de sérieux : ce qui pèse, ce qui alourdit, ce qui s’enfonce dans la terre ; le granitique, le rocheux, le sédimentaire. C’était pour elle un rapport à la vie fait de prudence, de calculs et d’épargne. Elle avait en horreur (je dis bien : en horreur) ceux qui épargnaient et ceux qui s’épargnaient – parce que, pensait-elle, ce sont les mêmes. Elle était pour la dépense, sinon pour la débauche. L’esprit de sérieux, pour elle, c’était Coluche ; l’esprit de déconne, c’était Umberto Eco.
Elle haïssait la rétention, la contention : il fallait lâcher les chiens, ne jamais se laisser impressionner par un Ministre, un Président, un Prix Nobel « de ses deux » ou un académicien pompeux. Ce qui ne la faisait pas marrer n’existait pas. Mais attention : elle ne supportait pas les humoristes. L’humour ne pouvait pas, dans son étonnante et burlesque vision du monde, être une profession : l’humour, à son goût, était précisément ce qui ne se préparait pas, ne se travaillait pas, ne s’anticipait pas – c’était la part de l’individu qui relevait son esprit d’à-propos, sa générosité, sa vivacité, son écoute. L’humour ne devait qu’être au service de l’instant présent, comme le verre de poire ou de whisky, dans la gratuite et profonde communion des amitiés solides.
Plus une amitié était forte, plus les alcools servis l’étaient. On arpentait les degrés de liqueur comme les étages de l’intimité. Certains sont restés à la petite bière toute leur vie – le salon « mexicain », où trônait un buste de Zola (il y trône toujours) était le laboratoire des affinités. C’était le salon d’essayage des complicités. Celui qui jouait un personnage le jouait pour la dernière fois : soit il n’était plus jamais convié, soit il se délestait de sa panoplie. C’était là, dans ce salon bourgeois et grunge à la fois, ordonné et bordélique en même temps, que Nicky faisait l’éloge d’une jeune écrivain (elle n’aurait pas supporté que j’écrive « écrivaine ») de 22 ans qu’elle venait de découvrir et démolissait le pensum d’un nobélisable. C’est là qu’elle disait, les yeux dans les yeux, à un « géant » des lettres que ça faisait un moment qu’il ne se foulait pas et que ses derniers livres sentaient l’escroquerie et c’est là qu’elle encourageait un nouveau-né des lettres à persévérer.
Ce qu’elle chérissait par-dessus tout, avec le cognac et la liberté, c’était son Magazine littéraire. Sa fierté. Nous avons eu mille conversations à ce sujet. Ayant lu tous les numéros entre 10 et 15 ans, je ne pouvais lui faire de plus beau cadeau, ni lui rendre de plus bel hommage qu’en lui récitant, dans l’ordre, les thèmes des numéros, mois par mois et année par année, commentant les superbes couvertures de Moretti. Raymond Moretti, ce génie, qui avait accepté d’illustrer tous les numéros, pendant plus de trente ans, gracieusement, parce qu’il savait que le magazine n’était pas très riche. Il l’avait fait pour Nicky. Par respect, par amitié, par amour pour Nicky.
Nicky assurait une permanence : celle de ceux qui ne meurent jamais. J’aimais la savoir là – avec Jean-Claude. Comme Laurel et Hardy, ils allaient (ils vont) par deux. Sa disparition est une catastrophe et un scandale. L’usine qui produit de tels êtres a fermé ses portes depuis belle lurette. C’était le 20e siècle. Nicky était l’héritière, et l’incarnation, parfaitement honnête, intègre et décomplexée, d’une époque qui lisait, qui se passionnait, qui prenait de monumentales cuites en plein après-midi, qui donnait sa chance aux gens, qui fumait, qui roulait sous la table, qui partait à l’autre bout du monde sur un coup de tête, qui possédait des flingues et avait des amis qui couchaient avec des singes, qui possédait des biffetons dans les poches, lisait les classiques de la littérature et fréquentait l’avant-garde. Pour Nicky, les grands écarts n’en étaient pas : tout ce qu’elle faisait, tout ce qu’elle aimait ne faisait qu’être l’expression d’une personnalité, d’une singularité, d’une liberté.
Elle lisait Zweig et finançait Pacadis, gourmandait Gabriel Garcia Marquez et faisait rire Philippe Manœuvre, recevait dans la même journée les confidences de Mitterrand et celles d’Yves Adrien, hébergeait à la même époque Kleber Haedens et Daniel Cohn-Bendit, snobait Giscard et déconnait avec Despentes, évacuait Houellebecq en cinq minutes et évoquait Thieuloy pendant deux heures. Elle ne médisait jamais : sa médisance se faisait en présence des intéressés. Ce qui n’est plus de la médisance, mais du respect. Et ne disait pas « de mal » : elle tuait une fois pour toutes, pour ne pas voir sa victime souffrir. Dès qu’on clamait son admiration pour un auteur, elle lui faisait dégringoler quinze étages – non pour le salir, non pour l’insulter (lui ou sa mémoire), non pour le souiller, mais pour remettre les choses à leur place, pour ne pas qu’on s’aveugle sur la véritable valeur des êtres. Elle fuyait les salauds et leurs livres.
Mais elle ne fuyait jamais les enterrements de ses vieux amis abandonnés, des écrivains de chez Grasset, ou d’ailleurs, qui furent au sommet un temps puis avaient doucement décliné dans les saisons. Elle traversa plusieurs fois la France pour se rendre, avec son Jean-Claude, aux obsèques désertes de tel ou tel (je pense à André Stil, à quelques autres). D’aucuns pouvaient, peut-être, trouver Nicky insupportable : pour moi, c’est sa mort qui l’est. Insupportable ? Jamais. Fiable, toujours. Cachant avec une impensable pudeur ses cicatrices et ses démons. Elle avait sa part de fantômes et de trous noirs – elle les gardait pour elle ou pour Jean-Claude. Elle ne faisait partager à ses hôtes, à ses amis, que ce qui pouvait, je le répète, être ponctué par ce fameux rire – un rire qui devrait être homologué, à son nom, comme le grand pâtissier baptise un dessert de son patronyme.
Nicky, au demeurant, était d’abord un prénom. Maria de França, 18 ans, fraîchement arrivée du Brésil m’avait soufflé, au salon du Livre de Bordeaux, en 1997, lors d’un dîner Grasset : « Il est génial, le copain de Nicky ». Quand je répétai cette saillie à l’intéressé, je le vis rougir de fierté, de bonheur et de plaisir : être ainsi qualifié, de l’extérieur, par quelqu’un qui ne le connaissait pas par ailleurs, et ne l’avait perçu qu’ainsi, était le plus beau compliment qu’on pût lui adresser en ce bas monde. De ce jour, il éprouve pour Maria une indéfectible affection. Mais aujourd’hui, c’est « la copine de Jean-Claude » qui s’en est allée. Bizarre. S’il y a quelque chose qui ne lui ressemble pas, c’est bien la mort. J’ignore si elle la craignait vraiment (sans doute que oui), mais la mort n’était pas son genre. Il y a dans cette disparition quelque chose qui cloche ; cela ne tient pas simplement du scandale, ni de l’injustice, ni de la tragédie, mais de l’erreur de casting. Il y a là comme un malentendu. La mort s’est trompée ; ce n’était pas vraiment Nicky qu’elle voulait – elle s’est fourvoyée. La mort est allée là où elle n’avait rien à faire.
L’agonie de Nicky a duré une semaine : sensation de voir un être cher, au large, au milieu des requins. Impossibilité d’intervenir. Totale impuissance. C’est un cauchemar. Ce matin, dans cet avril qui n’en est pas un (les dates se mélangent, dans ces temps de virus qui osent assassiner quelqu’un comme Nicky Fasquelle), je lui ai misérablement dédié mon footing. J’ai couru, près des Champs-Elysées, comme chaque jour, autour d’un parterre auquel j’ai donné le nom de « Nicky Fasquelle ». Je lui ai offert et dédié mon point de côté, mes courbatures, mes douleurs de genoux et mes efforts. Je lui ai offert, comme si j’avais prié, ces cinquante tours de piste dérisoires. J’ai fait avec ce que j’avais. Quant à cet hommage, qui ne lui aurait pas vraiment plu, elle l’aurait regardé vite fait, « Hé ! Tu nous emmerderais pas un petit peu, là, avec ton violon ? ». Et elle aurait ri fort, comme le 16 août 1964 avec Vailland.