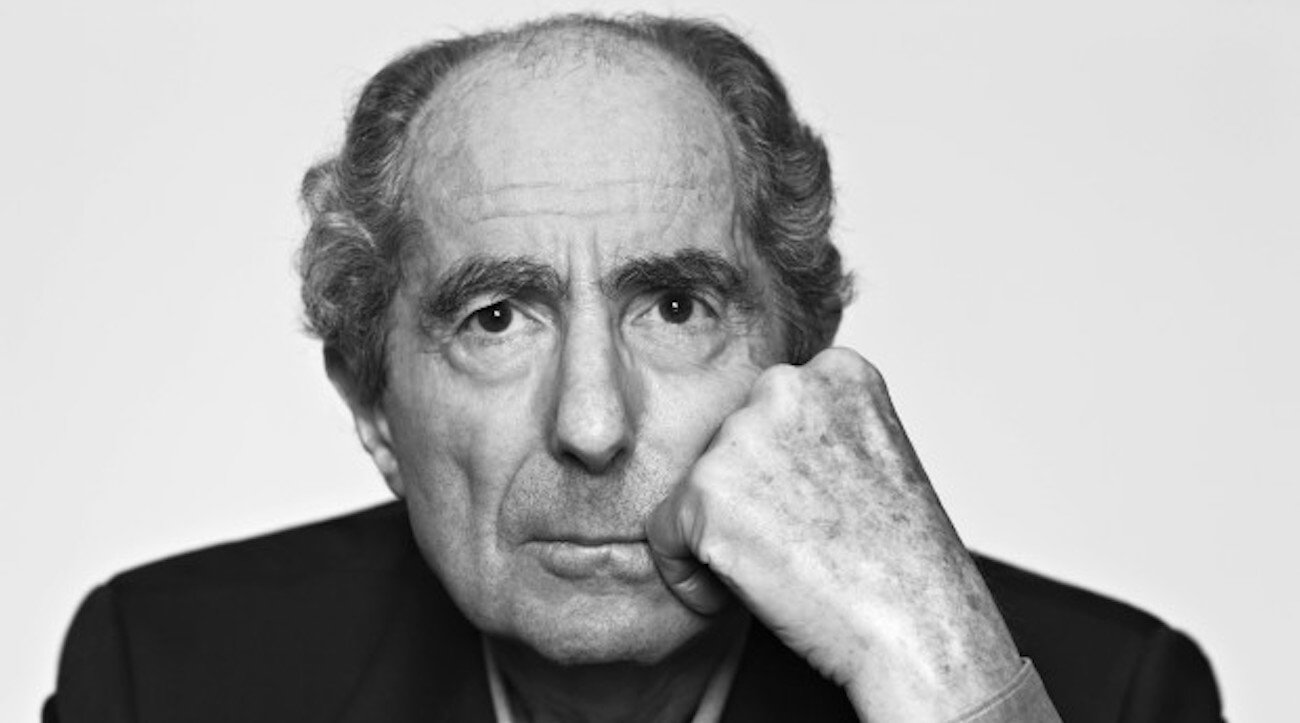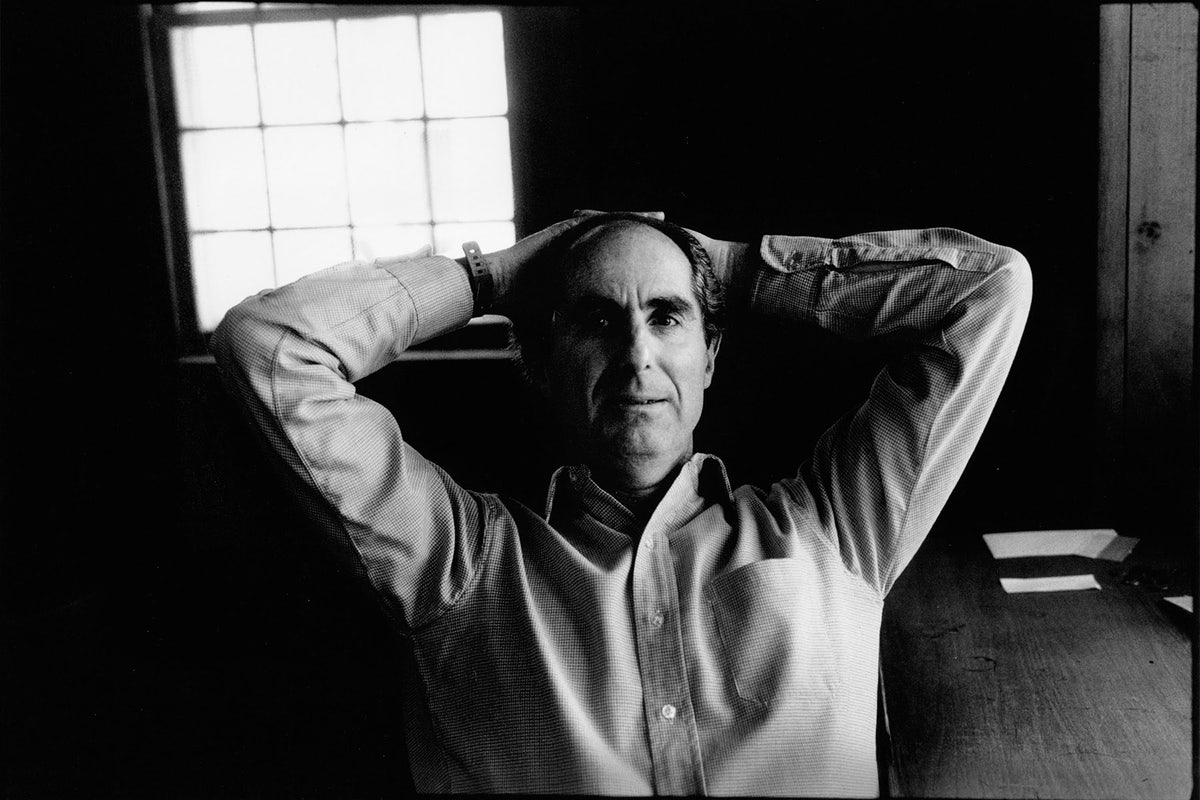Philip Roth adorait accorder des audiences papales, et le jour de l’intronisation de Trump, j’ai emmené chez lui Bernard Henri Lévy qu’il ne connaissait pas. Ces deux hommes, l’un français et l’autre américain, étaient deux magnifiques représentants de l’intellectuel juif. Ayant longtemps vécu, comme le dirait Boswell, dans l’intimité de l’un et de l’autre, j’avais eu à cœur de les réunir – mais j’étais aussi sur mes gardes, car si chacun à sa manière était un parfait représentant d’une forme juive de l’intelligence, l’une française et l’autre américaine, je savais qu’ils étaient radicalement différents. Alors qu’ils avaient tous les deux un immense respect pour les études et qu’ils partageaient les mêmes valeurs libérales, le style de Philip, je le savais aussi – car nous possédions cet héritage en commun – était avant tout comique. Une blague, un shpritz, une remarque qui allait droit au but – tel était pour nous le matériau naturel de toute sociabilité, de toute conversation entre amis. Pour Bernard, la conversation se devait d’être sérieuse – on échangeait des références philosophiques, on faisait ressortir un domaine de connaissance commun, on lançait une référence acerbe à ce que Heidegger avait écrit sur ce que l’on devait ou non qualifier de pensée, et au bout du compte, on arrivait enfin à une certaine complicité intellectuelle. En France, ce n’était qu’au terme d’une conversation sérieuse que l’on pouvait enfin parvenir à ce stade ultime de l’intimité qui consiste à échanger en toute confiance, une plaisanterie ; en Amérique, l’intellectuel juif passait par l’échange de plaisanteries pour parvenir à l’éventuelle intimité d’une conversation sérieuse. En France on réussissait peut-être à passer du sérieux intellectuel au sourire ironique en fin de conversation ; à New York, il fallait d’abord un shpritz, une histoire drôle, une blague, pour pouvoir aborder la dimension intellectuelle. Une conversation ne pouvait vraiment commencer qu’après avoir ri ensemble.
Bernard parla alors et, très intelligemment, demanda à Philip pourquoi il se refusait à continuer d’écrire. Philip hocha la tête et répondit d’un signe de tête clair et prudent – ça, c’est toujours mauvais signe, pensai-je, dans la mesure où il est naturellement porté sur l’exubérance et qu’il nous faisait là son numéro d’«homme de lettres» à la Arthur Miller, écrivain qu’il avait appris à imiter pour le bénéfice des caméras et des intervieweurs. (Dans une série de conversations avec Alan Yentob pour la BBC on ne voit que cet homme de lettres-là, très digne et totalement factice.)
Sentant que quelque chose ne tournait pas tout à fait rond, Bernard se mit soudain à raconter une histoire dans laquelle il n’avait pas, loin de là, le beau rôle, et que, depuis toutes ces années que nous nous connaissions, je n’avais jamais entendue. Il nous raconta que lors de son premier voyage à New York dans les années soixante-dix, époque à laquelle, comme tant de jeunes Français, il fumait encore une cigarette après l’autre, il avait été amené, lors d’une réception au consulat de France, à dissimuler sa cigarette encore allumée dans une de ses poches et avait mis le feu à son pantalon. Il mima ses efforts pour garder sa dignité pendant que son pantalon se consumait et que de la fumée s’en échappait, jusqu’ au moment où il avait finalement été obligé de défaire sa ceinture pour l’enlever.
Cette scène, magistralement décrite — la perfection de cette comédie muette du jeune philosophe français angoissé, le pantalon d’où s’échappe la fumée par le bas puis qui s’enflamme tout d’un coup à hauteur des chevilles – avait ravi Philip. Il était absolument enchanté. Il renversa la tête en arrière en riant, et le reste de l’après-midi se passa en une vraie discussion que Bernard relata dans un de ses essais.
J’avais été impressionné par la façon dont Bernard avait senti son public — compris ce que la situation exigeait. La gêne avait disparu, la glace avait été brisée. Je m’étais dit alors que ce n’était pas le genre d’histoire qu’il aurait racontée à Paris.
***
Avec les écrivains, même ceux qu’il aimait bien, Roth était ferme sur la nécessité de l’audace. Il fallait avoir une solide carapace et être prêt au combat. Et il avait été très ferme avec moi, une fois. Il aimait bien ma façon d’écrire ; après avoir lu mon double essai sur Lincoln et Darwin, Angels & Ages, il m’avait écrit — je ne peux m’empêcher de le citer ici, et ne vous gênez pas pour me le reprocher si cela vous chante — : «J’ai enfin lu “Angels and Apes”. C’est un livre époustouflant, éblouissant, rafraîchissant, qui fait autorité et qui est magnifiquement écrit. Je ne saurais dire avec précision quelles pages j’ai particulièrement aimées parce que tout m’a intéressé au plus haut point. Ce livre déborde d’érudition et d’intelligence. Merci, merci beaucoup de l’avoir mis sur ma route.» (Mon plaisir n’a été que très légèrement contrarié par le fait qu’il avait fait une erreur dans le titre, même s’il l’a corrigée par e-mail immédiatement après).
Et un peu plus tard, dans son appartement, il m’avait dit sur le ton dont on prononce un verdict ou une condamnation, à croire qu’il avait tourné et retourné ces mots dans sa tête : «Tu es plus intelligent que tes collègues. Et tu écris vraiment de très belles phrases. Mais tu n’as pas l’audace d’affronter ta propre vie intérieure. Il te faut soit continuer à écrire uniquement sur d’autres que toi, soit provoquer dans ta vie une crise qui te permettra de trouver un sujet.
— Ah, avais-je répondu, et je m’y prends comment pour faire ça ?
— Tu sais, je suis un expert pour ce qui est de provoquer des crises ! dit-il. Tu n’as qu’à prendre une des miennes.
— Piocher dans tes… restes ?»
— Exactement ! dit-il alors d’un ton joyeux. Je peux te donner une femme acerbe, un amant négligé, un frère ou une sœur mécontents, un parent au cœur brisé. Du grain à moudre, ajouta-t-il en riant à sa propre plaisanterie.
— Moi je te sers mes restes à manger, et toi tu me donnes tes restes à écrire», lui répondis-je sur un ton, je crois, un peu moqueur. Mais cette remarque l’avait ravi.
***
De nombreux sujets le hantaient, mais aucun ne le tourmentait plus que les relations pères-fils. Il avait souvent écrit sur une célèbre lettre de Kafka à son père qui l’obsédait et dans laquelle le fils désemparé qui, de son propre aveu, se sent inférieur, s’adresse à son père qu’il voit comme un mur, un monument, une présence en surplomb qui lui interdit tout mouvement, un être dont la volonté et la détermination empêchent ce fils chétif d’agir voire, à certains moments, de respirer.
Ainsi, vers la fin, lors de l’un des séjours à l’hôpital — cœur, colonne vertébrale — qui émaillèrent ses dernières années, la conversation, après avoir fait comme d’habitude un détour par le baseball et les livres, en était venue à Kafka et son père. À l’occasion d’un de ses nombreux voyages en République tchèque avant la chute du mur de Berlin – «Là-bas, rien n’est permis et tout a de l’importance ; ici, tout est permis et rien ne compte», avait-il dit dans une phrase restée célèbre — il avait rencontré un des membres, à l’époque encore nombreux, de la famille Kafka. Connaissant son amour pour le grand écrivain juif tchèque — que dans un de ses livres, il avait fait se réfugier à Newark où il enseignait l’hébreu au jeune Roth — cette personne lui avait montré une photo du père de Kafka prise après la mort de son fils emporté par la tuberculose (apparemment, m’a-t-on dit, la photo appartenait à une nièce de Kafka).
«Elle m’a expliqué, me raconta Philip, que son père avait été anéanti, qu’il avait eu le cœur brisé par la mort prématurée de Franz. Il idolâtrait son fils — il l’aimait ! Son écriture le déconcertait mais il avait un infini respect pour son talent et sa sensibilité, en ajoutant qu’il avait toujours éprouvé une grande frustration face à sa timidité et à leur incapacité à se parler. Ce n’était pas un mur et ce n’était pas un immense continent de froideur, ce n’était qu’un père juif, fier de son fils et capable de l’exprimer uniquement par des encouragements dénués de chaleur !
Cette lettre a tout entière été écrite à un homme qui n’existait pas ; un homme que Kafka avait inventé à partir de ses propres besoins et de ses propres peurs. Dans la réalité, ce père était… un père juif. On le voyait bien sur la photo que ce n’était pas une figure intimidante qui incarnait l’autorité patriarcale. Ce n’était qu’un commerçant juif comme un autre, et un fils juif qui voulait écrire, et ils ne se comprenaient pas ; avec le père qui était dévoué à son fils.»
Philip est le moins sentimental des hommes, mais il en avait les larmes aux yeux, et j’ai senti que l’histoire de Kafka et de son père — de Kafka imaginant son père sous la forme d’un vaste continent dur comme la pierre, en homme indifférent, brutal et autoritaire, alors que celui-ci ne vivait que pour le don étrange et magnifique de ce fils merveilleux qu’il avait – tout cela symbolisait pour Philip la profonde ambiguïté associée en permanence au travail de l’écrivain et aux rapports entre les pères et leurs fils, y compris, bien évidemment, ses rapports avec son propre père. Kafka avait eu besoin de créer une figure paternelle, une sorte de Dieu implacable dans son éloignement, et il avait transformé son propre père plein de bonnes intentions en cette figure que nous connaissons ; le Père, le Dieu, avait seulement voulu voir son fils réussir.
«Le père de Kafka a eu le cœur brisé par Kafka ! répétait-il. Il était si fier, et tellement impressionné par son fils ! Pas du tout dédaigneux ni méprisant… perplexe, peut-être, conscient qu’il errait dans des mondes dans lesquels un père ne pouvait le suivre. Mais il savait que son fils était spécial, qu’il avait un don, et il ne se remit jamais de sa perte. Kafka devait projeter et imposer tous ces traits de caractère fermés et redoutables sur… un père juif normal et un peu perdu qui avait pour un fils un écrivain, ajouta-t-il avec un petit rire.
Mais les dons du fils lui ont dénié un tel père, comme les limites du père lui ont dénié un tel fils.
Quel gâchis ! Le cœur y a tant perdu !» conclut-il, voulant signifier, me sembla-t-il, combien l’émotion se perdait d’une génération à l’autre à cause de la cécité de chacun envers l’autre — mais aussi que la cécité n’était pas une affliction mais une sorte de don de l’imagination, et qu’elle était essentielle.
***
Après être sorti de l’hôpital, encore frêle mais toujours aussi chaleureux, Roth est venu chez nous à l’automne 2017 pour un dernier dîner autour des restes. Et il s’est montré extrêmement gentil.
«Qui est ce David ?» fut la première question qu’il posa, et je restai perplexe. Voulait-il parler de Remnick ? Non, il m’expliqua qu’il avait entendu à la radio une chanson dont j’avais écrit les paroles. Cette chanson, interprétée par Melissa Errico, célèbre soprano de Broadway, avait pour titre “David”, et il s’était demandé qui était ce David. Je lui expliquai alors que c’était le héros d’une comédie musicale que j’avais écrite, et nous avons parlé pendant un moment de l’invention de noms à consonance juive pour nos héros – le mien s’appelait David Kaplan. «J’ai toujours été doué pour les noms juifs qui ne sont pas trop juifs, dit-il alors. Nathan Zuckerman, Peter Tarnopol. Quelqu’un m’a dit que Portnoy était en fait un nom séfarade. Ça aurait été trop évident si je l’avais appelé Goldstein.»
Notre fils Luke était parti à l’université, et notre fille Olivia devait bientôt partir elle aussi. Au fil des ans, elle était devenue une de ces jeunes-filles juives hyper-brillantes à l’esprit vif et aiguisé qui aimait plaisanter ; exactement ce qu’il adorait. Avec le départ de Luke, elle avait réussi à briller plus encore telle une lune que, depuis peu, la terre de son frère n’occultait plus.
«Philip, vous êtes dans le fauteuil à phlébite», lui dit Olivia tout de go. Elle lui expliqua que peu de temps auparavant, le critique et poète anglo-australien Clive James s’était assis dans ce fauteuil lors d’un dîner que nous avions donné en l’honneur de sa fille Clarewyn, elle-même peintre, qui avait fait le portrait de Luke. Au cours de ce dîner assez joyeux, Clive avait tout à coup senti sa jambe se raidir, et Clarewyn avait insisté pour qu’il aille immédiatement voir un médecin. Il s’avéra qu’il s’agissait d’une phlébite grave, et il avait été sur le champ transporté à l’hôpital de Mount Sinaï où il était resté trois semaines.
«Vous devez savoir ce que nous attendons de vous. Il y a une ligne directe entre cette chaise et Mount Sinaï, reprit Olivia assez brutalement.
— Tout ce que j’ai à offrir, c’est une légère attaque cérébrale. Je ne pense pas avoir de phlébite en magasin, lui répondit Philip d’un ton sérieux.
— Ça ne fera pas l’affaire», lui dit Olivia en secouant vigoureusement la tête.
Je mentionnai alors que le lendemain matin, j’avais pris tous les livres que j’avais pu trouver dont je pensais qu’ils pourraient amuser Clive, coincé comme il l’était à l’hôpital, et que je lui avais ainsi apporté, entre autres, un livre oublié d’histoire de la littérature, New England Indian Summer de Van Wyck Brooks, ouvrage autrefois célèbre mais aujourd’hui, à l’ère de la diversité révisionniste, complètement négligé. Et Clive, homme enjoué aux ressources infinies, avait écrit un poème sur un incident concernant Walt Whitman qui était rapporté dans ce livre.
«C’est vrai, oui. Brooks est excellent, dit Philip. Il est très bon sur Whitman et sur Poe. C’est le genre d’histoire littéraire qui ne plaît plus aujourd’hui. Ça parle de littérature.»
Nous étions depuis peu dans ce moment de toute soirée où l’on parle de Trump, et nous avions abordé la question des immigrants. J’avais établi un lien entre lui et le grand spécialiste de Shakespeare, Stephen Greenblatt, puis la conversation avait dévié sur le rôle de Shakespeare dans le manuscrit d’une pièce jamais montée sur Sir Thomas More, qui contient probablement avec ce que l’on appelle “De la main D.”, ce qui est le seul manuscrit que Shakespeare ait écrit de sa propre main. Dans ce passage, More décrit le sort pitoyable des immigrants — à son époque, des protestants – auxquels on refusait l’asile.
«Cherche-nous ça et lis-le» insista Philip. Et Olivia, comme le font les gens de sa génération, prit son téléphone et, en quelques secondes, trouva une retranscription de ce texte.
«Ne faites pas défiler mes photos», le prévint Olivia en lui expliquant cette règle fondamentale de la vie en société pour les gens de sa génération : quand on vous montre une photo sur un téléphone, vous n’avez absolument pas le droit de faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour en voir d’autres.
Il parcourut ce texte magnifique à la recherche de certains vers qu’il aimait particulièrement. Puis il lut à haute voix :
«Alors vous ne seriez rien que des métèques, Et seriez-vous heureux
De trouver un pays dont les mœurs sont barbares
Au point que, se livrant à d’ignobles violences
On ne vous offre point un refuge sur cette terre
… Que diriez-vous alors
D’être traités ainsi ? tel est le sort que l’on fait ici aux étrangers
Telle est la cruauté des barbares que vous êtes[2].»
«Ces barbares que vous êtes, c’est excellent – à eux seuls, ces mots sont la preuve que Shakespeare en est bien l’auteur, dit-il.
— C’est “Le sort de l’étranger”, ça ferait un bon titre de roman, dis-je.
— Effectivement, acquiesça-t-il avec force. Si seulement il y avait un romancier à cette table ! Je suis en train de lire en ce moment les discours de Lincoln, c’est un excellent antidote contre ceux de Trump, dit-il dans un soupir. Je me demande qui pourrait bien nous débarrasser de Trump.
— Vous, vous le pourriez, lâcha Olivia. Si vous déclarez demain que vous soutenez Trump, il vous invitera à la Maison Blanche et vous seriez seul avec lui. Vous pourriez lui dire ses quatre vérités.
— Ah, ça c’est un bon plan, lui répondit Philip.
— Il vous suffirait de dire que vous êtes le seul intellectuel qui le soutient. Il en serait tellement flatté qu’il vous inviterait aussitôt à venir le voir. Il vous faudrait bien sûr jouer très sérieusement votre rôle pendant un an.
— En effet. Et il faudra aussi que je publie des lettres de soutien dans les pages d’opinion du Times et tout le reste.
— Et vous perdriez tous vos amis du monde littéraire de New York…
— Ça, ce ne serait pas nouveau, dit-il en riant. Et je m’en accommoderais.
— Ensuite, une fois que tout le monde aurait refusé la Médaille de la Liberté ou je sais quoi, vous, vous pourriez l’accepter.
— Ça se tient – le Juif désespéré, prêt à accepter n’importe quoi, acquiesça-t-il. C’est jouable.
— Et si jamais on vous accuse de dissidence et qu’on vous arrête, vous auriez alors sans doute l’occasion d’écrire de très belles choses dans votre cellule de prison ; pas mal comme dernier acte.
— Cette idée me plaît énormément, dit-il. Magnifique cette histoire ! On prend quoi comme titre ?
— Complot pour l’Amérique», proposa-t-elle.
Il était absolument ravi. Et il partit d’un grand rire à cette suggestion.
Tout à coup, venu de nulle part, un air bizarre joué sur une harpe résonna dans la salle à manger – exactement le genre de musique qu’on entendait dans les comédies musicales des années quarante pour indiquer les séquences imaginaires. Nous étions tous abasourdis. Y compris Philip.
«Ah ! C’est mon téléphone ! dit-il en comprenant soudain, perdu comme il était dans sa rêverie. Je ne sais plus qui m’a mis cette sonnerie.»
Il sortit son téléphone de la poche de sa veste et l’éteignit. La harpe se tut.
«Bon sang ! lança Olivia. Pendant un instant… on aurait dit que c’était le ciel qui appelait et qu’on allait être obligés de terminer ce roman dans une autre vie.
— Les Juifs ne croient pas à la vie après la mort, dit-il avec fermeté en refermant son téléphone. Pour les Juifs, c’est comme rêve Hollywoodien. Rita Hayworth leur apparaît dans une brume légère, elle est allongée sur un canapé et elle se rapproche.»
La tarte au potiron arriva et la conversation prit un tour plus sérieux. Ce fut la dernière plaisanterie qu’il dit à notre table.
***
Peu de temps après sa mort le 22 mai 2018, un groupe de Juifs suédois invita un certain nombre d’amis de Philip Roth à venir à Stockholm le 10 décembre, date à laquelle le Nobel est attribué en cours de soirée ; c’était une sorte de Prix Nobel à titre posthume. Je pris la parole et racontai la blague avec laquelle il m’avait accueilli le matin du jour où Dylan avait eu le prix. Quand sa pierre tombale, qui rappelait celle de Camus, fut dévoilée à Bard College, ses amis se réunirent, mais il avait laissé des instructions très strictes : il ne voulait aucun service religieux. Alors, avec Bernie et quelques autres, nous avons raconté ses blagues préférées. J’ai repris celle de Mme Goldstein et du premier homme qui avait tant ravi les enfants avec ce refus très ferme et très flaubertien de Mme Goldstein d’ajouter un seul mot de plus.
[2] Traduction Jean-Pierre Villquin, Pléiade, Histoires vol. II, Gallimard, Paris.