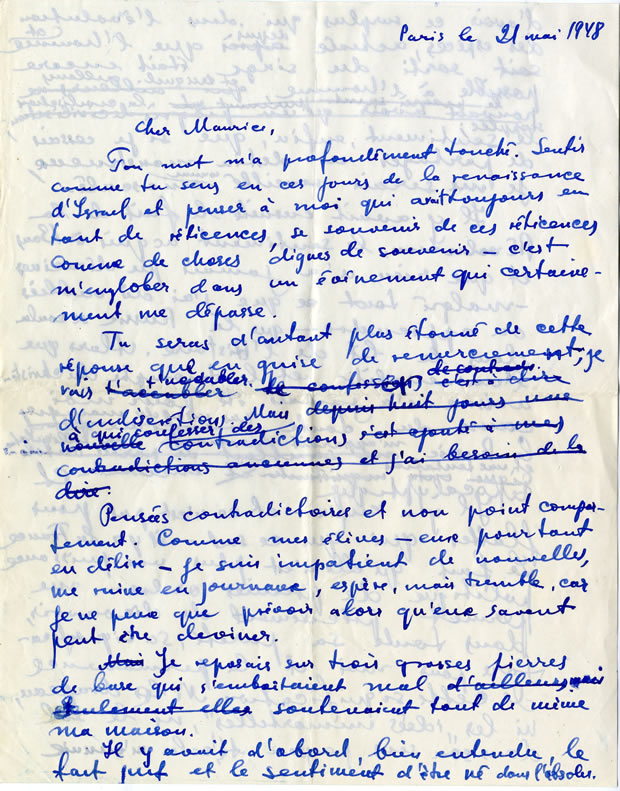«Dans les situations crépusculaires, dont notre époque me semble faire partie, le distinguo est malaisé : rien ne ressemble davantage à un discours vrai qu’un discours vraisemblable, et l’imposteur semble souvent plus assuré et convaincant que celui qui essaie maladroitement de dire quelque chose de sensé», écrit Gilles Hanus dans son introduction à ses Quelques usages de la parole ; le ton est donné.
Petit livre bien remarquable, bien extraordinaire, que vient de publier un philosophe qui fait ici tellement profession de l’être qu’on en est étonné comme d’une étrangeté. Philosophe, non pas tant au sens qu’il revêt chez Adèle Van Reeth, quand elle offre au tâcheron universitaire, abîmé dans l’inutilité définitive de sa profession, la divine surprise d’une publicité ; philosophe, non pas cette variété de classeur ou de registre, ou plus exactement d’intercalaire, entre deux phrases d’un mort illustre duquel le dit génère le mode de prolifération dont son métier est l’accident – celui du «vivant en se multipliant» dont parle Baudelaire dans sa Charogne (et dont Joyce donna d’ailleurs, bien plus décisif que Lord Voldemort et ses horcruxes, la formule chimique exacte, intitulée Finegans’ Wake) ; philosophe, non plus par le geste sartrien, ou cartésien, ou heideggérien d’une tabula rasa où s’inventerait triomphalement une radicalité (ou radicalement un triomphe, c’est pareil) ; philosophe, dans le sens plus antique, et, singulièrement, le plus modeste qui soit : comme celui qui, devant les questions qu’il rencontre dans sa vie, essaye d’y voir clair, bref, cherche la sagesse en connaissant ses limites.
De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un homme qui parle ; or cet homme qui parle fait métier de parler, car il est professeur ; mais parce qu’il est aussi philosophe (non qu’un professeur de philosophie soit philosophe – c’est généralement le contraire, si bien qu’on pourrait dire que le professeur de philosophie fuit la philosophie comme la peste, ainsi que le démontrent ses commentaires écrits ou oraux, vide supra), il interroge son métier de parole ; philosophe, aussi, en ceci qu’il distingue que ce qu’il clarifie (on n’est pas du pays de Descartes pour rien), il ne se cantonne pas à son métier de parole, mais remonte à sa source, soit, d’une part, au fait de parler, et d’autre part, au fait de lire (car un dont le métier est de professer doit parler, c’est requis, de ce qu’il a lu).
Ce qui, en revanche, est si peu requis qu’il en est même stupéfiant, et qu’il excite notre étonnement, c’est de faire le travail philosophique de réfléchir sur la parole, 2.500 ans après Platon ; c’est, par exemple, de distinguer le dire et le dit, la parole et le discours, soit la parole vivante et la parole morte ; c’est de produire une analyse de la conférence, en égrainant, de façon si finement drôle, les diverses tares du conférencier ; c’est de s’interroger sur la voix, le texte ou l’enseignement.
En somme, cette façon toute simple, toute honnête de poser la question de ce qu’on fait, devra paraître aujourd’hui un geste si bizarre, qu’il suscitera chez ceux qui le verront une enquête : quelle mouche le pique, ce prof de philo», de se demander ce que c’est que parler ?
Inutile de perdre du temps, car je crois tenir le réponse ; il y a un mot qui dit parfaitement ce que fait ici Gilles Hanus : l’insolence. Rien n’est plus insolent, aujourd’hui, que ce petit texte, qui fait comme si tout le monde ne savait pas ce que sont respectivement la philosophie, la parole, la lecture (bref, «la culture»), ce qu’elles ont de fragile, de mortel, de menacé. Insolence qui fait écho à un autre temps, celui qui commence avec Montaigne et mûrit à l’âge dit classique, dénomination stupide, car les classiques, avant de servir à épater les institutionnels, étaient justement de parfaits insolents : cette insupportable évidence, cette économie de mots et de phrases qui ne recherche même pas la «sublime banalité» dont s’extasiait l’idolâtre Baudelaire – mais seulement la liberté, dans le pays le plus tyrannique de tous les temps.
Notre époque ne goûte pas l’insolence, je dirais même qu’elle la hait ; notre génération, composée exclusivement de sujets conscients d’eux-mêmes et supposés savoir, n’admet (et ne vénère, car elle n’admet que ce qu’elle vénère) que la provocation. La provocation hurle ; le moi s’étale, portant, tel le roi Renaud de la chanson, «ses tripes dans ses mains» ; le moi de l’écrivain, le moi de l’universitaire, le moi du spécialiste se hurlent d’autant plus fort qu’ils expriment une substance plus rachitique. Mais l’insolence est calme et polie ; c’est calmement, par exemple, qu’Hanus montre que le conférencier ou universitaire qui répète la pensée d’un autre ne parle pas ; c’est poliment qu’il retrouve le «montreur de marionnettes» du mythe de la Caverne pour décrire le commentateur, faisant danser ses noms propres devant lui en s’en grisant.
Mais derrière le sourire de l’insolence, il peut se cacher deux yeux : «l’oeil en amande» de l’ironiste (auquel Hanus fait aussi un sort, décrivant son néant), et «l’oeil rivé» du guetteur. Nous tenons là le regard de l’auteur. Car il y a une gravité dans ce texte, c’est celle qui s’exprime dans la phrase que j’ai citée, et qu’on retrouve évidemment à la dernière phrase du livre : «Malgré les menaces dont notre époque est porteuse et par-delà le bavardage intellectuel, nous devons désormais habiter pleinement la parole, ne plus rien – absolument rien – céder de notre puissance de parler ; tenir que dans l’usage de la parole se joue décidément l’essentiel».
Ce livre est d’autant plus choquant, aujourd’hui, pour l’hybris du gros animal qui nous gouverne, qui a nom, d’après moi, tourbe, ou «nous tous» et ne génère plus, chez le publiant, qu’un désir de très grand nombre (je ne sache que personne y échappe, sinon deux ou trois noms de ma mémoire immédiate) – qu’il est évidemment écrit pour quelques uns, soit, ô honteuse discrimination, pour les quelques qui ont quelque chose à faire avec les mots, ce qui n’est pas le cas du plus grand nombre. Ces quelques uns, ce sont évidemment ceux qu’invoque Gide («Je crois dans la vertu du petit nombre ! Le monde sera sauvé par quelques uns !»), qui, lui, n’y croit pas tout à fait assez pour qu’on le croie ; Quelques usages de la parole est un outil de survie pour quelques personnes qui parlent, et subissent comme tout un chacun l’énorme tsunami d’un monde qui s’effondre ou du moi qui se proclame, ce qui est dire rigoureusement la même chose.
Car ces contemporains singuliers se signalent les uns aux autres d’une urgence plus grande que de constater la débâcle : de l’urgence de faire usage de la parole. C’est aujourd’hui un paradoxe au sens strict. Pas plus l’écrivain Gallimuche que la caissière de Lidl ne croit qu’il faille faire usage de la parole.
Gilles Hanus, pour lui-même d’abord, pour quelques uns des siens, ensuite, fait place nette. Ceux qui ont besoin de cette place ne peuvent que le remercier – ils sont rares, parce que, justement, il faut, sous quelque aspect, n’avoir pas de place dans la société pour commencer sérieusement à parler.
C’est dire que faire usage de la parole est une geste strictement antisocial, ou antipolitique ; à lui s’oppose toute production culturelle ou académique, et c’est pourquoi les sociologues qui nous gouvernent, l’oeil rivé sur le cap de leur indignation satisfaite, n’ont pas la moindre idée de ce qui leur survivra.
Gilles Hanus : Quelques usages de la parole, Hermann, 2019.