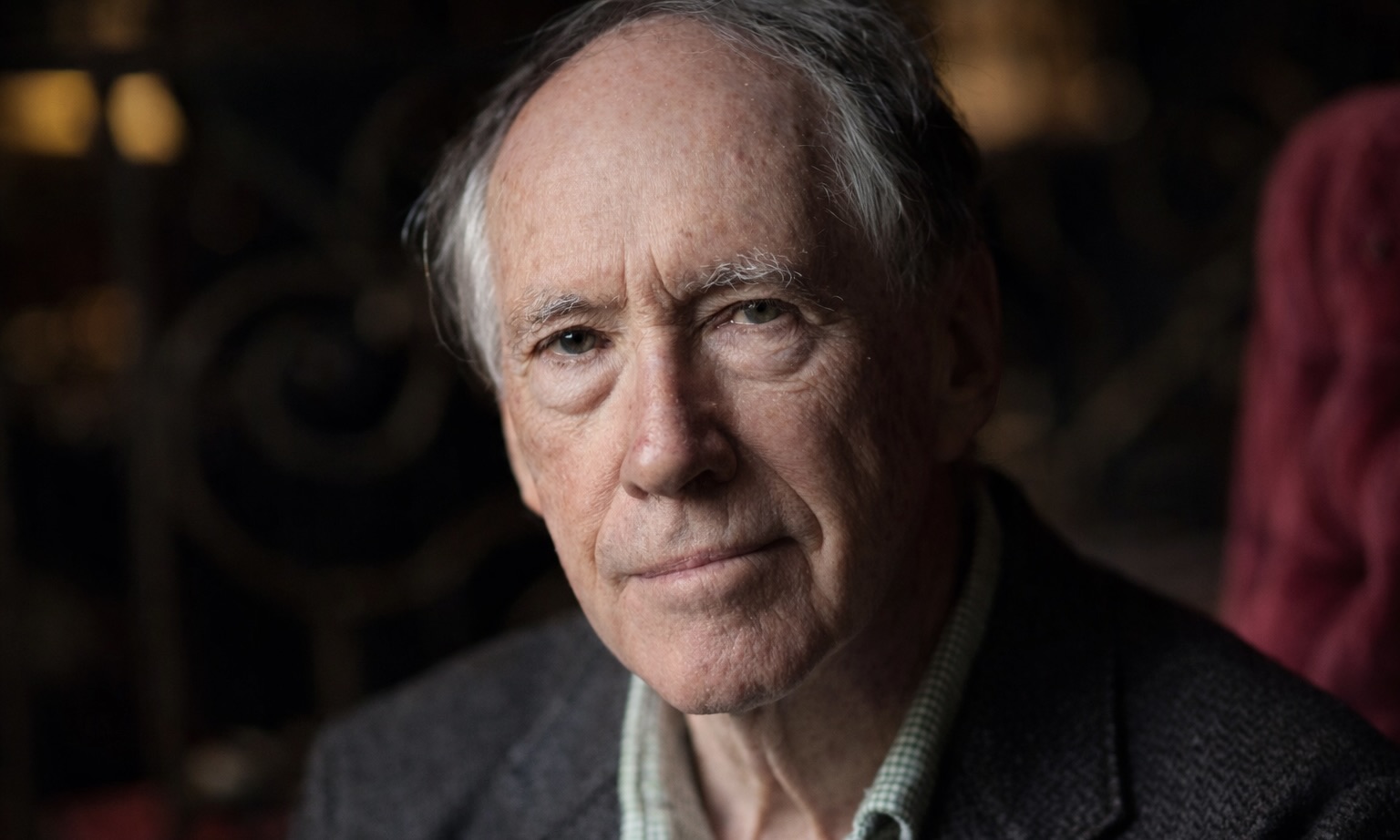«C’est la jeune survivante, en moi, que tu aimais, Georges. J’étais les yeux qui ont vu, le corps qui a survécu, j’aurais pu te raconter Birkenau, où ta mère est morte avant que je n’y arrive. Mais je fuyais ce trou noir, je ne pouvais pas l’éclairer pour toi […] J’étais l’enfant déportée pavant mon enfer de livres que tu me tendais. Tu étais l’orphelin caché devenu écrivain», écrit Marceline Loridan à Georges Perec à propos de leur relation à peine entamée en 1955.
Après Et tu n’es pas revenu, livre dédié à son père, avec qui elle a été déportée à l’âge de 15 ans à Auschwitz-Birkenau par le même convoi que celui de Simone Veil, puis à Bergen-Belsen, et enfin Theresienstadt, Marceline Loridan-Ivens nous offre à nouveau ses mots-vérité avec L’amour après.
«Il m’a fallu du temps pour comprendre que le plaisir vient du fantasme, puis de l’abandon. J’avais peur de l’abandon, c’était l’une des pires choses au camp, se relâcher, abandonner la lutte de chaque jour, flirter avec volupté vers l’idée que tout vous est égal, et devenir une loque qui n’attend plus que la mise à mort.»
Marceline Loridan-Ivens nous confie ce que personne n’a osé, voulu, pu décrire de «l’amour après». C’est-à-dire après Auschwitz-Birkenau et la déshumanisation totale. Comment refaire l’amour après cela ? Comment dissocier, après les camps, nudité et souffrance, promiscuité et autorité, chaire et brutalité ?
«La violence et la domination m’étaient plus familières que les caresses et le jeu sexuel.»
Après s’être mariée par égard résigné pour les conventions de sa mère, elle s’affranchit de certains impératifs bourgeois et des conquêtes trop directives : «Il n’y eut, après les camps, plus aucun donneur d’ordres dans ma vie.» Les hommes, ensuite, elle les a beaucoup fait attendre. Elle veut surtout savoir et embrasser le monde, «Je ne pouvais pas faire autrement», confie-t-elle en interview :
«J’étais une sorte de pierre glacée quand je suis revenue […] il fallait que je retrouve mon âme. Les gens ne l’ont pas forcément compris. L’amour après le dégel en quelque sorte. Mais personne n’a vraiment dégelé. Je voulais vérifier auprès des autres, poser des questions aux autres survivantes. Mais niet. Mais pas de réponse.»
Au début, Marceline Loridan-Ivens avait pensé engager le récit d’autres rescapées mais elle a dû se résoudre à abandonner l’idée après avoir essuyé de lourds silences ou le refus de ses camarades survivantes. L’auteure regrette que sa liberté de parole et de ton ne soit pas plus répandue.
De ces commotions irréversibles qui ont figé les corps et annihilé la sexualité, nous n’avons que peu de narrations tant l’humiliation est traumatique et l’ultra pudeur matricielle. Nous pensions en connaître beaucoup mais nous n’en savons rien réellement.
Comment parler de ça ? Pourquoi ? Pour qui ?
Et puis ces pages qui viennent expliquer, avec une facilité aussi déconcertante qu’elle implique pourtant le malheur du noir complet, comment le retour non seulement à la vie mais aussi à l’amour a pu s’opérer, autant que faire se peut pour une âme perdue, au creux du mythique Saint-Germain-des-Prés des années 60.
C’est toute cette douleur autant que de ses fulgurances littéraires qui nous sont données en partage. L’auteure témoigne des non-dits, des secrets qui ont quelque chose d’aussi universel que l’est l’universalité de la Shoah – ce mot, d’ailleurs, elle le substitue par «la destruction des Juifs d’Europe» afin de pointer la responsabilité collective d’un continent. Ses mots, jamais mièvres, toujours directs, disent toute la violence d’un siècle mais aussi la formidable quête de liberté qui est la sienne, de légèreté, malgré tout, et la rage de «continuer» et d’apprendre.
Marceline Loridan-Ivens nous raconte sa vie d’amoureuse, son rapport au corps, son parcours de combattante pour approcher le sexe, ses amants, ses couples, l’homme de sa vie, ses grandes passions, ses idylles perdues et éperdues, son histoire de femme.
Econduite, adorée, incomprise, en fuite, elle épluche minutieusement une valise romantique qui contient ses souvenirs. Un effeuillage comme il est rare d’en lire.
«J’ai perdu la vue à Jérusalem. Ça n’a rien à voir avec Dieu», nous annonce-t-elle d’emblée en introduction. On devine alors un dispositif littéraire s’appuyant sur les yeux de Judith Perrignon. En sa compagnie, puis la nôtre, Marceline Loridan-Ivens revisite avec délicatesse chaque indice de son passé affectif, ses lettres galantes, ses petits et grands mots d’amour et son intimité avec une élégance aussi franche que poétique.
On surligne le texte tous les 50 signes jusqu’à ce que, les pages devenues uniformes, nous lâchions notre crayon. On est interpellé, touché, interrogé à chaque ligne, emporté dans son histoire, dans ses affects, dans ses chemins de traverse, dans sa complexité. On s’arrête parfois, scotché par sa façon de dire tout ça, son courage, sa lucidité, et ses abîmes, par cette façon aussi libre que pudique, aussi simple qu’inédite de nous parler d’amour charnel et d’amour tout court.
Marceline Loridan signe à nouveau un texte essentiel et unique.