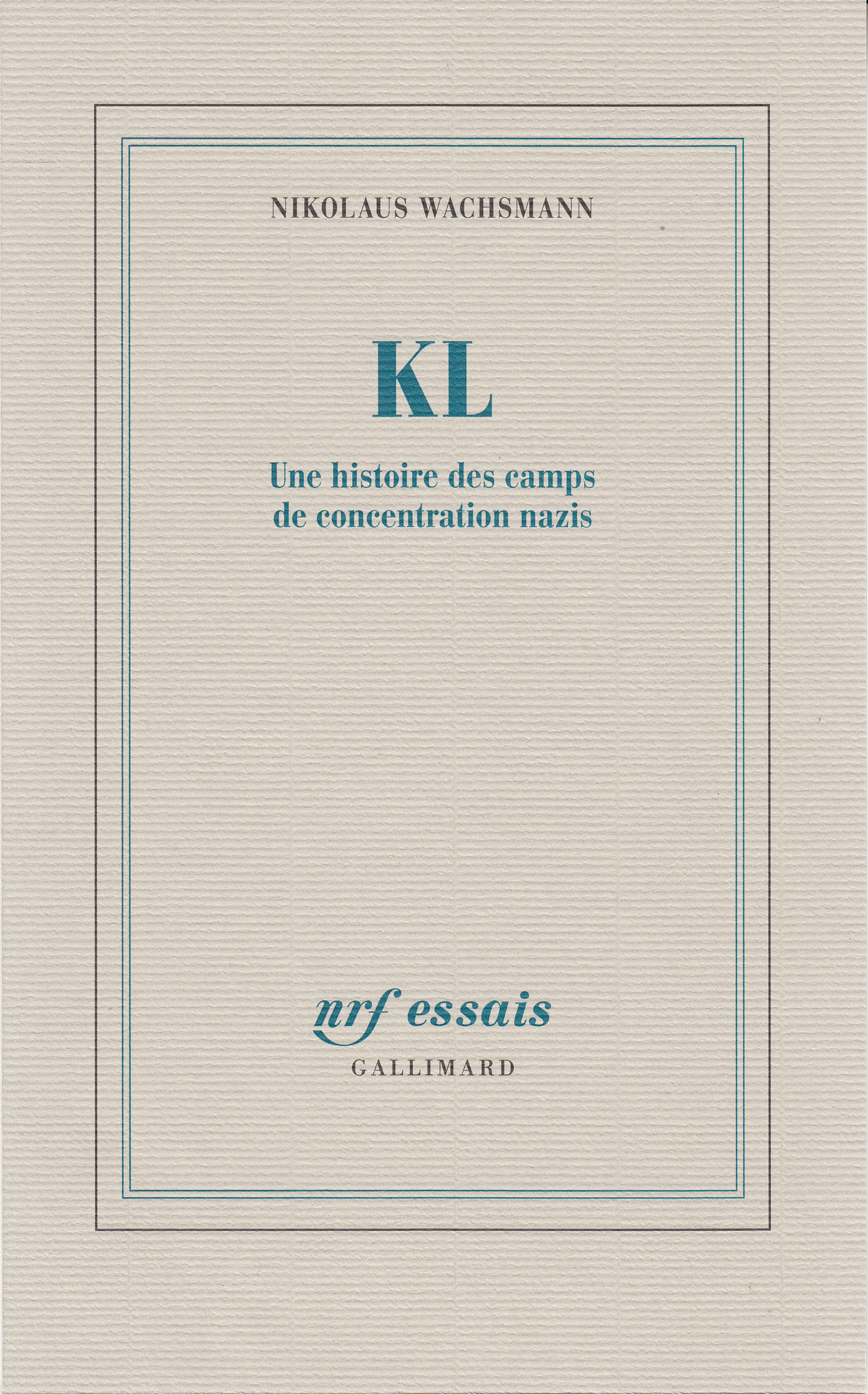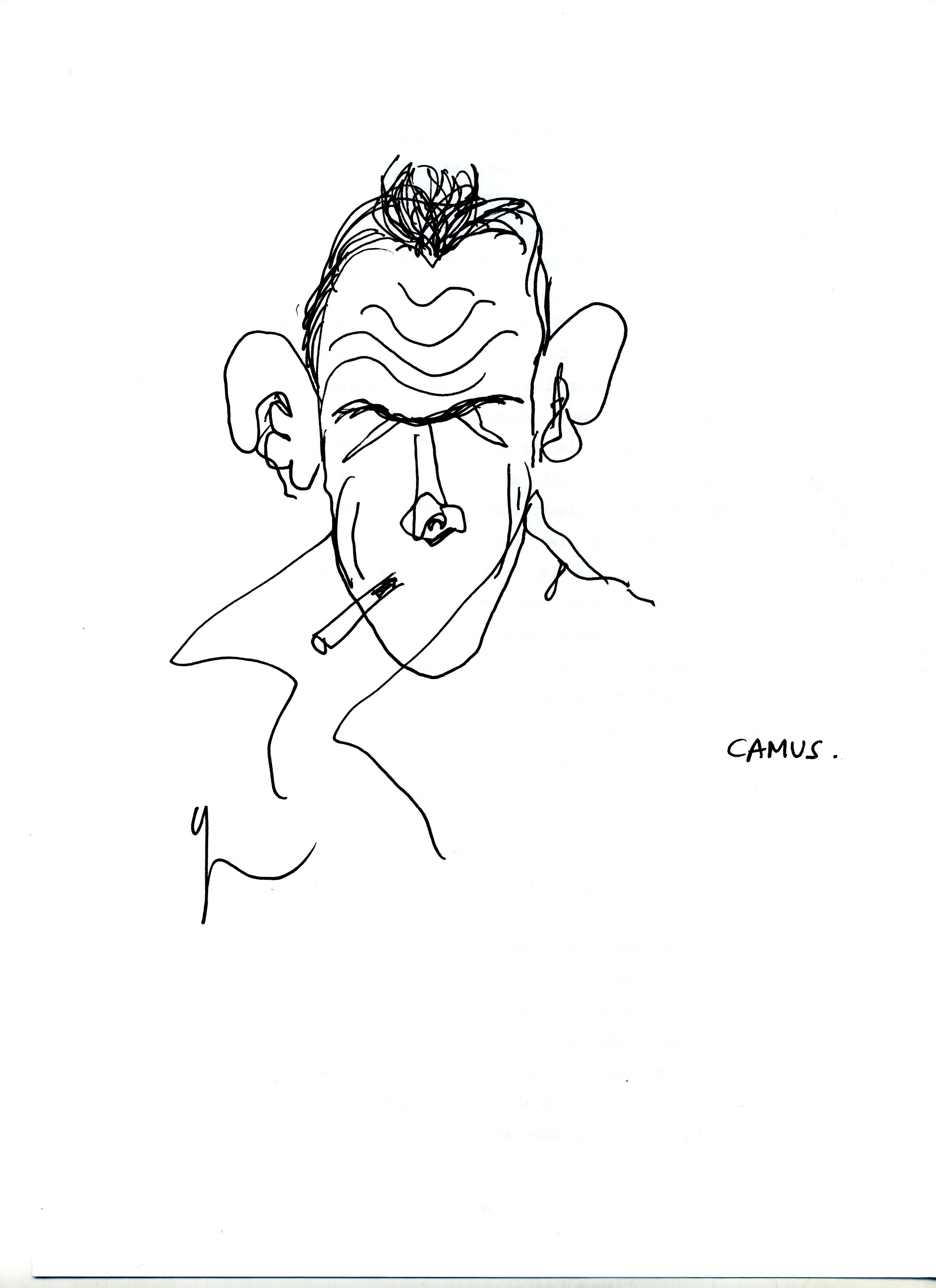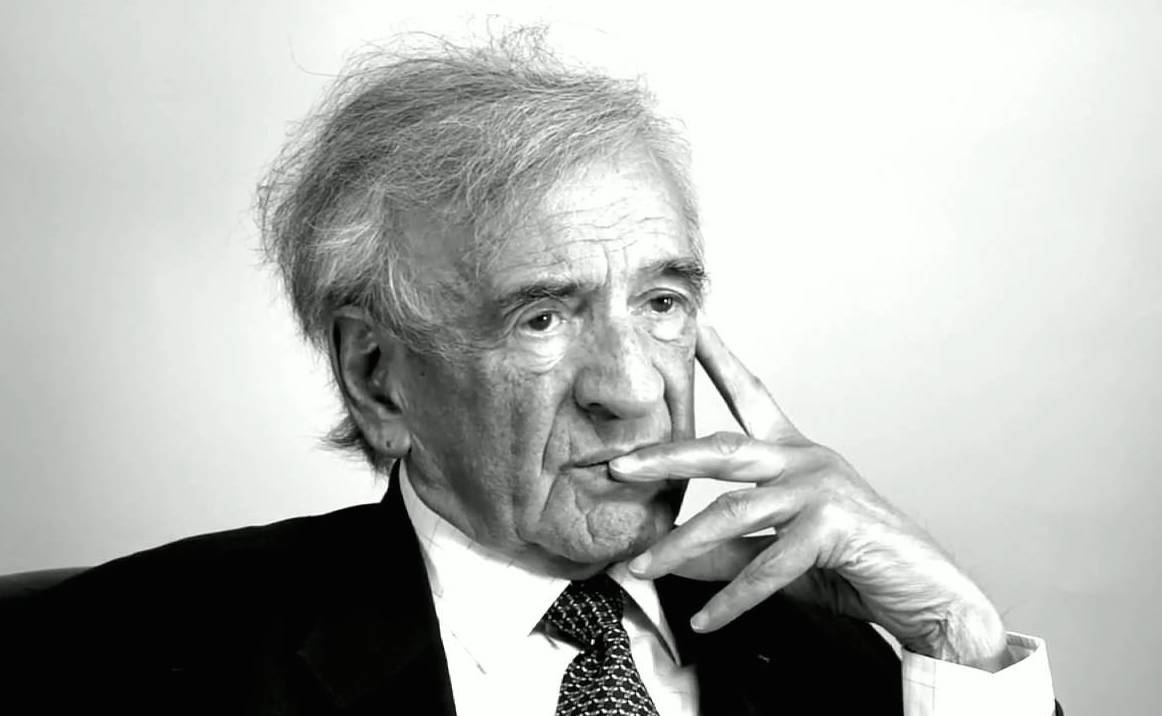Karl Plagge (1897-1957), commandant dans la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale, fut envoyé à Vilnius en 1941. Ainsi, témoin direct du génocide contre les Juifs, il réussit à en protéger environ mille usant de stratagèmes périlleux pour les Juifs mais également pour lui, vis-à-vis de la SS. Malgré la volonté de destruction totale de cette population par les nazis, l’officier allemand permit de sauver environ 20% des travailleurs Juifs lituaniens promis à une mort certaine. Lors de son procès en 1947, il fut défendu par nombre de survivants juifs et finalement acquitté. Deux ans avant sa mort, en 1957, il expliqua dans une lettre-testament que son action avait été inspirée par le Dr Rieux dans La Peste de Camus. Le personnage du roman livre son combat contre l’épidémie «en désespoir de cause» aurait dit Beckett. En 2005, le mémorial du Yad Vashem conféra à Karl Plagge le titre de «Juste parmi les nations» (Tzadik oumot haolam).
Soixante ans après la mort de Plagge et le prix Nobel attribué à Albert Camus en cette même année 1957, une nouvelle coïncidence de calendrier rapproche encore ces deux noms : alors que paraissent les Conférences et discours 1936-1958 de l’écrivain ainsi qu’une édition folio spéciale sous le titre Discours de Suède – prix Nobel 1957 réédite son discours et sa conférence Nobel ; dans le même temps, paraît chez Gallimard KL – Une histoire des camps de concentration nazis (nrf essais) de Nikolaus Wachsmann.
Camus ! Voici un écrivain qui, dès 1946, disait :
«Les Français sentent que l’homme est toujours menacé et ils sentent aussi qu’ils ne pourront pas continuer à vivre si une certaine idée de l’homme n’est pas sauvée de la crise où se débat le monde. […]
Oui, il y a une Crise de l’Homme, puisque la mort ou la torture d’un être peut dans notre monde être examinée avec un sentiment d’indifférence ou d’intérêt amical, ou d’expérimentation, ou de simple passivité» (Conférences et discours, p. 38-39).
Quand on relit soixante ans après son discours, on ne peut qu’être impressionné – plus que par beaucoup d’autres discours de lauréats du Nobel de littérature –, par l’acuité avec laquelle Camus parle de la responsabilité de l’écrivain. S’il est bien vrai qu’il y a eu nombre de salauds en littérature, de racistes, de fascistes, d’antisémites, toutes sortes de haineux, il n’en est pas moins vrai que les écrivains dans l’ensemble ont eu – davantage que les philosophes –, le sens de leur responsabilité. Pour Camus la fonction de l’écrivain est grande, elle est quasiment sacrée.
Dans ce discours, il ne répond pas à la question de Sartre : «que peut la littérature ?», mais il répond à celle-ci : «que doit faire l’écrivain pour qu’il soit justifié dans son art et surtout par sa vie ?». C’est la terrible question de Kafka. Considérons d’ailleurs combien d’écrivains, de poètes, furent emprisonnés sous les dictatures de droite comme de gauche, déportés, assassinés, quand ils ne purent s’exiler tout au long de l’Histoire, pour combien peu de philosophes, de Platon à Heidegger !
Camus à Stockholm parlant de l’écrivain dit : «Par définition, il ne peut se mettre aujourd’hui au service de ceux qui font l’Histoire : il est au service de ceux qui la subissent.» Ce fut sans doute la conduite de Sartre et ce fut aussi le sens que Malraux se faisait de la responsabilité de l’écrivain, de «l’intellectuel engagé» avant 1958 mais aussi, paradoxalement, après 1958, c’est-à-dire après qu’il eût accepté de créer le premier ministère de la Culture d’une démocratie occidentale, de 1959 à 1969, et de servir la politique gaullienne – malgré la tragédie algérienne !
Lisons encore dans le discours de Camus ces paroles :
«Toutes les armées de la tyrannie avec leurs millions d’hommes ne l’enlèveront pas à la solitude, même et surtout s’il consent à prendre leur pas. Mais le silence d’un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l’autre bout du monde, suffit à retirer l’écrivain de l’exil, chaque fois, du moins, qu’il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le faire retentir par les moyens de l’art.»
Il cherche ensuite à comprendre «sans cesser de lutter contre eux, l’erreur de ceux qui, par une surenchère de désespoir, ont revendiqué le droit au déshonneur, et se sont rués dans les nihilismes de l’époque.»
La fin de sa conférence Nobel, «L’artiste et son temps», prononcée le 14 décembre 1957 à l’université d’Upsal, est tout aussi puissante et actuelle :
«Et réjouissons-nous en tant qu’artistes, arrachés au sommeil et à la surdité, maintenus de force devant la misère, les prisons, le sang. Si, devant ce spectacle, nous savons garder mémoire des jours et des visages, si, inversement, devant la beauté du monde, nous savons ne pas oublier les humiliés, alors l’art occidental peu à peu retrouvera sa force et sa royauté.»
Plus d’une pensée et plus d’une image évoquées dans ces deux discours flamboyants de Camus sont proches de celles évoquées par Elie Wiesel dans son discours et sa conférence Nobel, prononcés en décembre 1987, trente ans plus tard, mais lui à Oslo et non à Stockholm, car il reçut le prix Nobel de la paix, non celui de littérature. Lisons plutôt :
«J’ai juré de ne jamais me taire quand des êtres humains endurent la souffrance et l’humiliation, où que ce soit. Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l’oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté.»
Oui, il y a un lien entre ces deux hommes : Camus et Wiesel. Il fallait le dire à l’approche des deux anniversaires de leur prix Nobel.