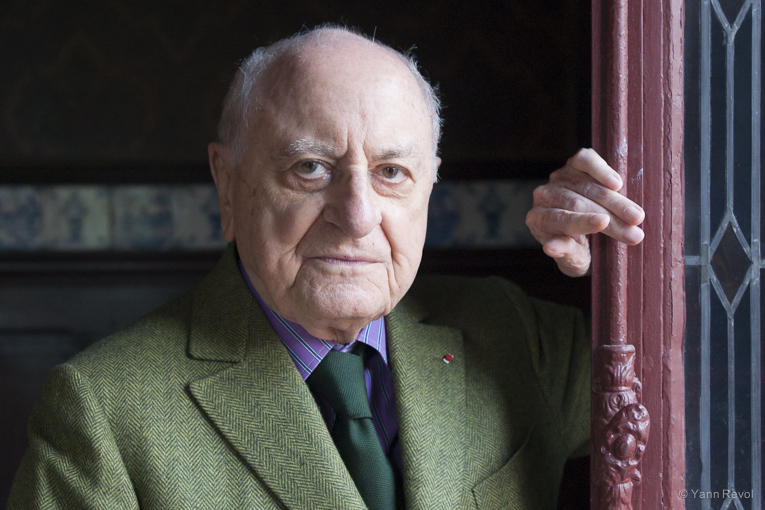Pierre aura passé sa vie à être le gardien de ses morts. Giono. Et Cocteau, dont il était l’ayant droit moral. Et Zola, dont il sauva la maison de Médan. Et, bien sûr, Yves Saint-Laurent, immortalisé à travers le double tombeau de fleurs (les jardins Majorelle de Marrakech) et de papier (les «Lettres à Yves») qu’il lui dressa. Et François Mitterrand, dont l’héritage n’a pas eu de gardien plus intransigeant et farouche. Et tant d’autres, moins fameux, mais sur la mémoire desquels il veillait avec le même souci. Comme c’est bizarre, pour ses amis, de devoir, à leur tour, veiller sur lui. «Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs»… Il aimait ce vers. Il y entendait la propre voix des morts en mal d’âmes amies. Je n’imaginais pas qu’il pût s’appliquer un jour à lui.
On a beaucoup parlé d’argent dans les hommages rendus à Pierre – et c’était inévitable. Mais, parmi les choses que l’on n’a pas assez dites, il y a le souverain mépris qu’il lui vouait. Je ne dis pas seulement la générosité. Ni la prodigalité presque insensée. Ni la façon qu’il avait de ne pas savoir dire non quand les demandes d’aide et de mécénat pleuvaient comme noix sur ses fondations. Non. Vraiment, je crois, le mépris. Ou, en tout cas, l’indifférence. C’est-à-dire une égale inaptitude à l’excès d’honneur qui fait mettre l’argent fou au sommet de l’échelle des vanités et à l’indignité qui fait qu’on le diabolise. Stirner, son maître en anarchie, pensait ainsi. Et Fourier, qu’il aimait aussi. Et «la bonne âme de Sé-Tchouan», ce personnage de Brecht, déguisée en homme d’affaires dans la journée et prodigue, le soir venu, des gains du jour, dont le cas le faisait toujours tellement rire. J’aimais, en lui, cet autre athéisme. J’aimais – car c’est si rare et, soudain, si reposant – que son argent, mauvais maître et bon serviteur, n’ait jamais eu, à ses yeux, d’autre prix que celui de servir les œuvres de ses amis artistes et la manière d’œuvre qu’était aussi sa vie.
Les lois de l’amitié m’ont mêlé, il y a sept ans, à l’aventure de «L’amour fou», le moins connu mais le plus instructif des films que la saga Saint-Laurent aura inspirés – et dont le double fil était l’histoire de son amour avec Yves et la dispersion de la première de ses collections d’objets, œuvres d’art et livres rares. Eh bien, c’était si clair, tout à coup ! Les rois se faisaient enterrer avec leurs secrets et leurs objets sacrés. Leurs lointains et pâles héritiers ont, comme ce milliardaire japonais qui voulut, il y a vingt ans, se faire incinérer avec son Van Gogh, tendance à les imiter. Pierre faisait l’inverse. Il dispersait avant de partir. Il déclarait n’avoir été que l’usufruitier de ses trésors et les rendre à leur liberté. Et il mettait autant de talent à se dépouiller qu’il en avait mis à inventer l’une des dernières vraies grandes vies de notre temps. Je le revois, à cette époque, dans l’une des maisons dont il avait décidé de faire un lieu ouvert au public. Il s’était, avec Madison Cox, replié dans un minuscule appartement, tout en longueur, au-dessus de la buvette pour touristes, au bout du jardin. Et cette simplicité nouvelle, qui rappelait le dénuement de Costals, dans le désert marocain, à la fin des « Jeunes filles » de Montherlant, lui allait aussi bien que le faste de la veille.
J’aime que Pierre Bergé n’ait jamais rien mis au-dessus de l’art et, en particulier, de la littérature. Non qu’il les sacralisât. Il était, vraiment, l’homme le plus athée, donc le plus libre, que j’aie connu et était donc incapable de sacraliser quoi que ce soit. Mais il vivait les livres. Il tutoyait leurs auteurs et entretenait avec eux, morts ou vivants, une conversation sans fin, à bout portant. Il était du genre à vous dire, du temps qu’il était invincible et joyeux, que la mort n’est rien, qu’il n’y a rien en elle qui doive susciter l’effroi – sauf, peut-être, si elle vous prend au milieu de la lecture d’un grand roman, suspendu à son dénouement. Et je rappelle, par parenthèse, que cette ardente passion des livres est la clé de son amitié tardive avec François Mitterrand. Souvenir de ce dernier meeting de la dernière campagne de 1988. Le «roi», qui sent le parfum de la victoire toute proche, se divertit, lors du banquet qui suit le meeting, à lancer des incipit de poèmes dont il appartient aux convives de deviner la suite ou l’auteur… Hugo, les socialistes connaissent… Et Chénier… Et même René Char, Eluard ou Rutebeuf… Jusqu’à ces vers de l’obscur René Guy Cadou, inconnu au bataillon des vieux compagnons. Sauf de Pierre qui, seul, dans un silence de glace, reprend à la volée. Un homme qui connaît Cadou est un ami pour la vie.
Un dernier mot. On a beaucoup reproché à Pierre ses colères. Et c’est vrai que ce doux, ce tendre et bienveillant ami était capable de colères terribles – contre les sots et les salauds, contre les faux poètes et les mauvais couturiers qu’il comparait à des peintres d’éventail, contre les requins décorés qui n’entendaient rien à Clovis, à Aragon ou au sens du Sidaction, contre la fausse gauche et la vraie droite, contre les racistes, les homophobes ou, simplement, les tièdes. Pour moi, c’était une autre de ses vertus. Cet homme, qui ne détestait pas haïr, haïssait de toutes ses forces l’idée convenue, et si bête, qui voit dans la colère une passion triste. Il y avait du feu dans ses colères. Et de la joie. Et de la noblesse. Elles étaient une autre marque de sa liberté prodigieuse. Il avait le courage de ses enthousiasmes, de ses dégoûts et de ses goûts, et donc de ses saintes et belles colères. Pour nous, ses amis, elles étaient – et resteront – toujours bonnes conseillères.