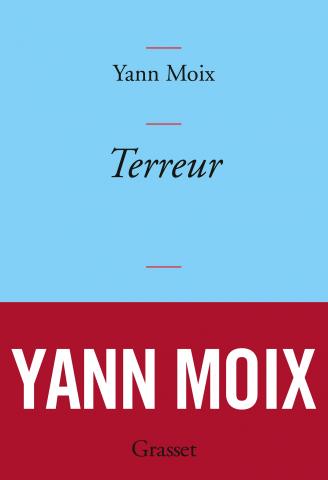Se fâcher avec un ami au sujet du terrorisme et de cette guerre qu’on lui mène et qu’il trouve, lui, mal nommée? Aucun embarras à cela. Ou alors celui de Nietzsche à la lecture d’Aristote rapporté par Diogène Laërce : «O philoi, oudeis philos» – mes amis, il n’y a pas d’amis… il n’y a pas d’amitié qui tienne, non, quand sont en jeu la mort, la vie, l’idée que l’on se fait de la bonne vie… On dit souvent à mon propos : «il a tous les défauts du monde ; mais il faut reconnaître qu’il a le sens de l’amitié.» Eh bien non. Pas comme ça. N’en déplaise aux faux amis qui ne me prêtent ce mérite-ci que pour mieux me dénier les autres, je m’aperçois, une fois de plus, que je n’ai pas cette «morale de l’amitié» qui n’est jamais, au fond, que l’immorale morale des mafias. J’ai rompu avec des amis à cause de la Bosnie. Ou à cause d’Israël. Ou à cause de la Libye. Il m’est arrivé de me fâcher à cause d’un livre, ou d’un film, ou d’un point d’esthétique. Eh bien, aujourd’hui encore : entre la vérité et l’amitié, ou entre la justice et l’amitié, je choisis, sans trembler, la justice et la vérité.
Jour de l’an au Kurdistan puis, les jours suivants, à l’intérieur et aux abords immédiats de Mossoul où, avec Gilles (Hertzog), François (Margolin) et Olivier (Jacquin), nous filmons les dernières images de ce qui sera la suite de «Peshmerga». Ce que nous venons faire dans cette galère ? Et ce qui fait que quatre amis peuvent se retrouver là, ce jour-là, si loin des leurs et si près d’hommes qui, lorsqu’il ne s’agit plus des Kurdes mais des combattants irakiens de la Division d’or, sont, finalement, si peu leur genre et ne leur veulent pas toujours que du bien (j’y reviendrai) ? Je crois que je n’en sais rien. J’ignore à peu près tout, et de ce que l’on cherche, et de ce que l’on fuit, quand on passe ce jour de l’année, celui dont les fastes et les maldonnes étaient censés, selon Ovide, se répéter tout au long des mois suivants, dans un pareil enfer. Bien sûr, la passion du témoignage. Bien sûr, la volonté de se tenir à hauteur de l’événement, le vrai, celui qui fait l’Histoire. Et, bien sûr, le goût de l’aventure – ainsi que la fidélité obscure à des maîtres lumineux qui, sur ce point, ont montré la voie. Mais après ? Est-ce assez dire ? Retour à Paris. Tombé, lors d’une de ces nuits d’insomnie paradoxalement plus fréquentes depuis que j’ai accepté de voir mon sommeil monitoré, à distance, par un Big Brother électronico-clinicien, sur l’entretien de Faulkner avec Jean Stein, en 1956. Il y parle des masques qui le font être, tour à tour, bandit, planteur sudiste, grand alcoolique et poète. Et il les voit, ces masques, comme autant de «sombres jumeaux» dont le ballet incessant fait sa «vie secrète». N’est-ce pas la troisième réponse, me dis-je, à la question existentielle que je me pose depuis quarante ans et qui est celle de la multiplication des vies ? Les vies successives, officiellement consécutives (les grands convertis, Pythagore dont la légende voulait qu’il ait vécu vingt vies entières…). Les vies simultanées, conduites dans la clandestinité (Gary et Ajar, Pessoa et ses hétéronymes…). Mais, là, cette troisième formule qui me paraît, soudain, plus à portée encore : des zones de double vie, des poches d’autre vie dans cette vie-ci, des bouts de vie fantôme qui me font, à tout instant, être un autre. Au matin, et au réveil, les choses me semblent, hélas, moins claires. Mais un insomniaque se réveille-t-il jamais ? Je lis dans les journaux que l’une des sources principales de la décadence de l’Occident serait dans le fait que, contrairement aux djihadistes, nous ne serions, nous, plus enclins à risquer notre vie pour défendre l’idée de la vie à laquelle nous nous prétendons attachés. C’est curieux. Mais j’ai passé la mienne, de vie, à constater exactement l’inverse. A savoir des reporters, des humanitaires et, en ce moment, autour de Mossoul, des soldats français, américains ou (ce qui, en la circonstance, revient au même) kurdes qui prennent bel et bien le risque de mourir pour, non sans héroïsme, défendre cette civilisation prétendument à l’agonie. Sans parler même de ces femmes et hommes qui, à Paris, savent que le prochain attentat se prépare dans un centre de commandement de Mossoul mais qui n’en continuent pas moins de vivre, lire, croire à la poésie, faire la fête – ce qui est une autre façon de résister et de faire montre de vaillance. Non, je n’aime pas ce déclinisme. Je ne crois pas à cette idée d’une Histoire cyclique qui n’en finirait pas de voir les empires déchoir et mourir. A tout prendre, et quitte à pêcher dans les eaux troubles de la grande pensée réactionnaire, autant voir du côté de Thomas Carlyle, dont je découvre par hasard, à Erbil, la théorie du héros et du rôle de l’héroïque dans l’Histoire (Les héros, Maisonneuve et Larose, réédition 1998).
Sur le djihadisme, c’est le livre de Yann Moix, Terreur (Grasset), qu’il faut lire. Et déjà, toutes affaires cessantes, le réjouissant entretien qu’il vient de donner, en marge du livre, au magazine Transfuge. On ne sait jamais ce qui restera d’une œuvre. Et c’est parfois dans les textes les plus inattendus, car les plus apparemment circonstanciels, que l’esprit est allé se loger. Ainsi les Situations de Sartre. Ou le Bloc-notes de Mauriac. Ou le «Journal» de Julien Green. Ou ces Lettrines de Julien Gracq dont il ne fait pas de doute qu’elles resteront alors que se dissolvent déjà, dans la chaux vive de la boursouflure et du sur-style, Le rivage des Syrtes et Un beau ténébreux. Eh bien, dans l’œuvre forte, et déjà si abondante, de cet éternel jeune homme dont j’ai, autrefois, accompagné les débuts, voilà Terreur – qui prend la volonté de néant à bras le corps et lui oppose la surexistence d’un style plus fort, ici, que le nihilisme.