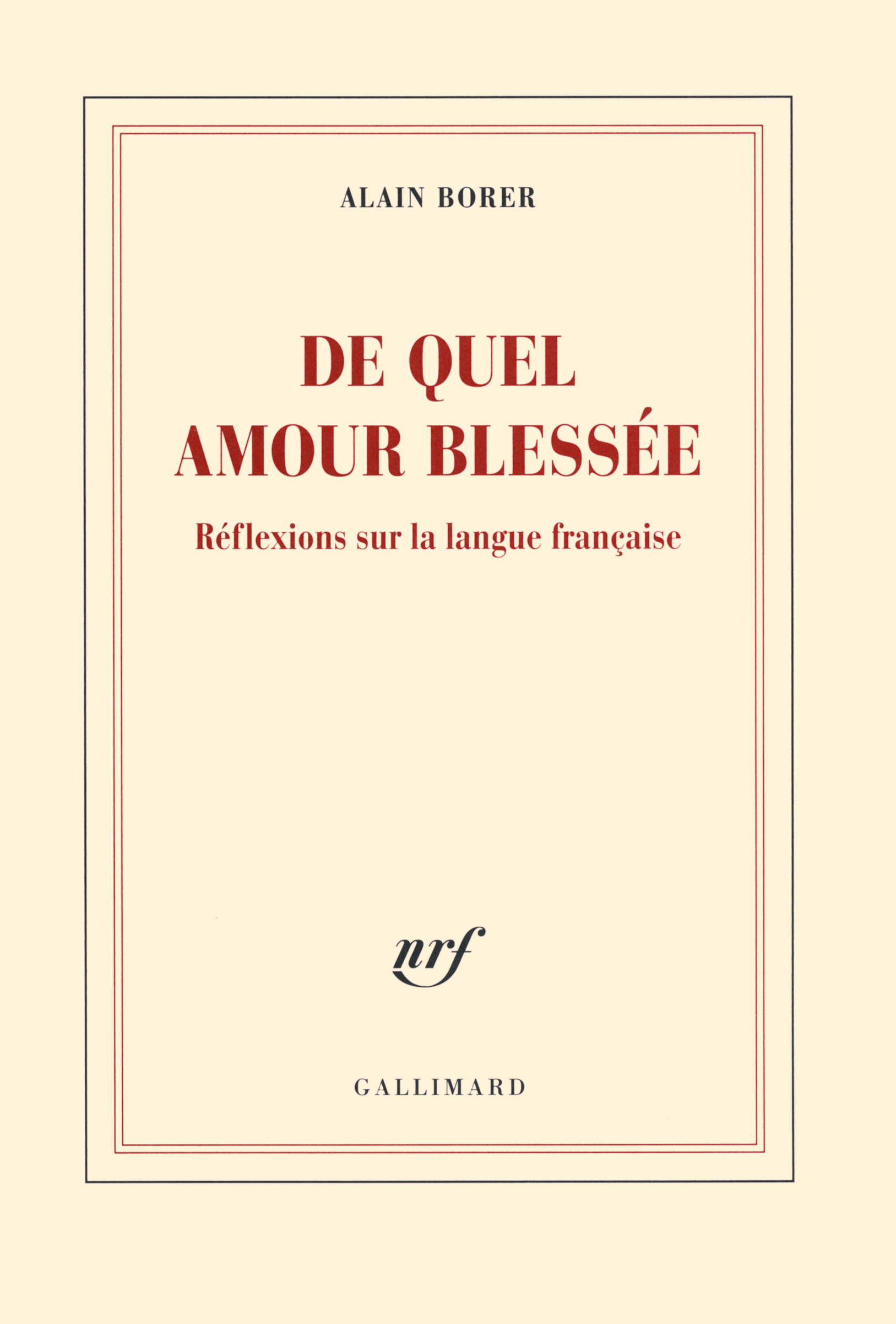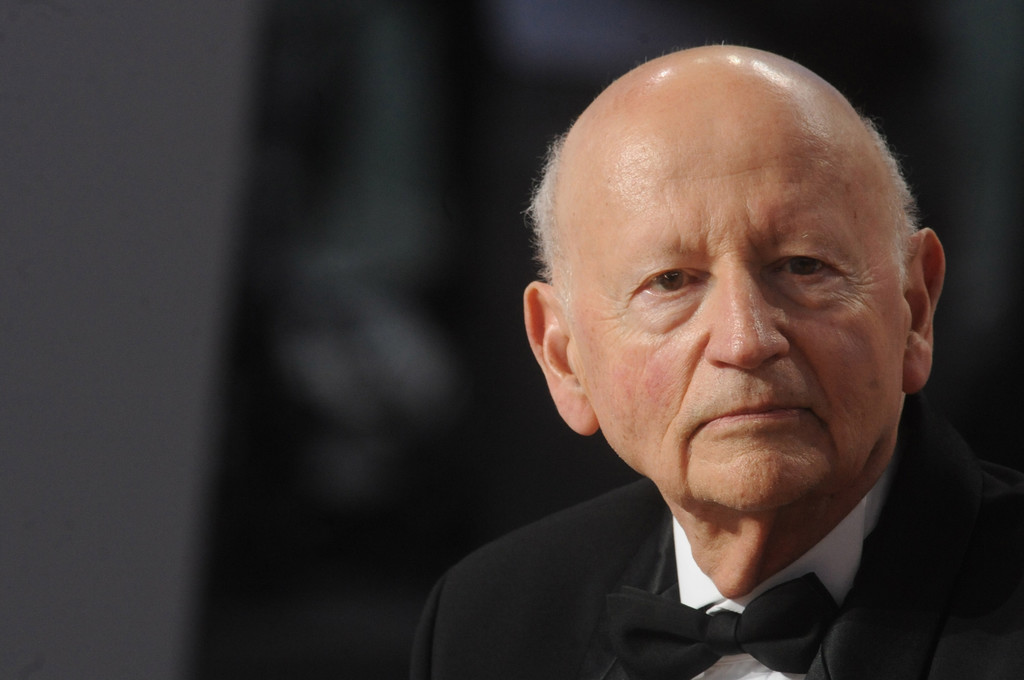Si vous voulez savoir ce qui unit en profondeur les adeptes du djihad, ceux du lepénisme nouvelle tendance et les partisans de l’Eurasie voulue par Vladimir Poutine, si vous voulez comprendre pourquoi on ne peut combattre les uns sans combattre, dans le même élan, les autres et si vous voulez, du coup, cerner les contours de la communauté inavouée de celles et ceux qui ont choisi de se porter sur les trois fronts à la fois, il faut lire sans délai « Génération gueule de bois », le livre que publie, ces jours-ci, aux éditions Allary, Raphaël Glucksmann. C’est une démonstration implacable.
C’est, face aux trois versions de la même réaction antidémocratique, une sorte de « Que faire » allègre mâtiné d’un « Traité du savoir-vivre » à l’usage de cette part de notre jeunesse qui se refuse à l’aquoibonisme et au cynisme. C’est aussi une belle histoire de fidélité – à des idées, bien sûr ; mais aussi aux pères et autres pionniers dont les engagements, manifestement, l’obligent.
Si vous voulez saisir les véridiques enjeux de la nouvelle querelle du latin, si vous voulez voir démontés les mécanismes qui feraient d’un français délatinisé une langue désossée, dépulpée, morte à son tour car semblable à un bouquet de fleurs coupées, alors il faut lire l’étincelant « De quel amour blessée » du rimbaldien Alain Borer : eh oui ! l’auteur de « Rimbaud en Abyssinie » ! l’érudit, poète lui-même, dont les découvertes sur le « devenir pierre » d’Arthur Rimbaud à Harar ont secrètement aimanté une génération d’écrivains voyageurs ! c’est lui qui, rappelant que la langue anglaise est composée, pour deux tiers, de mots français non traduits, puis s’étonnant de l’étrange défaite qui nous a fait préférer « flirter » à « conter fleurette », puis « email » à « courriel » ou « checker » à « vérifier », puis s’indignant, enfin, de notre acceptation veule d’un « globish » ou, pis, d’un « angolais » qui n’est plus, lui-même, que l’ombre de la langue de Byron et de Lawrence, rend à la bataille en cours sa profondeur de champ : par-delà la mémoire de la langue, sa capacité, ou non, à continuer de penser, imaginer et rêver.
Archéologie de Cannes et de son Festival ? Généalogie politico-érotique de cette grande parade de films et d’images qui, chaque année, en cette saison, rejoue sa propre jeunesse ?
Un troisième livre s’impose. Celui de Gilles Jacob qui fut, des décennies durant, l’ordonnateur de la fête. L’action se situe sur le tournage de « Mogambo », au Kenya, où l’on croise Clark Gable, Ava Gardner et son énigmatique sœur. Puis, quinze ans plus tard, sur les barricades d’un Cannes saisi par la fièvre de cet « émoi de Mai » où l’on vit des artistes nommés Godard ou Truffaut rêver d’un autodafé qui eût été leur acte de foi dans un monde guéri d’une culture indissociablement vécue comme le sens même de leur vie et le dernier obstacle, hélas, dans l’assaut donné au ciel. A moins que ce ne soit dans cet éternel présent où un immortel ministre vint, en haut des célèbres marches, remettre une palme d’or imaginaire aux artisans de la « mystérieuse fraternité » des images de la « terre heureuse » et de la « terre sanglante et menacée » qu’incarne aussi le cinéma. Il est vrai que ce ministre s’appelait André Malraux !
C’est le centième anniversaire du génocide arménien. Et il se trouve encore des assassins de papier pour refuser aux enfants des morts et des survivants, à leurs petits-enfants, et arrière-petits-enfants l’humble consolation d’être les tombeaux vivants de leurs pères. Si vous voulez prendre la mesure de ce déni et de la souffrance qui va avec, si vous voulez sentir le poids de ces paroles tues, suffoquées ou chuchotées, si vous voulez vous mettre dans la peau d’une petite fille qui voulait être juive, car les juifs, eux, malgré tout, sont « autorisés » à se souvenir et à savoir, puis d’une jeune fille qui, lorsqu’elle demandait à sa grand-mère : « raconte-moi les convois, les corps décharnés dans les wagons à bestiaux, la lamentation des enfants, le crime gravé dans leurs chairs tendres et, à la gare d’Alep, les portes du salut », puis d’une femme accomplie qui, renouant le fil rompu et recollant, vaille que vaille, les éclats brisés des vases de sa mémoire, fera de la solidarité des ébranlés le principe de sa vie et sa boussole, eh bien c’est un autre roman qu’il faut lire – celui de Valérie Toranian, « L’étrangère », Flammarion. Exercice de résurrection et de deuil. Leçon de ténèbres et de lumière gagnée. Que disaient d’autre les inventeurs de la tragédie lorsqu’ils mettaient en garde contre les blessures saignant jusqu’à la fin des temps ?
Et puis encore « Le réveil français » de Laurent Joffrin, Stock, dont il faudrait pouvoir prescrire la lecture à ceux que navre la tournure qu’est en train de prendre notre débat intellectuel national. Onfray traitant Manuel Valls de noms d’oiseau… Zemmour réhabilitant Pétain… Todd qui, quarante ans après « La tentation totalitaire » de Jean-François Revel, ose écrire que son « flash totalitaire » à lui fut la manifestation civique du 11 janvier dernier. Mauvais triangle. Bermudes de l’esprit et du sens. Et les réflexes les plus simples comme des commandes qui ne répondent plus. Face à quoi, oui, l’incertaine mais têtue idée d’une France qui, « de Victor Hugo à Jean Cabu », ne s’est jamais complètement résignée à préférer l’identité au droit, le complot au débat et la mythologie du déclin au mythe de la République.