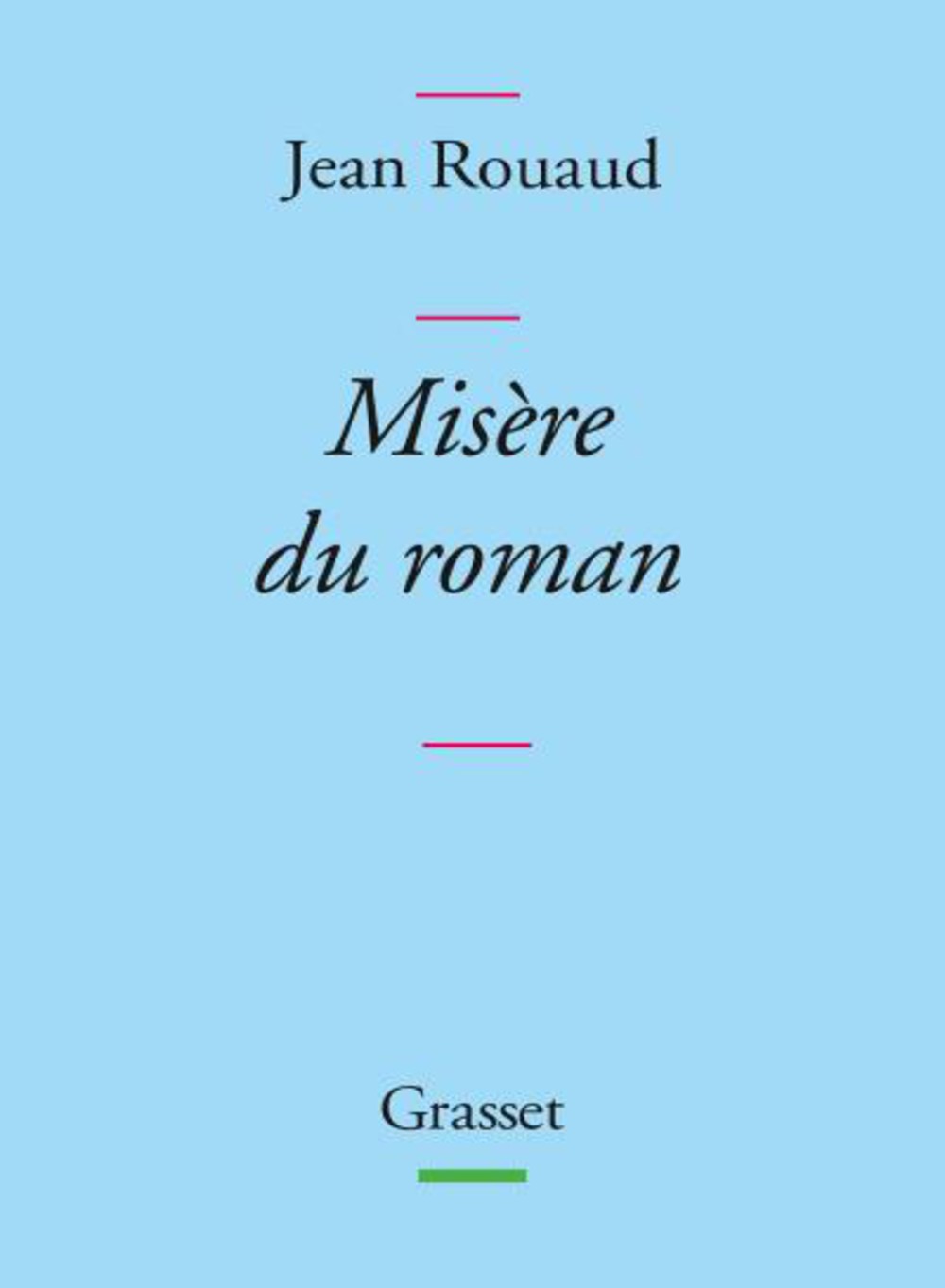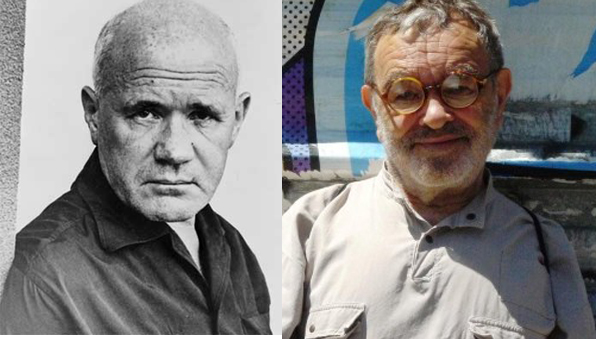Jean Rouaud publie simultanément en ce mois de mars 2015 le quatrième volet de son cycle « La Vie poétique » intitulé Être un écrivain et un petit recueil de trois essais (deux conférences et un article) réunis sous le titre Misère du roman. La lecture parallèle des deux ouvrages semble aller de soi. Mais il ne sera question dans cet article que du texte de la conférence de Kobe sur le roman.
Comme l’annonce le bandeau rouge sur la couverture bleue de l’essai, il s’agit de littérature, d’idéologie et d’histoire. Les trois textes sont présentés dans l’ordre chronologique inverse : la conférence a été prononcée à Kobe le 11 novembre 2014, et on y parle de la guerre de 14. Le conflit marque le début véritable du XXe siècle et, selon Rouaud, la fin du roman tel qu’envisagé par Balzac, Flaubert ou Zola. Zola qui descendait dans la mine pour en remonter aussitôt, faisant un tour de documentation « au fond » pour Germinal. Les bleuets de la Grande Guerre avaient tous bénéficié des lois Ferry sur l’école gratuite et obligatoire. Ils savaient lire et écrire. Ils ont tenu des carnets, envoyé des lettres. Les romans nés de cette période ouvrent une ère sinon nouvelle pour le roman, à tout le moins différente. Il ne s’agit plus d’aller faire un tour au fond — au front — pour rapporter de la documentation sur le vif. Là, c’est dans sa chair même, dans l’horreur des tranchées, dans la boue et le bruit et l’attente que l’on vit. Le réalisme a le goût du sang. « Celui qui raconte [la guerre] c’est un peu comme si le mineur de Zola avait pris lui-même son crayon pour dire sa mine ».
D’une guerre à l’autre, de la boucherie de 14 à l’humiliation de 40, le roman effectue sa mue, ou plutôt entre en « décomposition ». Et sur les ruines des bombardements apparaît le Nouveau Roman. Puis arrive l’autre guerre, la froide. Les écrivains et le parti communiste, l’aveuglement stalinien. Cette fois-ci, c’est bien fini, sus aux bourgeois, le roman bourgeois est mort. Le roman tout court, d’ailleurs. C’est l’avènement des Sciences Humaines en littérature.
Pour l’année du centenaire, Rouaud fait sa fête à Barthes. Et pas qu’à lui, mais l’auteur du Degré zéro de l’écriture est en première ligne. Héraut de la mort du style, puis de la mort de l’auteur. Qu’il remplace par l’écriture et le lecteur, deux vocables non sujets à caution du point de vue politique. « [Barthes…] aboli[t] la différence de hauteur poétique entre la carte postale, la liste des courses et les Illuminations ». Et plus loin : « Lire, c’est écrire. Le procureur politique en a de ce moment fini avec l’épuration des concepts délétères de la littérature bourgeoise qui est une littérature de classe ».
Le texte de la conférence de Kobe est un portrait à charge de l’intelligentsia littéraire française qui a sévi après guerre, et jusque dans les années 90. Retournements, revirements. L’universitaire, le structuraliste et le staliniennement correct y sont pointés avec force et conviction. Jean Rouaud mentionne avec émotion et respect Milan Kundera, qui a su préserver la veine romanesque sous le joug du totalitarisme, et démonter – déconstruire – par son œuvre l’inanité des théories littéraires en vogue à l’époque en France : « Ce que [Kundera] avait à nous dire était proprement sidérant : que le roman, oui, ce roman dont on se détournait en se pinçant le nez, avait été pour lui un acte de résistance à la dictature ».
N’oublions pas, cependant, que la main-mise en France des Sciences Humaines sur la littérature, bien réelle, n’était que de façade. Façade bien en vue dans les revues et suppléments littéraires, qui cachait, occultait, l’œuvre au noir de romanciers pour qui l’imaginaire était encore un territoire fécond, à défricher inlassablement. Hubert Haddad, Georges-Olivier Châteaureynaud, et avec eux les autres membres de la Nouvelle Fiction, et bien d’autres encore, au cœur des années 70 et 80, ont publié, ont été lus et primés. La colère qu’exprime Jean Rouaud est une déclaration d’amour au roman, lieu privilégié : on y distille un temps qui joue sur la mémoire et la diégèse, on y déploie et forge sa phrase à contre-courant de l’écriture banalisée.
Finissons en citant un extrait d’Être un écrivain — décidément, les lectures parallèles s’imposent : « M’imposer des contraintes pour contrecarrer mes emballements lyriques, à quoi je m’acharnais, prendre une belle phrase et la tordre pour qu’elle ne fasse pas les yeux doux, malmener la syntaxe pour qu’elle ne prenne pas la pose, manifestement ne m’aidait pas si j’en étais à tenter d’ouvrir une brèche dans la cloison avec mon front ».
Le roman selon Rouaud, comme un travail poétique au long cours, comme la lutte de chaque mot pour faire naître l’histoire.
Jean Rouaud et le roman
par Christine Bini
20 mars 2015
Dans "Misère du roman", Jean Rouaud dresse une histoire du roman, du début du siècle dernier à nos jours.