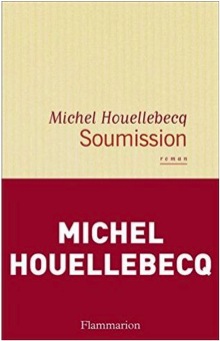Erreur de gauche. Houellebecq est un salaud. Un facho. Un ennemi du genre humain et de ses droits. Un anti-moderne. Un qui croit à l’extinction des Lumières et s’en réjouit. Un islamophobe inguérissable qui se refuse, de surcroît, à voir dans l’islamophobie une forme de racisme. Un Zemmour chic. Un Finkielkraut artiste. Odieuse est sa façon même de dire, par exemple, « les » musulmans. Redoutable, cet amalgame qu’il pratique entre les bons et les mauvais, les obscurantistes et les éclairés, ceux qui croient au ciel et ceux qui croient à l’enfer, ceux qui croient tout court et ceux qui ne croient plus. Et criminelle cette intrigue où l’on voit les adorateurs d’un Coran finalement « moins con » que ne le proclamait le Houellebecq d’il y a dix ans piaffer aux portes du pouvoir et n’attendre qu’une crise politique pour coiffer au poteau leurs jumeaux du Front national. Sans parler des femmes. Ou, plutôt, de sa haine, de sa peur panique des femmes réduites à des pourvoyeuses de plaisirs brefs, furtifs, si possible non partagés, glauques. Son roman n’est pas un roman, c’est un tract. Et ce tract est un cadeau inespéré aux pires identitaires qui voient ainsi validés leurs thèmes, leurs obsessions, leurs phobies. Suicide français ? Non. Suicide d’un écrivain français, enfant terrible des lettres, provocateur patenté – mais qui, là, avec ce roman beauf prenant Huysmans en otage et Robert Redeker pour témoin d’immoralité, aurait commis le dérapage de trop. Adieu Houellebecq.
Erreur de droite. Houellebecq est un héros. Un héraut. Il donne aux choses leur nom et aux noms leur poids de haine et de juste vengeance. Il dit tout haut ce que les bons Français pensaient tout bas mais que le politiquement correct interdisait jusqu’ici de dire. C’est un preux et un prophète. C’est le premier romancier à oser faire littérature de ce « grand remplacement » que l’on s’époumone à annoncer mais que lui décrit avec une précision clinique et tragique. C’est le premier à accepter de voir ce que la bien-pensance s’offusquerait devoir : ne lui en coûterait-il pas ses illusions progressistes ? ses contes de fées antiracistes qui ne sont, c’est bien connu, que l’autre face d’une barbarie qui ne disait pas son nom mais qui, là, dans cet exercice de mentir-vrai, le trouve ? dépeindre ce qu’il dépeint, à savoir la lutte à mort entre la République et l’islam, entre les Français de souche et de papier, n’est-ce pas la sainte tâche à laquelle se dérobent nos pleutres littérateurs ? Ah, quelle joie de voir définitivement ridiculisés nos pathétiques droit-de-l’hommistes. Quel réjouissant portrait du grotesque Bayrou prêt à toutes les alliances, palinodies, voire conversions, pour obtenir enfin son hochet présidentiel. Et quelle justesse de trait quand il prévoit les foudroyants progrès, de Picsou Magazine à l’université Paris-Diderot, du centre commercial Super-Passy au siège de la DCRI, d’une « Eurabia » dont les idiots utiles de l’islamisme ont fait patiemment le lit. « Soumission », c’est la revanche de Renaud Camus. C’est le grand retour du Céline censuré par les bien-pensants. C’est le roman qu’aurait pu écrire Philippe Muray s’il avait su se dégager de ses derniers scrupules humanistes. Un symptôme ? Non. Une conclusion. La mort en fanfare de cette pensée unique qui est comme un bœuf sur la langue des élites françaises depuis cinquante ans. Merci Houellebecq.
Connaissant un peu l’auteur et ayant, sur les uns et sur les autres, le léger mais non négligeable avantage d’avoir coécrit un livre avec lui (« Ennemis publics ») où s’affrontaient nos deux visions du monde, il me semble ne pas me tromper en affirmant que l’on commet, dans les deux cas, la même erreur – il est vrai courante s’agissant d’un romancier : le confondre avec ses personnages, lui attribuer leurs points de vue et transformer en thèses les hypothèses, les fictions, les situations qu’il met en scène. Pour le dire clairement, croit-on vraiment que cette gauche spectrale qui espère, comme le suggérait récemment un bonimenteur à face de socialiste, sauver sa peau en lâchant Israël au profit d’une « communauté » électoralement plus payante, soit une invention de Michel Houellebecq ? Une UMP tentée, à 85 %, de faire alliance avec le Front national, est-ce une perspective si impensable que cela ? Et ne vous dit-elle rien, cette France moisie, rancie, à bout de souffle, peuplée de zombies politiques voyant dans le fascisme, quel qu’il soit, la fantomatique mais ultime tentative de redonner vie à la nation morte ? Un roman est une invention, pas une réalité. Ou, plus exactement, la réalité n’est pas le produit du roman, mais son présupposé, le matériau qu’il doit traiter et dont il déploie, concentre ou accélère les virtualités. « Soumission », autrement dit, est une fable. C’est un conte cruel et grinçant. C’est une satire dont la démesure et la mauvaise foi n’ont d’égale que la manière dont vient la rattraper tel ou tel épisode de la plus brûlante actualité : le Club Med racheté par les Chinois, le Qatar à tous les étages ou ces vaisseaux fantômes qui croisent au large de nos côtes et dont nous aimerions tant ne rien savoir. Ne pas comprendre cela, c’est ne rien entendre à l’économie de cet étrange territoire qu’est le roman et où, comme disait Kundera, tout jugement moral est suspendu. Et s’il est parfaitement absurde d’identifier Houellebecq à son Des Esseintes de Chinatown, la plupart de ceux qui le font sont, eux, qu’ils le veuillent ou non, des personnages de son roman.
Houellebecq, écrivain
par Bernard-Henri Lévy
6 janvier 2015
Un roman est une invention, pas une réalité. « Soumission » est une fable.