Liliane Lazar : Pourquoi avez-vous écrit principalement des pièces de théâtre plutôt que des romans ou des nouvelles ?
Arthur Miller : J’ai du talent pour écrire des pièces de théâtre. Toutefois, mon autobiographie a été traduite en français sous le titre de Au fil du temps et dans dix-huit langues. Une de mes nouvelles dont le titre en anglais est Homely Girl vient d’être publiée aux éditions Grasset ainsi qu’aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.
L. L. : Vous avez commencé par écrire des pièces radiophoniques. Ont-elles eu une influence sur vos œuvres suivantes telles que La Mort d’un commis voyageur, Les Sorcières de Salem, Une vue du pont ?
A. M. : Seulement parce qu’elles m’ont permis de survivre. J’ai gagné ma vie après mes études universitaires en écrivant des pièces pour la radio pendant quelques années.
L. L. : Y a-t-il une similarité entre faire un film et écrire une pièce de théâtre ?
A. M. : C’est tout à fait différent. Un film est totalement différent. Comme dans une pièce, il y a des acteurs et un dialogue mais autrement on raconte une histoire avec des images. Sur la scène on raconte une histoire avec des mots. Je préfère écrire des pièces parce que mon contrôle est plus grand.
L. L. : Avez-vous mis en scène vos propres pièces ? Si oui, lesquelles ?
A. M. : Oui, aux Etats-Unis, en Suède et en Chine, j’ai mis en scène La Mort d’un commis voyageur. A New York et New Haven j’ai dirigé deux pièces intitulées Une certaine histoire d’amour et Elégie pour une dame.
L. L. : Quel auteur dramatique américain contemporain admirez-vous ?
A. M. : Nous avons plusieurs auteurs dramatiques intéressants : Edward Albee, David Mamet, Sam Shepard.
L. L. : Qui vous a influencé en tant qu’auteur dramatique ?
A. M. : Clifford Odets, Strindberg, Ibsen.
L. L. : Plusieurs critiques vous ont décrit comme : « l’Ibsen américain ». Comment y réagissez-vous en tant qu’auteur dramatique ?
A. M. : Je ne suis pas du tout d’accord. Il a influencé mes premières pièces comme Tous mes fils, mais il n’a eu aucune influence dans les pièces suivantes.
L. L. : Un grand nombre de vos pièces ont été jouées en France. Que pensez-vous de la différence entre le public français et américain ?
A. M. : Je pense qu’ils sont très différents. C’est très rare qu’une pièce française ait du succès aux Etats-Unis. Il arrive que les pièces américains soient bien reçues en France.
L. L. : Mais vous avez eu beaucoup de succès en France.
A. M. : Oui, mais en général elles ne s’intègrent pas très bien…
L. L. : Pourquoi ?
A. M. : C’est une culture différente. Probablement les Français sont plus capables d’apprécier les métaphores intellectuelles tandis que nos pièces sont beaucoup plus réalistes.
L. L. : Connaissez-vous des auteurs dramatiques français ?
A. M. : Les anciens : Molière, Racine, Corneille. Du XXème siècle je connais Anouilh, Marcel Aymé, Sartre, Ionesco.
L. L. : Quelles pièces avez-vous vues à Paris la dernière fois que vous étiez en France ?
A. M. : Je ne suis pas allé au théâtre en France depuis des années. Je n’ai pas non plus mis les pieds en France depuis bien longtemps.
L. L. : Pensez-vous y retourner ?
A. M. : Je pense y aller à la fin mai. Je dois me rendre à Londres et comme ma femme a habité plusieurs années à Paris, elle meurt d’envie d’y retourner, moi de même. Nous avons de très bons amis à Paris.
L. L. : Que pensez-vous des théâtres nationaux comme la Comédie-Française et le Théâtre national populaire (T. N. P.) ?
A. M. : Je pense que c’est formidable. On n’en a pas ici. J’ai essayé d’encourager un théâtre national, mais je ne vois aucun résultat. Du point de vue culturel, nous n’avons jamais eu de théâtre subventionné dans ce pays, un peu par-ci, par-là, mais pas beaucoup. Il y a une hostilité culturelle. Aux Etats-Unis, le théâtre est considéré comme une entreprise commerciale. On pense que le théâtre est fait pour distraire pas pour s’enrichir culturellement.
L. L. : Quel est le rapport entre le théâtre et la société ?

A. M. : Le rapport entre le théâtre et la société change d’une époque à l’autre. Cela a définitivement changé non seulement aux Etats-Unis, mais ailleurs aussi. La télévision a canalisé les spectacles. Actuellement, à la différence de ce qui se passait il y a trente ou quarante ans, dans les années cinquante, le grand public – si on peut dire – a abandonné le théâtre. Il n’y a presque plus rien, sauf quelques comédies musicales. Il y a encore quelques bribes off-Broadway, les marginaux anglais sont toujours là, mais le grand public regarde la télévision. On ne va plus au théâtre. Le résultat a été un changement de nature de l’écriture dramatique. C’est une question très complexe. Avant 1960, l’auteur dramatique s’adressait à ce qu’il concevait comme l’ensemble des Américains. Cependant, ce n’était ni littéralement ni statistiquement vrai. Néanmoins la perception, qui est aussi importante que les faits, était qu’on avait un rapport avec toutes sortes de gens : intellectuels, avocats intelligents, docteurs, mêmes des ouvriers. Ce n’est plus le cas et cela ne l’a pas été depuis au moins trente-cinq années. Le résultat est que les pièces rapetissent en ce sens qu’elles n’englobent pas les fortes émotions, les grands sentiments que nous associons avec la confrontation du public. Les pièces de théâtre sont peut-être devenues plus sophistiquées et dans un certain sens plus littéraires. On insiste plus sur le style et la forme que sur le sujet comme auparavant. On entend de toutes parts des reproches de la part des jeunes – des observations plus que des reproches – qu’à la différence de Eugene O’Neill, Tennessee Williams et peut-être de moi également, il y a beaucoup de bons auteurs dramatiques, nous en avons même beaucoup actuellement, mais ils s’adressent à une fraction du public. On peut le voir à la façon d’écrire les pièces et de formuler des hypothèses.
Je pense d’ailleurs que quelque chose de semblable est arrivé à des époques différentes dans des pays différents. Les Britanniques ont trouvé un compromis à ce problème. Il ont subventionné le Nation Theater, The Royal Court, The Royal Shakespeare et de nombreux théâtres dans des petites villes en dehors de Londres qui profitent de la subvention du gouvernement. Le résultat a été de perpétuer une sorte de théâtre national. Ils ont donc le choix de produire des pièces mineures qui s’adressent à une coterie ou des pièces majeures qui s’adressent au grand public. Ici, on n’a pas ce choix. L’année dernière à Broadway, il n’y avait aucune pièce à part la mienne, qui a d’ailleurs disparu après deux mois à cause des frais. Les frais de production sont tellement énormes qu’à moins de faire salle comble, on fait le plongeon. Donc il ne reste rien à Broadway, sinon des comédies musicales.
L. L. : Et le théâtre off-Broadway ?
A. M. : Il y a beaucoup de théâtres off-Broadway, mais il y a aussi un problème. Avec ce théâtre, on ne peut pas garder les acteurs. Ils ne gagnent pas leur vie. Si un acteur joue off-Broadway, son seul espoir est d’être découvert par une compagnie de cinéma ou de télévision pendant les représentations car il ne peut pas subvenir aux besoins de sa famille. Dans un théâtre de cinquante, soixante-quinze ou cent places, personne ne peut être décemment payé et les acteurs ne gagnent pas assez. Il est difficile de trouver des acteurs de plus de trente ou trente-cinq ans.
L. L. : Ils ne veulent pas jouer ?
A. M. : Ils ne sont plus là. Ils sont partis en Californie ou ils jouent à la télévision. Il y a toujours quelques adeptes du théâtre, mais ils ne sont plus qu’une poignée.
L. L. : A votre avis, quel est l’avenir du théâtre ?
A. M. : L’avenir est très sombre et difficile, à moins que – mais je n’en vois aucun signe actuellement – l’on fasse un effort pour trouver un solution grâce aux dons des grosses entreprises comme elles le firent jusqu’à un certain point dans les années soixante-dix et quatre-vingt en faveur de divers théâtres. C’était une solution bancale. Peut-être du fait que les affaires ne soient plus si bonnes, elles ont décidé de ne plus donner d’argent en faveur des Beaux-Arts. I.B.M., General Motors ou toutes ces grosses entreprises donnaient de l’argent à des théâtres régionaux en dehors de New York. Ces théâtres régionaux recevaient des subsides. Un théâtre comme le Long Wharf à New Haven est maintenant un des plus anciens et des mieux établis en Amériques du Nord. Ils sont pourtant presque à sec et ont des difficultés à trouver de l’argent parce que le soutien des entreprises a pratiquement disparu. Ils ont dû par conséquent limiter le nombre de pièces qu’ils pouvaient monter. Au lieu de six pièces, ils n’en font plus que quatre. En plus, pour retenir leur public, ils montent de plus en plus de pièces dont le succès est garanti.
L. L. : Des pièces classiques ?
A. M. : Ce ne sont pas des pièces classiques. Ce sont des farces idiotes d’il y a trente ans qui sont assurées d’amener un grand public parce que ces théâtres sont au bord du désespoir. Il y a un découragement réel. Plusieurs théâtres ont fermé. On menace maintenant de leur retirer le peu d’argent du National Endowments for the Arts. Le peu qu’il reste sera soit rogné, soit supprimé, paraît-il. Chose étrange, le soutien pour le National Endowments for the Arts est plus important dans les petits Etats de l’Ouest où il n’y a pas une grande population. Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas d’autre choix. A New York, on peut toujours trouver quelque chose pour se distraire : des centaines de films et il y a toujours un théâtre quelque part, tandis que dans des Etats comme le Washington, le Wyoming ou le Montana, même l’Oregon, il ne se passe pas grand-chose, donc ce qui était subventionné par le National Endowments for the Arts devient extrêmement important. Il y a des gens dans certaines de ces régions qui n’avaient jamais vu d’opéra auparavant. Alors la population apporte son soutien même si les sénateurs sont très conservateurs et réactionnaires. Elle est plus motivée à soutenir le théâtre que celle des grandes villes. Il y a douze millions de personnes à New York, ils trouveront toujours quelque chose à faire.
L. L. : Les comédies musicales ?
A. M. : Les comédies musicales sont et ont toujours été la distraction des masses. C’est vrai aussi pour les films. Les comédies musicales filmées ont toujours été populaires.
L. L. : Y a-t-il une tradition théâtrale aux Etats-Unis comme en Europe ?
A. M. : Nous avons une tradition théâtrale aux Etats-Unis, mais cela change, se développe, évolue d’une décennie à l’autre. Dans les années vingt, c’était extrêmement populaire et important. Le théâtre avait beaucoup de prestige. Il prospérait dans beaucoup de villes : Los Angeles, Chicago, New York et des douzaines d’autres. Elles avaient leurs propres compagnies théâtrales, tout comme en Europe, mais c’était un théâtre strictement commercial et il n’était pas subventionné partout. Le cinéma est arrivé et plus spécialement les films parlants. A la fin des années vingt, ils ont commencé peu à peu à empiéter sur le théâtre et dans des douzaines de petites villes les théâtres ont commencé à fermer ou ont été transformés en salles de cinéma.
L. L. : Quel est le rapport entre la forme et le contenu dans vos pièces ?

A. M. : C’est difficile d’émettre des généralités parce que j’ai utilisé une douzaine de styles différents dans mes pièces. Cela dépend largement de mon approche, soit le point de vue psychologique ou aristotélicien soit le point de vue social. Dans le théâtre grec, on fait ressortir principalement l’action, autrement dit l’histoire. Le théâtre grec avant sa fin a évolué, il est devenu plus psychologique. Ces deux éléments, je crois, déterminent plus ou moins le style utilisé. Avec les années, j’ai choisi plusieurs stratégies différentes. La pièce Tous mes fils est différente de La Mort d’un commis voyageur qui est différente des Sorcières de Salem qui est tout à fait différente d’Une vue sur le pont. J’ai essayé d’équilibrer les deux points de vues pour que chaque aspect ait son propre domaine ou son propre territoire. Je n’ai jamais écrit de pièce qui ne comporte pas un fort élément psychologique. Même Incident à Vichy est une pièce dont le sujet principal est l’action dramatique. Les personnages se trouvent tous prisonniers dans un commissariat de police, personne ne peut partir ni se déplacer beaucoup, mais c’est essentiellement un drame d’action.
L. L. : Incident à Vichy semble un euphémisme pour ce qui s’est passé dans cette salle de détention en 1942. Pourquoi avoir choisi ce titre d’ « incident » au lieu de rafle, arrestation, tragédie ?
A. M. : Parce qu’à l’époque, je suppose, c’était considéré comme un incident, même si c’était un curieux incident. Le titre est plutôt ironique puisqu’un incident signifie un petit événement sans importance et pas particulièrement connu.
L. L. : Dans Incident à Vichy, le docteur déclare : « Chaque homme a son juif ». Avez-vous été influencé par Sartre qui a écrit dans Réflexions sur la question juive : « Le juif est toujours l’autre », et aussi « Si les juifs n’existaient pas, les antisémites devraient les inventer. »
A. M. : Je ne connaissais pas ces déclarations de Sartre, mais c’est la même idée.
L. L. : Dans Réflexions sur la question juive, Sartre offre une solution optimiste au problème de l’antisémitisme dans sa foi en la solidarité humaine. Dans L’Etre et le Néant, il est pessimiste au sujet des relations humaines. Laquelle des deux positions est la plus proche de votre point de vue ?
A. M. : Je suis plutôt pessimiste en vue de ce qui arrive aux Etats-Unis. Je ne connais pas assez bien l’Europe, donc je ne peux pas juger. Je dois de nouveau confronter ici ce mystère qui n’est pas si mystérieux, mais qui a une certaine mystérieuse qualité du fait que périodiquement la société ou une partie de la société se dresse contre les juifs. On a cela maintenant.
Ce n’est pas du tout une situation critique. Je pense que la majorité des gens ne sont pas comme cela, mais il y a un mouvement dans ce pays contre les juifs. C’est en partie l’aile droite du parti républicain qui s’appelle chrétien. Ils rejettent tout sur une conspiration des juifs. C’est une sorte de paranoïa qui a pénétré jusqu’au cœur de la société, comme un virus, mais la plupart du temps, on ne le remarque pas. Nous sommes maintenant à une époque où l’on se pose une grande question au sujet de l’avenir. C’est la première fois qu’une génération américaine n’est pas plus riche que la précédente. Il y a des problèmes raciaux qui ne disparaissent pas. Il y a des problèmes de pauvreté qui ne disparaissent pas. Il y a de nombreux problèmes tandis qu’il existe une formidable prospérité à partir d’un certain niveau de revenu. La distance entre les riches et les pauvres ou le niveau inférieur de la classe moyenne est plus grande que jamais. C’était le cadeau de Ronald Reagan au pays. Il a réduit les impôts des riches partant de l’hypothèse que plus ils auront de l’argent, plus les pauvres en bénéficieraient, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire du monde et n’est pas encore arrivé ici. Donc, étant donné ces problèmes économiques et les nombreuses difficultés politiques, les gens ne sachant pas où trouver une explication, se tournent vers ce qui est mystérieux. Les juifs sont mystérieux peut-être parce qu’en dépit de tout, nous survivons. Sartre a absolument raison. S’il n’y avait aucun juif, on devrait les inventer. On trouverait un autre bouc émissaire.
L. L. : Pourrait-on dire que tous les personnages d’Incident à Vichy, à l’exception de von Berg, sont de « mauvaise foi » suivant la définition de Sartre qui est de rejeter la responsabilité en faveur du déterminisme ?
A. M. : Oui, la pièce est satirique en ce sens que la personne socialement irresponsable, cet aristocrate de von Berg, assume sa responsabilité par fidélité à une vieille idée romantique.
L. L. : Vous êtes-vous inspiré de faits historiques ou imaginaires ?
A. M. : Oh non ! C’est scrupuleusement historique.
L. L. : Y avait-il un prince allemand ?
A. M. : Non, c’est inventé, mais le processus décrit est réel.
L. L. : Quelle a été la réaction du public français devant Incident à Vichy quand cela a été joué pour la première fois çà Paris dans les années soixante ?
A. M. : Il m’est difficile de m’en souvenir, mais les revues de presse étaient divisées. Certaines étaient très positives. D’autres pensaient que ce n’était que des mots et furent hostiles à l’idée même de la pièce. A part cette production des années soixante, il y eut deux autres metteurs en scène intéressés par cette pièce, mais ils ont finalement décidé de ne pas la monter par crainte de répercussions désagréables.
L. L. : Dans votre théâtre, vous semblez intéressé par le succès et les échecs du rêve américain. Pourriez-vous parler de l’influence de ce rêve dans votre œuvre ?
A. M. : C’est politiquement et socialement essentiel dans ce pays. Je pense que la raison de la poussée actuelle de la droite vient de ce que les gens réalisent que pour la première fois dans l’histoire américaine, comme je l’ai dit tôt, ils sont plus pauvres que leurs pères. Cela veut dire que le rêve est plus faible. Les gens veulent le retour du rêve.
La rhétorique est que la droite le fera revenir. Comment ? Ils ne le disent pas implicitement, mais ils le laissent présumer. Ils veulent un pays essentiellement composé de familles blanches, mais ils n’ont pas beaucoup de partisans auprès des autres car une grande partie de notre population maintenant – encore une minorité – est noire ou hispanophone ou autre, mais ce rêve de la famille blanche aisée, bien au chaud est en danger. Cela fait vingt-cinq, trente ans ou plus qu’il est menacé, mais maintenant les gens se rendent compte que quelque chose va très mal et que les choses se gâtent, alors les gens désirent retrouver un cadre plus traditionnel. C’est une réaction contre les années soixante, mais même les années trente, l’Etat Providence. Ils veulent s’en échapper si possible. Naturellement quand les choses deviennent plus spécifiques, ils ne sont pas si désireux de s’en échapper parce que chacun d’une manière ou d’une autre est sur le même bateau.
L. L. : Le sujet de vos pièces est dont toujours le rêve américain…
A. M. : Oui, c’est toujours le sujet et, en fait, la production de mes pièces augmente chaque année depuis ces douze ou quinze dernières années. Il y a plus de représentations de mes pièces aux Etats-Unis et à l’étranger que jamais auparavant.
L. L. : Probablement à cause de la permanence d’un thème comme celui de La Mort d’un commis voyageur.
A. M. : Ce n’est pas seulement La Mort d’un commis voyageur. J’ai d’autres pièces qui sont représentées bien plus souvent.
L. L. : Lesquelles ?
A. M. : Les Sorcières de Salem presque deux fois plus. Une vue sur le pont est énormément mis en scène. Broken Glass (Verre brisé) se joue maintenant dans six pays.
L. L. : Lesquels ?
A. M. : En Allemagne, cette pièce ouvrira en mai, en France en septembre, en Grèce, Norvège et au Danemark dans quelques mois. En Angleterre, on la joue depuis presque un an et elle va ouvrir dans le West End à Londres après sept mois de représentations au National Theater. Elle se joue aussi en Espagne, Italie, Argentine et quatre ou cinq pays d’Amérique latine.
L. L. : Quel est le thème principal de Broken Glass ?

A. M. : Le refus. C’est le refus à une petite échelle dans un petit foyer de Brooklyn et dans ce mariage, mais aussi à grande échelle par rapport au national socialisme, aux nazis et à l’explosion qui se termine par l’hémiplégie de Sylvia. Ce refus la paralyse. Comme toujours j’ai essayé de retracer l’impact d’un événement gigantesque et son influence métaphysique sur les êtres humains parce que je suis persuadé que nous sommes tous affectés par ces grands événements. Nous sommes tous affectés différemment. On n’est pas tous affectés de la même manière et c’est la différence qui créé le drame.
L. L. : Pensez-vous que Phillip Gelburg, le mari de Sylvia, soit un juif antisémite ?
A. M. : Oui, bien sûr, mais lui-même ne s’aime pas non plus. Il ne s’aime pas d’une manière particulière. Il réagit contre son auto-détresse en revendiquant une sorte de mentalité fasciste contre lui-même, sa femme, les juifs et contre tout. C’est ce qui s’écroule pendant la pièce.
L. L. : Sylvia est remplie de ressentiment parce que Phillip ne l’a pas laissée travailler et parce qu’elle pense qu’elle a gaspillé sa vie. N’est-elle pas aussi coupable puisqu’elle aurait pu s’imposer ?
A. M. : Oui, mais vous savez qu’elle vit dans un certain contexte social, à une certaine époque. En 1938, quand on était marié, on était marié. On ne décidait pas tout à coup qu’on n’était plus marié. De nos jours, la moitié des mariages finissent par un divorce, au moins la moitié, probablement plus. Je ne connais pas les statistiques pour 1938, mais je peux vous assurer que ce n’était pas beaucoup. L’édifice social ne s’était pas encore effondré et désintégré.
L. L. : Etes-vous d’accord que Phillip et Sylvia sont typiques de beaucoup de juifs de l’Allemagne d’avant-guerre, soit parce qu’ils sont passifs, soit parce qu’ils nient leur judaïté ?
A. M. : Ils le sont, mais n’oublions pas qu’il n’y avait pas seulement les juifs qui démentaient ce qui arrivaient. Après tout, M. Chamberlain, Premier ministre en Angleterre, M. Daladier en France ont choisi de prétendre que l’Allemagne nazie était un pays normal et qu’Hitler était un homme d’Etat normal. Les Etats-Unis ont fait de même. Ils savaient parfaitement ce qui arrivait. Ils savaient que tout le mouvement syndical ouvrier avait été définitivement détruit en Allemagne et que beaucoup de chefs syndicalistes étaient en prison, étaient torturés ou étaient déjà dans des camps. Après tout, les camps ont commencé en 1934, mais c’était pour les prisonniers politiques. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire qu’ils ont liquidé une génération d’adversaires politiques : socialistes, communistes, libéraux. Ce n’était pas raciste au début, mais nous avons choisi de l’ignorer. Nous avons choisi de le nier. Ce refus a abouti à la mort de quarante millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale.
L. L. : Sylvia se rend compte que quelque chose de terrible est en train de se passer en Allemagne et elle est profondément bouleversée après avoir vu une photo de vieux juifs forcés de nettoyer le trottoir avec des brosses à dents. Est-ce cela qui lui paralyse les jambes ?
A. M. : Vous savez ces choses-là sont très complexes. Elles sont mystérieuses parce que la majorité des gens ne deviennent pas paralysés bien qu’ils soient tout aussi angoissés qu’elle. Elle se punit parce qu’elle n’ose punir personne d’autre. Il faut une certaine personnalité pour cela. Donc je considère les gens comme des individus. Ce n’est pas un cas médical.
L. L. : Le docteur déclare en parlant de Sylvia : « Je ne sais pas ce que c’est ! J’ai seulement le sentiment qu’elle sait quelque chose… C’est comme si elle est rattachée à quelque… un fil de fer qui fait la moitié du tour du monde, une vérité à laquelle les autres sont aveugles. » Pensez-vous que les gens qui sont psychologiquement fragiles soient plus réceptifs que les gens dits « normaux » ?
A. M. : Oui, parfois. Ils cherchent silencieusement des solutions à leurs souffrances ou leur maladie. Ils perçoivent plus le monde extérieur. Dans sa déclaration, le docteur veut dire que par un moyen mystérieux elle perçoit et ressent quelque part une terreur énorme que tout le monde dément.
L. L. : Pourquoi Broken Glass a eu plusieurs conclusions différentes ?
A. M. : Il y a toujours la même fin en ce qui concerne l’action. J’ai simplement récrit les vingt dernières minutes pour des raisons dramatiques. C’est toutefois substantiellement la même.
L. L. : Y a-t-il des changements dans la production française par rapport à celles de New York et de New Haven ?
A. M. : C’est différent de la production new-yorkaise, mais c’est exactement la même qu’à Londres. C’est la version finale.
L. L. : Quelles sont les différences entre la production new-yorkaise et la production londonienne ?
A. M. : C’est dans les dernières quinze minutes, mais l’action dramatique est exactement la même. A la fin elle se lève…
L. L. : Etes-vous d’accord avec David Richards, un critique du New York Times qui a déclaré à votre sujet en parlant de Broken Glass : « Il a toujours été un Ibsen américain par le choc des événements de jadis sur le présent. C’est de l’ibsénisme pur » ?
A. M. : Je vais vous dire. Comment dirai-je ? C’est de la critique théorique. Il ne voit pas plus loin. Il ne comprend rien d’autre. Si j’invite un sourd à écouter un morceau de musique, tout ce qu’il voie est le chef d’orchestre en train d’agiter les bras et les musiciens qui soufflent dans des instruments, mais il ne peut rien entendre. Ce n’est pas mon problème.
L. L. : A propos des Sorcières de Salem ne va-t-on pas en faire un film ?
A. M. : Oui, le metteur en scène s’appelle Nicolas Hytner. Il a dirigé très récemment La Folie du roi George.
L. L. : A-t-on déjà choisi les acteurs ?
A. M. : Daniel Day Lewis jouera le rôle de John Proctor. On n’a pas encore choisi les autres acteurs.
L. L. : Pourrait-on parler du rôle des femmes dans vos pièces comme par exemple Elizabeth Proctor dans Les Sorcières de Salem, Linda Loman dans La Mort d’un commis voyageur et Sylvia Gelburg dans Broken Glass ?
A. M. : Les hommes ont reçu les rôles principaux, mais je dois dire que les femmes sont comme le moyeu d’une roue dont les hommes occupent la périphérie. A vrai dire, une des meilleures productions que j’ai vue de Tous mes fils, la relation entre un père et ses fils, s’est jouée en Angleterre, il y a huit ou neuf ans. La mère dans cette pièce devint le vrai personnage tragique. Le metteur en scène a compris qu’elle est au cœur de la pièce et qu’elles seule connait la vérité de toute l’histoire depuis le début. Elle est celle dont la douleur est la plus tragique parce qu’elle comprend le plus. Elle connaît toute l’histoire avant qu’elle ne commence. Elle est au cœur de l’action dramatique et à Londres c’est ainsi qu’ils l’ont jouée.
L. L. : Y a-t-il jamais eu un metteur en scène et un acteur tous deux au-dessus du commun dans une de vos pièces ?
A. M. : Voyons, il y en a eu plusieurs. En Angleterre, Laurence Olivier a produit Les Sorcières de Salem. Encore à Londres, il y a quelques années Michael Cambon a interprété Une vue du pont mis en scène par Alan Aykhorns qui est anglais. C’était extraordinaire. Il y a une nouvelle production juste maintenant de cette pièce dont tout la presse fait l’éloge. Je ne l’ai pas encore vue, mais je la verrai dans quelques semaines quand j’irai à Londres. Il y a eu aussi des productions américaines formidables. Toutes les pièces que Kazan a mis en scène. Le metteur en scène italien Visconti a dirigé plusieurs de mes pièces. David Thacker a donné des représentations remarquables de mes pièces à Londres ces dernières années.
L. L. : Est-ce qu’une critique négative soulève des questions dans votre esprit ?
A. M. : Cela ne change rien.
L. L. : Combien jetez-vous de ce que vous écrivez ?
A. M. : Je dirai que sur dix pages, je n’en garde que deux ou trois. Je supprime beaucoup.
L. L. : Pensez-vous qu’il y aura un retour au drame social ?
A. M. : Vous savez le drame social existe beaucoup, sauf qu’on ne l’appelle plus comme cela. Par exemple, il y a beaucoup de pièces au sujet des homosexuels. C’est un drame social. Je ne peux pas vous dire combien il y en a. Certainement ils ont été intégrés dans la société, on ne les voit pas comme des drames sociaux, mais sous bien des rapports ce sont des pièces de propagande. Elles font un commentaire sur la société.
L. L. : Vous considérez-vous comme un innovateur dramatique ?
A. M. : Oui, dans certaines pièces. D’abord une pièce comme La Mort d’un commis voyageur était une innovation, un nouveau style. Chacune de mes pièces reflète le monde dans lequel nous vivons, la mentalité des gens à mesure qu’elle évolue dans le monde. Par exemple Après la chute est d’une forme totalement différente de mes autres pièces. Existe-t-il quelque chose qui ressemble à une innovation de nos jours ? Au théâtre, on a à peu près tout fait, j’imagine sauf de tirer sur quelqu’un à bout portant.
L. L. : Certaines de vos pièces ont eu un accueil entièrement différent à différentes époques comme Les Sorcières de Salem et Après la chute. Comment expliquez-vous ces changements dans la perception du public ?
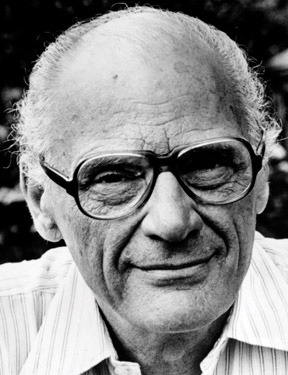
A. M. : Cela dépend beaucoup de la production. Si l’on a un acteur ou un autre, cela fait une grande différence. Le public sait seulement ce que l’acteur lui laisse voir. Les critiques aussi la plupart du temps. Si l’on a un spectacle extraordinaire, cela fait une grande différence dans l’appréciation du public et on ne peut pas toujours le prédire. C’est quelque chose de magique. Il est difficile de savoir à l’avance si un acteur va être assez bon, très bon ou sensationnel. C’est très dur de faire une prédiction. En fait, c’est presque impossible. Donc, cela explique les différences chez les spectateurs. Il y a aussi l’atmosphère de l’époque et son rapport avec le public. Par exemple avec Les Sorcières de Salem, le sénateur Mc Carthy était encore vivant quand la pièce est sortie et les gens étaient très inquiets. Ils avaient peur. Quand ils ont deviné de quoi il s’agissait vraiment dans cette pièce, ils sont devenus très froids et hostiles. Cependant, en même temps, je dois dire que la première production était très formelle. C’était un spectacle pseudo-classique. Le metteur en scène avait décidé que c’était une peinture hollandaise. Moins de dix mois après la fin de la première production, une autre production a pris place avec de jeunes acteurs. A ma connaissance, c’était la première production off-Broadway jouée dans un hôtel, pas même dans un théâtre et c’était un vrai choc. Ces acteurs n’étaient pas vraiment aussi bons que les premiers, mais l’esprit était passionné. Le résultat a été totalement différent. Donc, c’est un peu comme la musique. On peut avoir un chef d’orchestre qui joue un morceau de musique et ce n’est pas intéressant. Un autre chef d’orchestre arrive, joue les mêmes notes et soudain, il y a de la musique, ce n’est plus seulement un ramassis de notes.
L. L. : De toutes vos pièces de théâtre, nouvelles, romans, scénarios, autobiographies, lesquels vous donnent le plus de satisfaction personnelle ?
A. M. : Probablement La Mort d’un commis voyageur, mais peut-être aussi Les Sorcières de Salem et dernièrement Broken Glass.
L. L. : Quelles sont vos plus grandes craintes en 1995 ?
A. M. : Comme je l’ai déjà dit, les problèmes raciaux et économiques aux Etats-Unis me préoccupent beaucoup, mais je suis sûr que ce pays saura trouver une solution. Les Etats-Unis ont la plus vieille forme de gouvernement. La France est passée de la monarchie à cinq républiques. L’Angleterre a toujours eu une monarchie, mais cela a été modifié au cours des siècles. Les Etats-Unis ont toujours la même constitution et cela donne probablement une certaine stabilité au pays.








