Réflexions sur ma question Strauss-Kahn.
Il n’y a que de mauvaises raisons pour faire les choses, ne pas s’étonner si ça tourne mal ensuite. Dans une vie suspendue, j’ai été le biographe virtuel du rédempteur des gauches, et au bout de l’échec, je me suis retrouvé un petit débris de son explosion. Parfois (on y reviendra), quand des imposteurs réputé(e)s écrivent sur Dominique Strauss-Kahn, mon nom apparaît au détour d’une saga honteuse, contes édifiants que le journalisme produit pour faire ronronner les consciences. Un journaliste – moi – y accompagne un monstre de lubricité corruptrice – lui –, se prépare à lui servir la soupe de ses mots avant sa conquête du pouvoir, heureusement évitée. Quand je lis mon nom, parfois, transmuté en pute de plume que des chroniqueurs mélangent aux putes de chair, j’enrage et je m’interroge… C’est donc cela, notre métier, fait d’à-peu-près et d’anecdotes replâtrées, ce métier dont je suis de moins en moins ? C’est donc ainsi, être soudain de l’autre côté du miroir, comparse d’une histoire que d’autres écrivent (et ils l’écrivent si mal) ? Ainsi ronronne le bûcher médiatique, et quand Strauss-Kahn a rissolé, des escarbilles sont venues me brûler, juste un peu, à mon insignifiante mesure. Et en même temps, je n’avais qu’à l’écrire moi-même, cette histoire, puisque j’en fus – mais à peine, au fond, et dans quel brouillard, et qu’en sais-je ? Et puis, écrire sur quoi ? Sur Strauss-Kahn, l’exorcisé de la politique française ? Sur ce qu’il était vraiment, en dépit du reste de lui-même, même si sa vie privée à la bascule était un écho de ses constructions publiques, des équilibres que lui seul pouvait comprendre, ou même pas ? DSK est un mort-vivant de l’opinion, qui fut pourtant l’homme qu’on attendait le plus, et ce ne sont pas seulement ses frasques que l’on a vomies, mais aussi bien l’espoir ou la peur de son arrivée, le fait d’y avoir cru, d’avoir attendu ce truc politique qui n’a jamais existé ; et il fallait tout salir, tout nier, pour en finir avec ça, écraser du talon s’il tente de revivre, et puis enterrer, parce que c’est fini, entendez-vous, bien fini, ça n’a jamais eu lieu… Ou bien écrire sur moi, journaliste en rupture d’évidence et dont l’éclipse fait écho à celle d’un ci-devant grand homme, écrire sur moi, hypnotisé par la déchéance, jusqu’à me demander quel plaisir lui-même a pu y trouver, quel soulagement a été le sien, quand tout a été plié, quand il n’a plus été que l’opprobre, la fin confirmant tout ce qu’on murmurait de lui, et il offrait à ses ennemis ce qu’ils attendaient ? Il a dû être soulagé ; enragé aussi, évidemment, mais soulagé de défaite, au fond. Puis s’en est remis à son fétiche ultime, la raison stratégique : la rationalité qui l’aura sauvé, à chaque fois, quand il s’est agi de réparer ce que la folie ou l’oubli de soi avaient dévasté. Ce qu’il faut faire et refuser méthodiquement, patienter, éteindre les incendies un à un, plaider, payer, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien qu’une odeur de pourriture – elle persistera, mais le danger sera passé. Je ne possède pas la distance de Strauss vis-à-vis de lui-même, cette capacité à objectiver le désastre pour continuer malgré tout. Mais le trou noir des déconstructions m’est familier : la chimie de la perte, ne pas être fiable ou être trop libre, s’autoriser sans limite, faire la faute et insupporter, au détriment de sa survie, jusqu’au châtiment ; mériter l’injustice qui vous saisit, et elle n’en est pas moins tragique et désirable.
Strauss-Kahn et moi ? Ceci est l’histoire d’une folie, ou d’une idiotie, mais ma métaphore. Il faut en sortir, fermer une porte, enfin, et suggérer un livre que je n’ai jamais su finir, mais était-ce seulement ma faute ? Quand Dominique Strauss-Kahn a rencontré Nafissatou Diallo, précipitant sa fin déjà inscrite (l’affaire du Carlton se promenait entre la flicaille et les officines, la femme de chambre de New York n’a été qu’une circonstance de sa catastrophe), j’étais à la tête d’une centaine de feuillets commençant ainsi : « Un jour, forcément, nous le détesterons. » Il y avait des exergues, aussi, une citation de Blum sur les « gérants loyaux du capitalisme », une autre de Deng Xiaoping, tellement connue, sur les chats gris qui attrapent les souris, et une sur Pétain : « Êtes-vous plus français que lui ? » En réalité, Dominique, que j’aimais beaucoup, me faisait penser à plein d’autres choses. C’était un bon bouquin. J’ai relu ces pages quelques fois, triste mais content, quelque part, de n’être pas allé au bout, que l’histoire ait avorté, que la lumière ne m’ait pas à nouveau écorché (la chorégraphie du système, être « le » spécialiste du grand homme, strausskahnologue éminent, prétexte aux paresses des programmateurs télé, et ronronner[trois fois « ronronner » jusque là, en deux pages] de ce statut, y prendre goût, peut-être – j’ai donné, jadis, biographe de Jospin, remâchant les mêmes mots à longueur de plateaux, aimant me répéter moi-même, et puis plus). Ce n’était pas un livre pour briller, ni pour exister, ni pour la carrière, mais pour savoir si j’en étais capable, si je savais encore écrire, après que ma vie ait valdingué, et si je saurais comprendre un peu de mon époque. Nafissatou, pauvre victime ou pauvre salope, et Dominique, magnifique ou méprisable inconscient, m’ont délivré de l’épreuve en torpillant l’histoire. Mon livre s’est arrêté net, jamais repris, infaisable, un futur antérieur jamais accompli, inutile, plus d’objet, puisque Strauss-Kahn ne serait jamais couronné.
Dans ce bouquin, élaboré entre 2009 et 2011, au fur et à mesure de la montée d’un désir nommé Dominique, je tournais autour de Strauss, promis alors au plus beau destin, en traquant toutes les mauvaises raisons qui, additionnées, allaient en faire un Président : lui, ce type en déséquilibre permanent, aux arrangements transitoires, que seuls excitaient le risque et la limite, la combinaison des impossibles, le jeu d’échec et des probabilités et le frisson maîtrisé des parties à l’aveugle – lui, ce métèque polymorphe, heureux dans son siècle, s’en allait prendre un pays corseté de trouille et de racines, mal au monde et perclus de lui-même. Strauss ne ressemblait pas à cette France pénétrée par son déclin et se gargarisant de gestes surannées, qui sautait comme un cabri aux cris de Nation et République en ayant oublié leur sens, qui brimait ses Musulmans en se croyant laïque, qui se coupait du monde, des jeunes, des immigrés, de la vie même, en se prétendant assiégée, qui chérissait ses totems et se détestait elle-même, en fait, d’être inadéquate. Lui gambadait sans honte dans la planète, un des rares à la goûter. La France allait mal et Strauss-Kahn allait bien, et on irait le choisir en dépit de cela, ou pour cela, comme un médiateur envers le vaste monde, un type qui nous protègerait de l’époque puisqu’il ne la refusait pas. Quand nous discutions, Strauss-Kahn élaborait une théorie de notre déclin, décrivait la fin de la domination occidentale, nourrie deux siècles durant de la rente coloniale et de l’égoïsme technologique. Ça le passionnait de vivre ce moment de bascule. La mondialisation était une révolution égalitaire, qui retirait aux pays nantis ce qu’ils avaient cessé de mériter. Il était pour, en progressiste. Il aimait l’Afrique et kiffait la Chine, et si l’Inde nous dépassait, c’était justice, enfin, dans le sens de l’histoire. Patron du FMI, ce métèque avait choisi de jouer avec ces nouveaux venus, mal léchés comme lui, pas nets, pas bordés, mais vivants. Il contemplait aussi le simple pragmatisme yankee, avait pris du plaisir à négocier avec des congressmen pour débloquer un vote pro-FMI… Seule l’Europe l’exaspérait d’être indigne d’elle-même, de ne plus peser, de tricher avec ses règles, d’avoir laissé dériver la Grèce avant de l’étouffer ; l’Europe et la France, à la société comprimée et aux universités vermoulues, qui se laissait aller, victime du monde au lieu d’en être. Étouffant dans l’Hexagone, je communiais et me délectais de son paradoxe. Car s’il était pour les autres, il était français pourtant, à nous promis, français mondialisé mais issu de vieilles générations judéo-gauloises, franc-maçonnes et SFIO, une histoire bleu-blanc-rouge en somme, et le champion de ce peuple-là, le nôtre, le sien, auquel il avait pourtant cessé de ressembler. « Et comment fais-tu pour devenir le président des nantis en déclin et leur expliquer que leur déclin est juste, alors qu’ils en souffrent ? » C’était mon objection et son équation, qu’il résoudrait, ou pas. C’était le paradoxe qui l’attirait – il transmutait cela en colère, contre Sarkozy ou l’Eurogroupe. Il serait le passeur ou l’accoucheur d’autre chose, le réparateur, l’homme des chances d’une France dans le monde tel qu’il était… Il inventerait. Sa spécialité était là : les inventions, les équations de langage qui font avancer, la conviction emphatique, la capacité à dire aux autres ce qui les ferait évoluer.
C’en était presque gênant, cette intelligence se grimant de modestie, manipulatrice en affectant de rester à sa place, ce talent à faire comprendre, faire accroître, occuper par le raisonnement et l’argument le cerveau des autres… Il avait excellé avec Jospin, socialo traditionnel devenu modernisateur et privatisateur au nom de l’impératif industriel ; il avait su captiver la vieille machine du FMI et installer ce fonds dévalué au cœur de la crise mondiale. Saurait-il faire avec les Français, leur parler à l’oreille ou bien les emmener ? Strauss-Kahn était moins l’homme des solutions techniques – il en avait, des œufs de Colomb qu’il écrasait soudain sur les problèmes – qu’un alchimiste de la raison. Il n’avait jamais été chef, en somme, mais le premier des conseillers, le plus important des non-décideurs – jusque dans le cénacle des fragiles maîtres du monde… Là, c’était autre chose qui se profilait. Je le voyais préparer la suite, encore au FMI, à travers ce qu’il me racontait. Quand il parlait, le possible président français le disputait au patron du FMI. Lors de notre dernière rencontre, quelques jours avant le Sofitel (à Paris, chez son ami Dan Franck, qui lui prêtait une pièce pour ses rendez-vous), il m’avait raconté son dialogue avec les Allemands, un mea culpa politique servi tout chaud aux chrétiens-démocrates de Frau Merkel, sur un vieux débat qu’il avait mené, quatorze ans plus tôt. « C’est vous qui aviez raison en 1997, lors du traité d’Amsterdam, leur avait dit Strauss ; il fallait imposer des règles financières, un cadre contraignant qui forcerait à construire. Cela nous aurait amenés au gouvernement économique ; nous ne l’avons pas compris. » C’était tellement mignon, cette scène, DSK l’infaillible jouant la contrition : évidemment, Amsterdam n’était pas l’objet. Strauss du FMI commençait à amadouer l’Allemagne pour les débats que Strauss de l’Élysée devrait mener ensuite : être le meilleur ami de ton partenaire, pour l’amener à toi… Évidemment, il était candidat, même plus candidat, président déjà, pré-agissant comme tel, présomptueux ou logique. L’avait-il toujours été ? En 2009, on discutait de la théorie de la décision, et comment les choix se forment avant d’être actés, et comment la raison, au fond, vient justifier ce que l’instinct a voulu. D’instinct, il y était. D’un autre instinct, il se ruinerait.
J’y croyais, à cet habile ? J’avais envie. Pas comme les autres, sans doute, mais plus encore. Les sondages racontaient une histoire de sondages et de compétence, d’autorité, de sauveur, et des strauss-kahniens inventaient Dominique en Bonaparte… Je pensais exactement le contraire. C’était la subtilité qui m’attirait, et le paradoxe de la situation ; ce type tout de négociation et de compromis n’avait pas le profil du père de la Nation, marchant sur l’Élysée devant le peuple en liesse. Il était inadapté à ce qui se profilait et pourtant indispensable, à mes yeux, par son incongruité même. Le mondialisé chez les Gaulois. Le métèque chez les terroirs. Le jouisseur chez les déprimés. L’économiste chez les incantatoires. L’universitaire chez les proclamants… C’était baroque et ça m’allait. D’instinct – et de lassitude envers les invariants d’une comédie politique qui m’écœurait, pour l’avoir trop entendue, ces histoires de présidents à la terre au soulier et pourvus en racines, la Corrèze (la Saintonge, le Cantal, qu’importe) en viatique et toujours préférée au Zambèze (à la mondialisation, aux banlieues, à la jeunesse)… Et cela aussi : l’irréalité du strauss-kahnisme faisait écho à l’irréalité qui m’envahissait alors, au plus profond de mon existence. Il fallait que rien ne soit d’équerre pour que je puisse adhérer – et ce qui m’intéressait, vivant cette ascension, c’était d’expliquer pourquoi c’était son impossibilité qui la rendait souhaitable. C’étaient les défauts de Strauss qui en faisaient le prix, qui lui donnaient une chance, infime, certes, de déranger ce pays. L’unanimité m’indifférait, le panurgisme des déjà ralliés (au Nouvel Obs, ma vieille famille, où Strauss l’argenté avait tant fait tordre le nez, on se grimait strauss-kahnien, quatre ans après avoir été ségoléniste, comme on serait ensuite hollandais) me faisait marrer. Rien ne tenait, mais c’était riche.
J’allais raconter ce DSK en conflit d’intérêts incarné, à la fois bardé de technostructure et barbotant sans frémir entre plaisirs et jouissances, et pourtant travaillant, guincheur chez un oligarque ukrainien, commensal du business et captivé par les flibustiers… Il aimait, en Afrique du Sud, un ancien syndicaliste révolutionnaire du temps de l’apartheid, Cyril Ramaphosa, devenu un des tycoons noirs de l’économie post « black empowerment » ; il s’abritait, en France, derrière le désormais fameux Ramzi Khiroun, petit gars de Sarcelles devenu l’ombre et le bouclier d’Arnaud Lagardère, et le glaive de Strauss – haï par les bourgeois apeurés, drôle et détestable à la fois, méchant et naïf à sa manière, un communicant en Porsche Carrera. Et en même temps, avec (malgré, en dépit de) Khiroun, la fine fleur de ceux qui espéraient changer le monde dans la simple raison, la quintessence sociale-démocrate des serviteurs de ce vieil État attendait DSK. Rien n’était anodin dans les grands écarts de Dominique, qui captivait l’aristocratie social-libérale comme les demi-sels d’un monde à croquer, aimant tout et toujours accroché au BlackBerry, opérateur de crises depuis sa terrasse marrakchie et perdant sa santé dans d’incessants déplacements, et heureux comme jamais au contact d’économistes fondus comme ceux du Fonds, rédigeant à leur seule intention des notes remplies d’équations incompréhensibles au commun des mortels… Mais lui avait besoin de cet hermétisme d’économiste, qui lui chantait comme d’autres aiment les maths ou la poésie du Parnasse, sa jeunesse.
Les putes, je n’en savais rien. M’en serais-je foutu ? En aurais-je ri ? Ou pas ? Je ne sais pas quoi faire de ces partouzes. Mais tout ceci ça cadre, rétrospectivement, non pas avec la dépravation, mais avec les tourments ou les déphasages de l’homme. Strauss vivait et incarnait des incompatibles. Il vivait des contraires avec la même sincérité. Sans doute le déséquilibre était-il la condition de sa vie (et en même temps, une gestion quasi-rigoureuse, compartimentée, scientifique, presque, de ses contradictions, séparant le temps de l’oubli vertigineux et vain de celui de la vie et du travail, mais rien ne tient éternellement)… Enfin. L’aventure de Strauss était plus que politique : elle était drôle, improbable, angoissante d’être sur un fil. Dans le livre, je racontais et je croisais les doigts, et je pressentais le pire à venir, sans l’identifier. Je pensais que cela tournerait mal, que le risque était là, l’équation intenable, que même le plus grand manipulateur ne réussirait pas l’impossible : réconcilier la France avec son temps, guérir les haines, faire accepter la fin du monde connu. C’était impossible… J’avais avec Strauss-Kahn un rapport étrange, fait d’adhésion flattée, son intelligence honorant la mienne, de refus indignés, d’affection en demande et d’inquiétudes presque familiales. Je pigeais. Quelque part, le Juif en moi devinait la catastrophe, c’est dans nos gènes paraît-il, et c’était en Juif, pour ce Juif, cet étranger, que j’imaginais la chute, c’était en Juif que je voulais raconter. Quelques phrases d’un livre mort-né ?
« Il est juif. Aussi. Pas seulement. Métèque, oriental, levantin d’apparence, surtout depuis qu’il grossit et que l’âge le saisit, quand il libère sa barbe grise, les jours de repos à Marrakech, l’air d’un sage marocain, un prince repus du Maghreb, ce qu’il est aussi, doux et malin, ou rusé, inquiétant s’il vire à la cruauté, mais il s’en défend, débonnaire, l’œil pétillant de malice à la coriandre. Sinon, en représentation, rasé, sanglé dans le costume bleu nuit, il laisse l’Occident le reprendre, mais typé quand même. Il ressemble alors à un tycoon de Goldman Sachs, un banquier ou un avocat d’affaires, ce qu’il aurait pu être. Mais un tycoon tel que l’aurait vu Capra, ou Hollywood en général, au temps glorieux : le moneymaker d’avant les traders au ventre plat, un archétype presque suranné. Rond et puissant, vif et enrobé. Il pourrait être aussi un de ces magnats du cinéma, fraîchement débarqués du vieux pays, les gutturales yiddish imprégnant leur anglais, mais qui racontaient l’Amérique aux Américains. De la houstpa, le culot ethnique et une dureté de survivant, et le charme âpre du winner… Ou alors, un congressman démocrate qui n’aurait pas peur de la corporate industry ? Juif, bien sûr, le moneymaker. Juif, le congressman. Pas seulement une affaire de look, d’atmosphère, de traits à la fois coupants et enrobés… Juif, jusqu’au tréfonds de qu’il est ou inspire, plus juif qu’aucun homme politique avant lui, dans ce pays, et ce n’est pas une affaire de pratique religieuse. Tout ce que ce mot peut symboliser se retrouve en Strauss-Kahn. Ce goût de la vie, cette absence de remords tant on sait qu’elle est brève et que nous ne sommes que parenthèse. Cette douleur sourde que l’on combat dans des boulimies. Cette adaptation au moment, parce qu’on n’a pas le choix. Ces virtualités de destin, et on est français, sans doute, mais il aurait suffit d’un bateau, d’un passeport, pour que l’on soit autre, et ç’aurait été aussi simple. Ce goût du concept, du raisonnement, poussé jusqu’aux conséquences ultimes, mais en lien avec le réel ; le Talmud, qu’il n’a pas étudié, débat à l’infini mais jamais du sexe et des anges, et jamais en vain. Ceci et les clichés du genre. On les devine. Israël, évidemment, le sionisme, ce mouvement de libération devenu une injure ; et sa femme, évidemment, comme preuve de sa double allégeance : Anne Sinclair, ‘sioniste acharnée’, siffla un jour de 2003 un commentateur des gauches dans une feuille réputée progressiste(1). De chez nous, vraiment ? Le diable est juif, argenté et sexué. Dans ce qu’on vomissait sur Léon Blum, jadis, il y avait la vaisselle d’or mais aussi le trousseur de jouvencelles, qui suggérait les ébats pré-conjugaux pour les demoiselles, au nom de l’égalité des sexes : ‘Elles reviendront de chez leur amant avec autant de naturel qu’elles reviennent à présent du cours ou de prendre le thé chez une amie’, dans un livre scandaleux à l’époque, une banalité apparente aujourd’hui, mais qu’on pourrait relire avec avantage chez les machos des cités ou bien d’ailleurs, intitulé Du Mariage. Ainsi Dominique occupe-t-il désormais les rumeurs.
C’est indolore pour l’instant… maintenant. Mais ça flotte. Des nuages noirs se rassemblent pour un autre jour. Un autre moment. Quand le moment sera opportun. Quand la désaffection populaire donnera sens et fera le lien entre toutes les faiblesses d’un homme et ce que l’envie inspire, ou la vilenie. L’argent, le bonheur. Nous connaît-il enfin ? Et il tutoie les lignes, et n’a jamais renoncé à un risque. Il les cherche même, infichu de s’en empêcher. Et il incarne à sa façon le conflit d’intérêts. Et ses légèretés dans les détails ont ressemblé à de l’autodestruction. Et quand il lui arrive quelque chose, il l’a cherché. Et il lui arrive toujours quelque chose. »
Pas mal, franchement, écrit avant ? C’est donc arrivé, quelque chose, mais pas comme on croyait. Jamais comme on croit. Le 14 mai 2011, j’étais en Bretagne chez ma compagne ; c’était la Saint-Yves et à Tréguier, on promenait la dépouille du saint-patron des avocats. Le père de Nolwenn défilait en robe noire autour de la cathédrale et en apparence, ici, la France ne changeait pas (dans la réalité, cet avocat, conseil de quelques grands de ce monde, était parfaitement up to date avec le droit mondialisé, mais les racines vous tiennent, ici), et on était si loin de Strauss-Kahn et de sa planète, physiquement loin, de manière palpable. Ici, pourtant, dans cette Bretagne rose, les gens auraient voté pour lui, et avec enthousiasme peut-être, au nom d’un paisible rocardisme. C’était fini. L’affaire avait éclaté et mon livre n’existait plus, c’était une évidence. Je me foutais bien des détails, ne l’imaginais pas violeur, n’imaginais pas Nafissatou Diallo, n’imaginais rien si ce n’était le chaos et l’absurde. Je ressentais physiquement la destruction de cet homme, et la mienne en écho, que je croyais conjurée, qui revenait soudain. Donc il n’y aurait pas de livre, et tout recommençait, tout ce que j’avais entrepris pour m’illusionner de vie s’effondrait. Il n’y paraissait rien, sans doute, et sur des plateaux télé, à la radio, je commentais avec la sobriété des sociaux-démocrates de verbe le feuilleton de Washington, avec une distance forcée, forgée de toute ma survie, pour ne pas m’effondrer, tant c’était autre chose qui se jouait.
Dominique Strauss-Kahn m’est devenu un livre au plus noir de ma vie. À l’automne 2009, je suis contacté par les équipes de DSK, qui me proposent ce que je leur ai proposé deux ans plus tôt, aux temps heureux de l’insouciance, quand l’homme est parti pour Washington : en 2007, plein de sève et de projets, ambitieux et joueur, je rêvais d’être, pour Strauss, ce que Guy Claisse fut pour Mitterrand, jadis – le journaliste qui écrira le livre qui donnera la vérité au sacre, celui qui dialoguera avec le prédestiné. C’était de l’orgueil, le sentiment que je comprendrais ce type, et l’envie de mettre au clair ce que je ressentais sur la gauche, aussi. En 2001, j’avais – deux ans de travail – publié une biographie de Jospin, parangon de social-démocrate tenaillé par son surmoi trotskiste. En 2007, j’avais – cinq jours de boulot – pondu un pamphlet anti-Ségolène, un livre d’entretien avec Éric Besson, traître officiel aux bons sentiments, tant le ségolénisme me semblait une régression. En 2008, j’irais tâtonner une gauche de son temps avec Manuel Valls. Avec Strauss-Kahn, je cherchais une justesse ; accoucher une adhésion. Strauss avait répondu « pourquoi pas », et puis rien, trop tôt, pas le temps, pas l’objet ; on y revenait donc, deux ans après, mais tout avait changé. Telle que formulée, la proposition était moins grandiose. Dans les mots des strauss-kahniens, en décembre 2009, il s’agissait de trousser une biographie, bien écrite, bien enlevée, sur le mode honnête et positif, qui cadrerait le héros avant que les médisants ne s’emparent de lui ; on m’ouvrirait portes et fenêtres, bien sûr, j’aurais les sources, je serais libre, mais on déminerait, et on ferait ça vite, pour griller les hostiles avant qu’ils ne dégainent leurs follicules pleins de boue, de fric, de sperme et de calomnies. En gros. C’était alléchant, intelligent et idiot à la fois. Quand je lirais, plus tard, dans des ouvrages de crétins pompeux, des descriptions de la machine de com strauss-kahnienne, cette organisation réputée cynique et implacable, je penserais au mort-vivant que j’étais quand ceux de DSK m’ont ouvert la porte, me demandant quelque chose d’injouable et d’inutile à la fois (et ils le savaient, qu’une bio de protection n’existe pas, et qu’un livre, une fois lancé, a sa vie propre), que je ne leur fournirais jamais à la lettre (et s’en doutaient-ils, au fond ?). En temps normal, aurais-je passé mon tour, tant l’exercice était étrange ? Ceux qu’on appelle les strauss-kahniens étaient pour certains des amis, des intimes, et depuis mes vingt ans ; Olivier Nora, patron de Grasset, ma maison d’édition, était un ami d’Anne Sinclair et Dominique, témoin du fameux repas marrakchi où Martine Aubry et DSK avaient scellé un « pacte » tant fantasmé, ces années-là… Nous nous aimions tous et l’amitié ne fait pas de bonne littérature ni d’excellent journalisme ; mais justement parce que c’était compliqué, injouable, absurde, risqué, justement parce que je serais en équilibre, au risque de tout perdre, entre l’honnêteté et trop d’amitiés, il fallait le faire. Rien n’était normal dans ma vie et il fallait une impossibilité de plus pour que je m’y retrouve. Il fallait les précipices pour que je cesse de hurler.
Valérie venait de mourir. Nous n’avions rien vu venir. J’étais juste avant un homme marié, usufruitier bouffi et sincère à la fois d’une puissance éphémère, éditorialiste à Europe 1 et rédacteur en chef au Journal du dimanche, en réalité inconsolable d’avoir quitté Le nouvel Observateur, cocon des gauches et ma famille, pour des raisons qui m’échappaient chaque jour un peu plus (la complaisance du soutien à Ségolène Royal, l’inféodation aux médiocrités du parti socialiste) comparées à ce que j’avais perdu : une chaleur intellectuelle, la belle langue et les bons sentiments, l’illusion pas totalement factice d’une communauté de pensée. J’étais un homme marié stressé impatient, engagé à la ville dans les guerres idiotes que nous nous inventons, dans des vies semi-publiques, pénétré des autres et du rôle que je jouais dans leur comédie. J’étais marié, nous avions deux enfants. Le 24 juillet 2009, je deviens seul, et d’un coup mesure l’immense idiotie de mon existence, le temps égaré à mille riens et un million d’apparences, à m’occuper d’inconnus et d’indifférents en ayant posé les miens de côté (ma vie était acquise, pourquoi en prendre soin ?), et c’est trop tard. Elle est morte et je ne suis plus. Je me fous de tout – de tout sauf de mes gosses, des milliards de secondes que Valérie emporte avec elle et que je sens filer comme du sable dans ma mémoire, qui ne reviendront plus, qui se solidifient en pâlissant… Ma vie m’a enseveli sous des miettes précieuses. Je les remue, je les contemple, je les entasse, hébété. Il faudra du temps pour que les colères me reviennent, colères publiques s’entend, pour d’autres objets que ma souffrance ; il faudra de longs mois pour que je reprenne mon métier au sérieux (que je cesse de le haïr – et je ne suis pas sûr d’en être sorti) et que j’écrive des mots glacés de réprobation. Ce sera le sarkozysme, dans sa mue ultime et imbécile (sordide, indigne), dans les débats identitaires et le discours de Grenoble, l’exposition des Roms en menace publique, le sale chemin de Monsieur Buisson, qui me réveillera, vaguement, mais suffisamment pour que je prenne le verbe au sérieux, et je le fais alors pour moi, pour entendre le son de mon écriture, sans grand souci de ceux qui liront. J’écris sans précaution, et peu me chaut si je vais le payer… Je suis mort, donc, puis indifférent, glacé, un zombie – est-ce que cela se voit ? Je vais pourtant balbutier des bribes de vie, qui vont se solidifier, une espèce de tablier au-dessus du gouffre, devenir un marrane de l’existence et puis y croire, et rencontrer Nolwenn et vivre et avoir un enfant. Mais l’aventure Strauss, aujourd’hui, à peine achevée, me semble terriblement lointaine, tellement liée aux moments de coton que je traversais.
Dans les premiers temps de la douleur, parmi les débris auxquels je m’accrochais, il y avait le souvenir, frais et déjà sépia, d’une soirée aux Buttes-Chaumont où Valérie (passionnée de politique, certainement plus que moi, plus profondément, plus concrètement) était contente, radieuse et apaisée : les 60 ans de Strauss, où nous étions invités, tels des cousins d’une famille en attente ; d’autres journalistes étaient là, Bourdin, la star des matinales de RMC, Jean-François Kahn, je pense, et des amis, curieux, ambitieux, élus, compagnons de longue date ou ralliés en attente, pour voir l’homme qu’on désirait déjà, et Strauss avait joué comme un chat avec des mots suspendus devant cette petite France offerte (je me souviens de la crispation de Manuel Valls, notre ami, avec qui Valérie travaillait alors, qui voulait lancer son propre destin et qui ne goûtait pas la cour unanime du messie enjoué). Nous étions juste là, amusés d’y être, bien, parce qu’il faisait bon, doux, que tout avait l’air simple ; nous avions marché dans les Buttes-Chaumont, on avait (vies de dingue) peu de répit cette année-là et nous prenions ce qui venait. Qu’importe, ou pas. Au bout du bout, c’est la rémanence de cette soirée qui m’a amené à prendre ce livre, l’écho d’un moment de rémission avant notre catastrophe, l’idée – pas l’idée, l’intuition presque religieuse que le répit pouvait être prolongé, en étant dans cette aventure.
En cette fin 2009, tout est cotonneux autour de moi, ou coupant, au contraire. Les hostilités me transforment en brute mais les gentillesses me désarment, je me loverais dans tous les bras qui se tendent, j’embrasserais quiconque me veut du bien. Donc Strauss. Au même moment, je commence un livre d’entretiens avec Patrick Bruel, parce qu’il est gentil et qu’il vient me chercher dans ma solitude pantelante. Au même moment toujours, après avoir joué avec l’idée, je renonce à un livre avec Carla Bruni (qui est gentille aussi et que j’aime bien, avec qui l’on peut rire), parce que dans un avion, Sarkozy m’en a parlé directement, et je ne veux être qu’à moi et aux miens, et ce story-telling là me semble lointain, étranger…
Rien n’est logique, sauf l’instinct. Et la fuite. Car à peine ai-je accepté d’être ce biographe invité, je ne sais plus quoi en faire : seul le « oui » m’importait, pour protéger ma parenthèse, mais l’exercice en lui-même cesse de m’intéresser. Je ne veux pas écrire une vie édifiante mais être avec ces gens, commencer avec Strauss une conversation, et je ne vois pas pourquoi il faudrait la finir. Je veux être un ami et que l’on se dise tout, et vais passer deux ans à souffrir ma vie et à picorer la sienne, me cherchant autant que je le cherche, connaissant des moments rares, défiant le principe talmudique de shatnez qui interdit (savez-vous ?) qu’on mélange le lin et la laine, et un contrat d’édition avec sa psychanalyse. Parfois, comme un fantôme souriant, je suis la caravane du strauss-kahnisme, me retrouvant en Afrique du Sud dans une équipée du FMI, avec une équipe de Canal + qui trousse le film autorisé du futur candidat, une consœur de France 24 qui va narrer son aventure du FMI, d’autres suiveux, regardant curieusement un pré-chef d’État discourant au tiers-monde et tapant le ballon avec des petits noirs de Soweto. Ce sont des voyages imposés, comme des visites guidées, on trouve qu’il serait bien que je voie cela… Je regarde le planétaire Strauss en distanciation brechtienne et j’hésite devant les cadeaux au duty-free de Jo’burg, mais dans l’avion, on discute quand même. Je vais à Washington, je lui parle ; je vais en Pologne, on se rate, je dois rentrer en France pour récupérer mes enfants dans une fête familiale. À un moment, les strauss-kahniens comprendront que le biographe n’en est pas un, et offriront du temps et un cahier-photos à Michel Taubmann, qui deviendra griot officiel et tiendra jusqu’au bout son rôle d’écrivain-groupie…
Cela m’arrange, en fait, tant que les rencontres se poursuivent. Se dessine, petit à petit, ce que je veux faire : non pas une biographie, mais un essai à propos de cet homme, un livre sur une histoire mal racontée, pleine de faux-semblants et donc de promesses. Je jette des mots, je réclame des rendez-vous, ils sont rares, je les bousille parfois, tant je suis ailleurs, étrange, étranger. Je sens autour de moi un malaise, une gêne et de la gentillesse pourtant, inquiète. Je provoque cela, involontairement, recevant un jour un appel de Carla Bruni quand je suis avec la sœur de Dominique (« Comment allez-vous, Claude ? Et les enfants ? »), et puis un autre (« Claude, voulez-vous venir dîner à l’Élysée ? ») un soir où je dîne avec son jeune oncle. Je me sens comme un fantôme chez les importants, me demande pourquoi l’on m’appelle encore et quel esprit malin joue avec moi. Pour enquêter, je fais réagir, et je perçois chez ses proches l’inquiétude qu’inspire Dominique, ce précieux acrobate. Souvent, les conversations viennent sur son inconduite, et je ne sais pas quoi faire de ça. Mais j’inquiète, puisque j’entends. On a dit à Anne Sinclair que j’étais sarkozyste, et elle m’adjure de ne pas répéter à l’Élysée ce que je vois d’eux (c’est dans un hall d’aéroport, et Strauss se marre, moins persuadé que son épouse des dangers de la contiguïté).
En réalité, je ne suis rien, un rescapé, un bon à prendre, un dilettante, un plus sérieux, un luftmensch – mais finalement, la vie reprend de la consistance, le coton se fait pâteux, palpable, dur enfin ; cela revient. Je n’ai plus envie de bâiller quand on me parle. J’ai perdu du temps. Je le rattrape. Je mens à mon éditeur, on fait tous ça. En fait, j’ai compris ce que je dois faire et je veux que ce livre sorte le plus tard possible, aussi près possible de la présidentielle, pour que le désir politique nourrisse le désir de comprendre. Strauss-Kahn a été bonhomme – on se voit encore, une heure grappillée par-ci par-là, quand il passe par Paris. J’ai commencé à écrire. J’ai compris la tristesse de l’homme, une noirceur qu’il habille d’optimisme forcé ; « ou ça va, ou ça va » est son fétiche verbal ; Dominique passe sa vie à échapper aux douleurs et aux fatalités, qui rôdent pourtant ; il court pour ne pas être son père, Gilbert – bel homme, cultivé, progressiste et aventurier, frappé en pleine force par une faillite qui le rendra dépressif jusqu’au bout de son âge… Je découvrirai ensuite, quand tout sera accompli, à quel point Dominique aura reproduit le destin de Gilbert : réussir et puis tout perdre aux yeux du monde, sans rémission possible, et devenir le fardeau des siens… Je tâtonne et m’intéresse, enfin, et le livre se fait thérapie, et nous parlons politique, et socialisme, et qu’en reste-t-il ?
À notre dernière rencontre, en avril 2011, juste avant qu’il ne s’oublie définitivement, je comprends que ses constructions sont éphémères, elles ont la virtuosité des œuvres en mouvement : il ne faut pas les figer. Nous parlons de ses accomplissements de ministre, quand il bricolait le meccano de l’industrie, et je lui demande des comptes : « Si tu es le grand artisan de la privatisation de France Télécom, tu es politiquement responsable des souffrances sociales qui ont suivi – des suicides aussi ? » Dominique grogne, il n’a plus été au pouvoir depuis onze ans, et lui aux affaires, France Télécom aurait été gérée autrement, et… Il ne sera plus jamais au pouvoir, de toute façon. On doit se revoir avant l’été pour parler de l’Europe, je nourris mon bouquin, je tiens quelque chose, et puis Nafissatou Diallo entre dans sa chambre.
La suite est connue, et tout ce qu’on en a dit, si mal, copieusement pourtant. Diallo et ses mensonges, le Carlton et son ridicule, un livre et des articles infâmes, le délitement de tout ça et l’arrangement financier pour fermer la porte. J’ai à peine revu Dominique Strauss-Kahn depuis ; nous n’étions pas des amis et je n’étais pas devenu son biographe, juste un type peut-être malin et certainement blessé qui s’est intéressé à lui, aussi près que possible. Je n’ai que des hypothèses sur ce qui travaillait le grand homme, grand malade, grand inconscient. La culpabilité du survivant, peut-être ? Pour avoir survécu au tremblement de terre d’Agadir et aux souffrances de son père, Dominique devait se punir ? Ou s’aimait-il si peu qu’il mettait en danger tout ce qui le nourrissait – Anne et les siens – en l’exposant au sordide de ses autres vies ? Ou était-ce juste incontrôlable, la logique d’un homme qui prétendait tout être et tout désirer à la fois, qui pensait pouvoir toujours tout concilier, tout protéger, et s’en sortir au charme, à la fulgurance ou à la bonne étoile ? Tant de souffrance et de pulsion de mort, ou juste de l’arrogance enfantine ? Ce n’est plus mon sujet. Je sais au moins pourquoi je faisais ce livre et comment je ne pouvais plus le finir, et ce que j’y ai perdu.
En février 2012, dans un article du Monde chuchoté en vice, plein de sources anonymes et d’indignations complaisantes (il s’agissait donc de Dominique et de ses prostituées), on trouvait ce paragraphe. « À l’été 2010, le communicant HYPERLINK « http://www.lemonde.fr/sujet/3584/ramzi-khiroun.html » Ramzi Khiroun est venu passer plusieurs jours à Washington en compagnie du journaliste Claude Askolovitch, qui prépare, dit-il alors à ceux qui le rencontrent, le futur livre de campagne du candidat. » En lisant ces lignes, j’ai senti le poids du déshonneur à jamais collé à cette histoire, et à quel point la réalité n’aurait plus d’importance. La presse n’écrivait plus sur Strauss, elle épurait, expurgeait, exorcisait, comme dans les orgies honteuses des libérations. L’anormalité de Dominique était conjurée et la France vomissait l’ancien possible. J’étais – un peu proche – un peu tondu… Pour mémoire, quand même, l’article affabulait. À l’été 2010, j’étais en vacances, avec mes enfants en Normandie, puis avec Nolwenn en Suède et au Danemark. Je n’ai vu Strauss que deux heures à la fin juillet, dans le lobby d’un hôtel parisien, place des Vosges. Nous avons parlé candidature et primaires, si je me souviens bien… Quant à Ramzi Khiroun, compagnon attentif après mon veuvage, il était devenu en un an un étranger, hostile et méprisant, tant mes inadéquations le gênaient dans sa situation chez Lagardère, et nous avons cessé de nous parler, justement, cet été-là. Et je n’étais jamais allé à Washington avec lui depuis l’élection de Strauss au FMI. Mais qu’importe. Flottait l’odeur de mon compagnonnage avec une aventure honteuse, je n’en serai pas lavé aisément…
Ce qui est dommage, c’est que le réel est toujours plus riche et plus triste que les contes journalistiques. Si l’autrice de l’article avait travaillé, en supposant que ma vie ait le moindre intérêt, voilà ce qu’elle aurait pu écrire : « En février 2010, Claude Askolovitch emmène à New York puis à Washington son fils Théo, alors âgé de 14 ans. À Washington, il doit voir Dominique Strauss-Kahn et amorcer des entretiens. Il pense, peut-être à tort, que son fils sera distrait de son malheur en approchant son travail. Quand son père et Strauss discutent, l’adolescent fait les boutiques de Georgetown, le quartier huppé de la capitale américaine, en compagnie d’Anne Hommel, communicante de DSK, également en vacances aux États-Unis. Le journaliste et son fils dîneront chez les Strauss, puis iront bruncher avec eux (en compagnie du frère de Strauss-Kahn, de son épouse, d’Anne Hommel et de son compagnon) dans un hôtel décoré de guitares électriques, le jour de leur départ. Quatorze mois plus tard, quand Dominique Strauss-Kahn, accusé de viol par Nafissatou Diallo, sera exhibé à la télévision menottes aux poignets devant les caméras, le fils de Claude Askolovitch tremblera en voyant la mort au fond des yeux de cet homme joyeux qui lui avait appris à boire le whisky cul sec, ce qui n’était pas de son âge. »
C’était un temps où je mélangeais beaucoup, et ce que j’aurais fini par en écrire n’avait rien à voir avec ces douces confusions. Quand la mort est apparue dans les yeux de Strauss-Kahn, j’ai pensé à lui et à tout autre chose, et comme il était inimaginable d’en écrire la moindre ligne, j’ai renoncé à croire qu’un autre pouvait me sauver ; j’ai entrepris de vivre, sans aller chercher je ne sais quel sursis. Je sais que la paix est longue à venir ; et même quand on paye, ça ne garantit que les apparences, mais c’est déjà ça. Tout le monde va mieux aujourd’hui, Dominique aussi, semble-t-il, ou pas.
(1) Bernard Langlois, dans Politis.
Le livre inachevé
par Claude Askolovitch
2 mai 2014
Réflexions sur ma question Strauss-Kahn. Un texte paru dans le numéro 51 de La Règle du jeu.




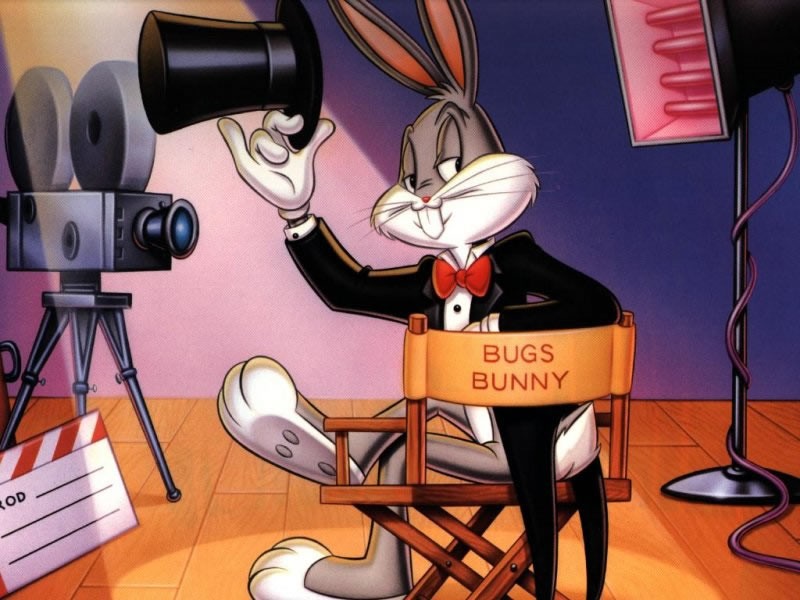




Strauss-kahn a été totalement surfait par les journalistes généralistes comme Mr askolovitch ………….Dans le monde de la finance, DSK a toujours été considéré comme une « bulle » et comme toutes les bulles (boursouflé de son égo qui plus est) il a éclaté en plein vol ( enfin juste avant de monter dans l’avion) …….Il faut aussi redire que DSK n’a jamais rien apporté à la science-économique sur le plan de la recherche (son travail universitaire est quasi-inéxistant et sans la moindre valeur-ajoutée académique) ……Il n’y a que des groupies peu cultivées à la matière économique qui peuvent lui trouver quelques qualités intellectuelles particulières , ou des journalistes chargés par EURO-RSCG de promouvoir son image dans l’espoir d’en détacher quelques dividendes de carrière !
Monsieur,
vous avez écrit un très bel article ,une sorte de portrait croisé mélancolique entre vous et DSK. On peut s’interroger sur ce recul devant le pouvoir . Cela dit ,je ne crois pas que DSK aurait été élu. DSK est peut être un économiste solide ( mais il faudrait distinguer la rhétorique néo keynésienne et la solidité de l’analyse ) mais DSK n’est pas Clinton ( » It’ s economy , stupid »). Dans un pays héritier de Louis XIV , du jacobinisme ,de Napoléon ,puis de l’ Etat social post 1945, les enjeux juridiques et sociaux sont majeurs , et DSK ne les aurait pas affrontés. De surcroît , serait il intervenu au Mali , en Centrafrique ? pas sûr. Comme vous le dites ,il étai très bien en numéro 2 ,cadré par un Jospin au fort Surmoi. mais seul , en roue libre ?On a vu ce que cela a donné à New-york …. De toute façon ,la Droite ne lui aurait pas fait de cadeau et il aurait sans doute été battu.
Très beau texte qui aide à mieux comprendre cet homme, texte dans lequel transparaît la grande sensibilité de son auteur. Merci pour ce texte qui m aide à aller au delà des critiques nauséabondes qui lui ont été adressées, sans cependant le disculper. A divulguer très largement dans une presse plus populaire.
Article passionnant. Qui traite cette affaire avec la dignité qui a fait défaut au reste de la presse.
Ben moi je dis qu’un patron du FMI, le fonds monétaire international, quoi, c’est-àdire le truc de la finance, du flouze, du pèze, la calculette internationale qui est là pour précisément savoir la valeur des choses, des états et des produits, de l’énergie et de la sueur des hommes, le cours de la banane et celui du risque nucléaire, si un tel homme, dis-je, censé connaître au centime près la balance monétaire de la Mongolie intérieure, est incapable de discerner un service sexuel payant d’une séance de libertinage choisie (*), ben c’est bien fait ce qui lui arrive sur le coin de la tronche. Parce que, quand même, qui se fout de la gueule de qui ?
* : ligne de défense de DSK dans l’affaire du Carlton. ben voyons.