“Je vis pour lire, pour méditer, pour coller l’oeil aux serrures, pour pister des filles, pour rôder et fantasmer.”
James Ellroy
Nous sommes les mains et les terminaisons nerveuses d’une divinité aveugle.
Nous caressons le monde.
Ou, variations : je suis un personnage de roman, un ange noir, un voyageur interstellaire, l’homme qui venait d’ailleurs. Je me dis : six mois de gestation – au lieu des neufs réglementaires – ont laissé une partie de moi dans l’éther. J’aggrave mon cas en me tenant autant que possible à l’écart de l’égolâtrie de mon époque. J’adopte d’instinct, vers quinze ou seize ans, sans culture philosophique préalable, le postulat borgesien selon lequel : Le moi n’existe pas.
J’ai passé ma vie à me raconter ce genre de ficelles.
Il est temps, je pense, d’inverser la vapeur.
Je me rapproche de l’humanité – et de la mienne par la même occasion – à proportion que je fricote avec la littérature. Elle ment et dissimule infiniment moins que vous-même. Vous avez beau me répéter indéfiniment qu’elle n’est pas la vie. À quoi bon m’échiner à vous prouver le contraire ? Je m’allonge les mains croisées derrière la nuque, le dernier Ellroy sur l’oreiller. Je passe en revue les femmes qui comptent ou ont compté dans mon existence. Je pense à mes deux trois quatre mères. Et j’en viens à considérer une chose simple néanmoins difficile à avouer. Ces femmes déterminent une part considérable de ma vie. Ces femmes singulières singularisent mon rapport au monde. Même s’il m’arrive de m’opposer à Elles, même si je sais ne pas être uniquement le fruit d’un processus biologique dont Elles auraient la clé. Même si je ne suis pas le genre de type à conchier la Loi du Père. Je sais que mes rodomontades machistes ne m’exonèrent en rien du devoir qui m’incombe : leur rendre grâce pour la compréhension aiguë de moi-même qu’elles peuvent et m’ont déjà apporté.
Ma part d’ombre.
Ma première rencontre avec James Ellroy eut lieu en 2000-2003. Quelque part par là. Gniole city. Pays du polar et des poitrines plantureuses. Je regarde la littérature dite de genre d’un oeil torve, dubitatif ou dédaigneux. Comme si elle s’opposait ou se trouvait aux antipodes de la Grande littérature. L’ami Fred sent ça et veut faire voler en éclat mes oeillères de petit intello étriqué. M’ouvrir les yeux sur l’océan abyssal du roman noir et le génie d’Ellroy en particulier. Je ressors de chez lui avec Ma part d’ombre dans les mains. Je m’y attèle de suite. Le charme Ellroy opère ilico presto. Mes préjugés prennent l’eau de partout, merci l’ami.
James Ellroy est né le 4 mars 1948 à L.A. Le prototype de l’individu hors-norme. Au propre (Ellroy mesure 1m90) comme au figuré. Sa mère, Jean Hilliker, la rouquine comme il l’appelle, est assassinée alors qu’il n’a que dix ans. Instant décisif. Arrêt sur absence d’images. L’assassin n’a d’ailleurs jamais été retrouvé, comme par hasard. L’inimaginable frappe le jeune Ellroy de plein fouet et le plonge de facto dans un univers fantasmatique qui ne le quittera plus jamais. L’évidence : James Ellroy est né une seconde fois le 22 juin 1958. Destiné à faire front contre l’inimaginable. Comme prédestiné au sacrifice et à la rédemption qui sont, au fond, les deux ressorts du roman noir.
Ma part d’ombre commence à peu près comme ceci : « Je veux trouver l’amour que nous n’avons jamais eu et l’expliciter en ton nom. Je veux mettre tes secrets au grand jour. Je veux consumer la distance qui nous sépare. Je veux te donner vie ». Suivent près de six cent pages pour assassiner l’inimaginable, ce que peut seule la littérature. Colmater les brèches opérées dans l’histoire. Donner sens à ce qui se dérobe. Lever des malédictions. Se réconcilier avec Elle par-delà le temps, la mort et l’étanchéité des mondes.
On croyait donc tout savoir du rapport Ellroy-Hilliker ; on pensait à bon droit qu’Ellroy avait tout dit sur ce dossier, erreur.
S’il y a d’une part l’inimaginable, il y a de l’autre l’inavouable.
L’inimaginable : la mort de sa mère. L’inavouable : avoir souhaité la mort de sa mère. Ce qu’il nomme très justement La malédiction Hilliker. Nous sommes trois mois avant le meurtre. Trois mois avant que ne commence l’odyssée Ellroyienne proprement dite. Papa et maman sont séparés et se tirent dans les flancs à distance. Papa Ellroy prétend engager un détective pour surveiller son ex. Papa Ellroy lui monte le bourrichon et traite sa mère de traînée. Maman s’envoie en l’air et boit du bourbon bon marché. Maman Hilliker offre un costume tout neuf pour aller à l’église. Papa Ellroy offre une paire de lunettes à rayon X. Maman demande ce que tu préfères : vivre avec papa ou avec maman ? Le gamin répond : avec papa. Et vlan : la gifle. Le gamin valdingue au sol et s’ouvre le cuir chevelu. Il profère intérieurement sa malédiction, avec dans le coeur, le couple infernal et contradictoire : amour-haine. Tiraillé entre désir et détestation de fond. C’est déjà trop tard. La malédiction a été prononcée. Spontanément. Avec la rage dont seul l’amour est capable. L’amour pour une mère. Et lui seul. On retrouve trois mois plus tard le corps de Jean Hilliker assassinée au bord d’un trottoir. Et si les mots pouvaient tuer, hein ? Dans sa petite tête d’enfant, la machine à fantasme se met peu à peu à turbiner à plein régime. On n’a jamais retrouvé l’assassin de Jean Hilliker.
Oui, Dieu existe. Et les mots peuvent tuer.
J’ai noté que la plupart des hommes ignorent sur quoi repose leur obsession des femmes. Et ce en dépit des lumières freudiennes. Que voulons-nous voir au juste ? Quel mystère cherchons-nous à percer ? Passerons-nous notre existence à traquer notre mère derrière Elles. Elles, toutes singulières. Et qui, en réalité, n’ont jamais eu pour rôle de se substituer à ELLE ?
Oui, Dieu existe, et les mots peuvent lever des malédictions : « Le monde où je vis, ce sont les femmes qui me le donnent, et ce sont les femmes qui en font un lieu où je me sens en sécurité. Je ne peux plus continuer très longtemps d’aller vers Elles dans l’espoir de La trouver ».
Un type littéralement hors-norme. Jusque et y compris dans la lucidité, pas uniquement en ce qui concerne l’Histoire, la Grande, mais aussi, ce qui est primordiale, dans cette lucidité sur soi :
“Nous regardons. Nos globes oculaires abolissent les distances et nous tournons en orbite. Nous reluquons les femmes. Nous sommes en quête de quelque chose d’énorme. Mes héros ne le savent pas encore. Leur créateur encore vierge n’en a pas la moindre idée. Nous ne savons pas que nous déchiffrons des personnages. Nous regardons afin de pouvoir un jour cesser de regarder. Nous avons désespérément besoin des valeurs morales d’une certaine femme. Nous la reconnaîtrons lorsque nous La verrons. En attendant, nous continuerons de regarder.”
Les romans d’Ellroy : des types pour le moins borderlines et des femelles affriolantes comme tremplin à la rédemption, le tout sur fond d’Histoire, la Grande, et de magouilles politiques.
Derrière son obsession des femmes, à l’origine de ses branlettes compulsives, de son adoration pour la mezzo-soprano Anne Sofie von Otter, les musiciennes, les putes, les filles comme il faut, les filles aux défauts physiques prononcés, de son amour pour elles en général et bon nombre en particulier : un visage. Le visage de celle dont on a souhaité la mort et à laquelle on a concouru.
Du moins le croit-on.
Ellroy encore : « Je voulais tout apprendre sur elle et sur le sexe d’une façon affriolante mais avec une approche mystique. Ce que je voulais, en proportion parfaitement égale, c’était Dieu et Elle, et son monde intime à elle ».
Et aussi : « Mon idée maîtresse, c’était : les femmes en tant que muses. Je faisais subir à la gent féminine tout entière une véritable course d’obstacles. Les rares élues franchissaient fièrement la dernière haie. Des prostituées choisies avec soin survivaient à une série de repérages en voiture et je les décrétais aptes à m’avoir une fois pour client et à rester dans ma mémoire éternellement. Les musiciennes survivaient chastement. Je ne portais jamais leur instrument. Je récoltais quelques sourires qui me permettaient de tenir jusqu’à la semaine suivante ».
Maman m’offre un costume tout neuf pour aller à l’église. Papa m’offre une paire de lunettes à rayon X. Ce dit par parenthèses : une vraie arnaque. Qu’importe, Dieu existe. Et les mots ont des yeux d’une acuité qu’aucune paire de lunettes ne dispense. On lit page 15 de La Malédiction Hilliker : « Dès le départ, j’étais un spectateur. L’accès visuel était pour moi synonyme de conquête ».
C’est plus fort que lui, il faut qu’il reluque les filles par les fenêtres, il lui faut pénétrer dans leur chambre durant leur absence. Il faut accumuler un réservoir considérable de visages.
Beaucoup de femmes dans le collimateur, donc, une superposition kaléidoscopique de visages pour, au final, n’en former qu’un seul. Et puis, of course, des figures phares. Helen, Joan, Erika. Nous en avons tous. Quelques Grands Amours. Quelques accords singuliers. Des promesses folles. Sincères. Des visages embrassés pour eux-mêmes. Et seulement eux-mêmes. On en arrive à ne voir personne d’autre que l’autre dans l’autre. On plante sa tente. Cette fois, et une bonne fois. On croit ça. Très franchement. Je veux me marier avec toi. Je veux une fille (une fille, bien entendu) avec toi. Dans un élan de monogamie monomaniaque. Une fidélité à toute épreuve. Ou presque…
La malédiction proférée à l’âge de dix ans à l’encontre de sa mère, la culpabilité qui en a découlé, ont fait l’immense écrivain James Ellroy. Il aurait pu être littéralement écrasé par l’une et par l’autre. Il décida, lui ou quelque chose en lui décida, de prendre le destin à la gorge. D’aller plus loin que la peur et la rage. De transformer, par l’étrange alchimie de la volonté et de l’écriture, cette malédiction en miracle.
Miracle d’amour. Pour chacune. Miracle de détermination. Miracle de résurrection.


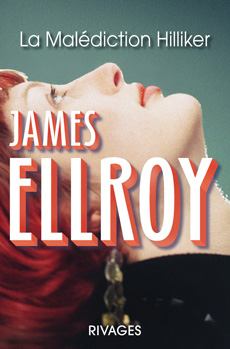

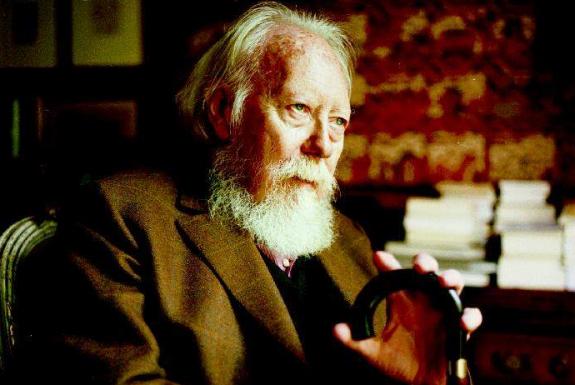


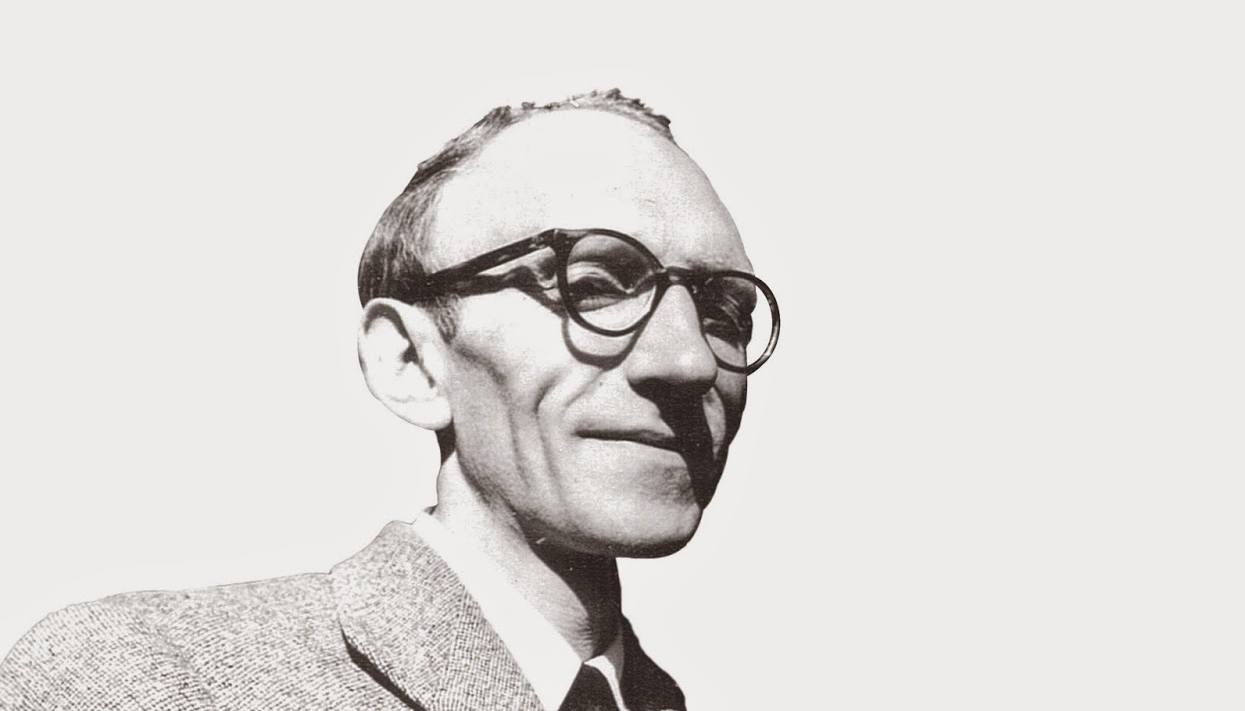

Ellroy or nothing.