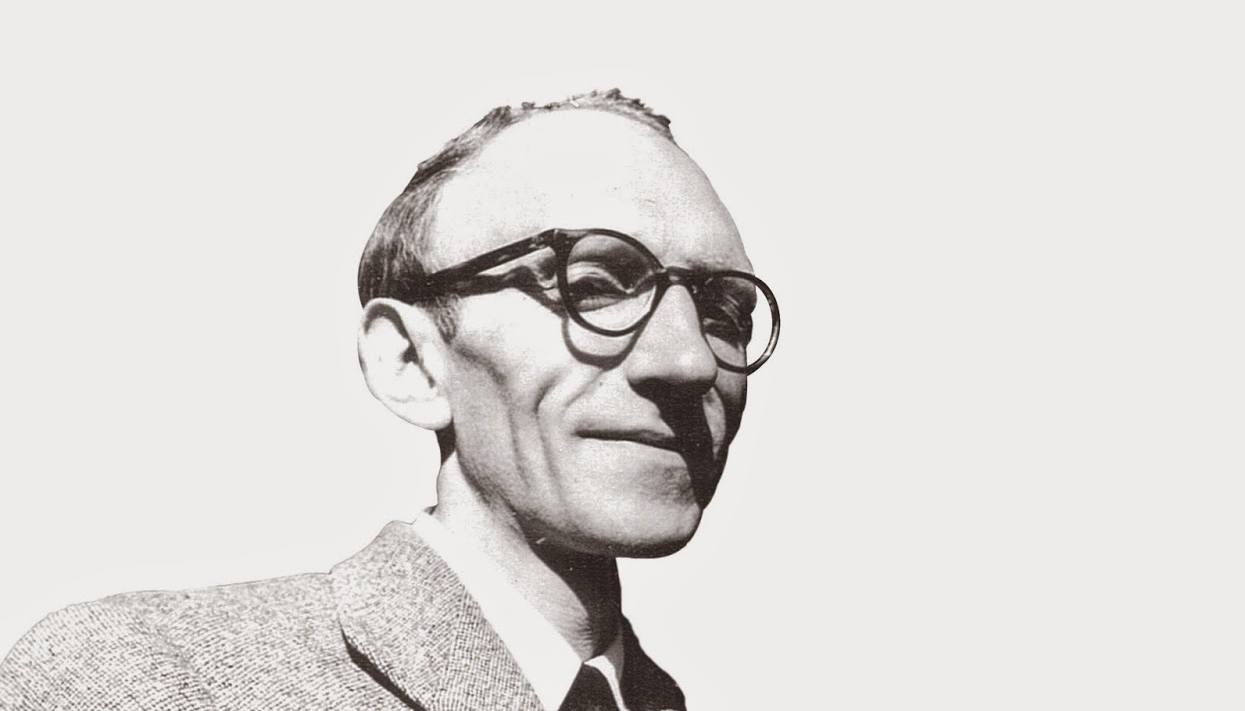Il s’agissait de meubler quelques jours de farniente après et avant une série de conférences sur les derniers jours de Stefan Zweig. Quitter l’Allemagne disparue, fuir le monde d’hier, s’extraire en pensées du passé. Oublier Petropolis, l’exil, la traque, le désespoir, et le lent cheminement sur les bords de l’abîme, Stefan et Lotte, main dans la main. Oublier Zweig un temps avant de retomber dans Zweig. Briser la fiole de Véronal, en déverser le contenu dans un puits. Devenir amnésique de son propre livre quand chacun vous convie à vous y replonger. Et que vous prenez goût à ce bain-là tant vous vous êtes immergé dans ces eaux-là, et si elles furent noires et tumultueuses, si remonter le courant fut douloureux comme doit l’être l’exercice d’un roman, combien cette sensation fut exquise, l’acte d’écrire voluptueux. Tellement qu’il vous tarde de vous replonger à nouveau dans l’aventure romanesque. Les nouveaux héros du prochain roman prennent déjà forme dans votre esprit. Vous les repoussez hors de vous-même parce que, peut-être, le temps du roman n’est pas encore venu. Peut-être faut-il attendre de faire le deuil du roman passé avant de plonger dans le suivant. Des règles de la création ont-elles été édictées à l’usage des écrivains? On brûle de revenir au roman, de se brûler les ailes. Mais faut-il écouter l’appel des fonds inconscients ou se montrer raisonnable. Fallait-il considérer à leur juste mesure les personnages qui commençaient à prendre vie dans mon esprit. Leur caractère s’aiguisait. Leur destin se tramait. Des esquisses de leur silhouette et de leur visage se formaient, puis se dérobaient. L’écriture d’un roman tient de la sorcellerie et de l’artisanat. Vous marchez dans la rue mais d’autres vies que la vôtre – et que nul autre que vous n’entr’aperçoit – traversent le trottoir. Un roman est en train de naître. Bientôt sans doute toutes vos forces se concentreront sur ce seul fait de construire l’histoire de ces vies. Vous ne songerez plus qu’à ça. Vous oublierez vos amis et vous oublierez vos proches. Vous serez seul avec vous-même entouré de dix êtres et entourés de spectres. Vous bâtirez un univers. Vous vous retirerez du monde même si vous continuerez à rire, à parler du temps qu’il fait et du monde qui va au plus mal. Vous habiterez un autre monde où nul être n’aura sa place. Votre vie vous semblera banale et insignifiante. Le seul lieu captivant sera l’endroit inaccessible de votre solitude. Vous devrez vous bannir du monde alentour, vous exclure du monde des vivants pour tenter d’exprimer une vie plus vraie que la vie réelle. Aucune autre vie que celle que vous serez en train d’écrire ne vaudra d’être vécue. Vous devrez être habité d’une foi inébranlable en vous-même, tandis que chaque instant sera l’instant du doute. Un jour, vous ne douterez plus. Le chemin de votre mémoire croisera la route de votre imaginaire. A ce carrefour-là, vous connaîtrez le bonheur. Parfois vous errerez dans le désert et parfois vous vous perdrez dans une jungle de mots et d’images enchevêtrés. Vous tenterez de capter les échos du temps présent, vous écouterez la voix du passé, parfois résonneront les éclats de rire des vivants, parfois vous parviendra le murmure des morts. Vous écrirez un roman. Vous céderez à l’affliction, vous tomberez dans l’amertume des matins secs et la jubilation des nuits enfiévrées lorsque ce n’est pas écrire qui est impossible mais de ne pas écrire. L’angoisse de la page blanche cèdera le pas sur l’exaltation des nuits blanches. Un jour la grâce tombera sur la pièce. Vos personnages prendront vie. Vous n’aurez qu’à les contempler. Ils s’exprimeront sous vos doigts. Vous déchiffrerez des signes. Vous traduirez des expressions. Les mots couleront comme du miel. Le sang de vos héros s’écoulera dans l’encre de votre imprimante. Votre langue drainera une rivière de mots, vous tenterez de recueillir les pépites. La plupart vous échappera. Parfois une forme argentée jaillira au milieu des flots. Le monde extérieur tentera de vous réduire au silence. Votre volonté surpassera l’entendement. Vous refuserez de voir et vous refuserez d’entendre. Tout ailleurs vous semblera morose. Vos souvenirs se métamorphoseront. Vos actes passés les plus insignifiants, les rencontres les plus anodines seront transcendées. Des hommes et des femmes seront le jouet de votre imagination. Votre livre sera l’ombre de vous-même. Vous vivrez à l’ombre de vous-même. Le désespoir sera votre plus fidèle ami. Il vous guidera sur le chemin. Il tournera les pages. Il vous éveillera au beau milieu de la nuit. Des échos lointains et confus vous parviendront aussi distinctement que si l’on vous chuchotait à l’oreille. Vous serez sourd à la clameur du temps. Vous deviendrez aveugles aux tentations extérieures. Rien ne pourra vous distraire, nul évènement ne saura vous stopper. Les plus belles des femmes vous paraîtront sans saveur. Les grandes catastrophes vous laisseront sans larmes. Un dîner entre amis sera du temps perdu. Rire sera perdre du temps. Vous partirez en paix vers des lointains sauvages. Vous marcherez dans la tourmente. Et vous marcherez dans le froid. Le jour suivant, vos prières seront entendues, le moindre de vos vœux exaucé. Votre vie sera faite de petits miracles d’écriture. De grands naufrages s’ensuivront. Le ciel prendra les couleurs que vous choisirez. Vous déciderez du temps. Vous choisirez les paysages et les saisons. Et en même temps vous ne déciderez de rien. Le gris du ciel, les averses tomberont sans que votre avis importe. Les destinées de vos héros se croiseront sous vos yeux. Vous ne pourrez intervenir. Les destins seront scellés sans vous. Les créatures ne vous appartiendront plus. Le roman vous échappera. Les histoires prendront leur propre logique. Chaque personnage s’emparera de son destin. Vous serez assujettis à vos personnages. Un monde s’interposera entre la réalité et vous. Vous vous glisserez dans cet interstice. Vous aurez trouvé votre place dans l’univers.
Mais je n’avais pas encore atteint ce lieu-là. Quitter Zweig pour d’autres rivages n’était pas chose aisée. Après une visite au Palais de Tokyo pour une exposition sans grand intérêt, je flânais dans la librairie du palais, ouverte tard dans la nuit et où je pensais me perdre et m’abandonner au milieu de piles de volumineux ouvrages sur l’art contemporain affichant des corps nus et des couleurs vives. Au milieu des allées, mon regard fut attiré par un petit livre, en deux exemplaires, qui avait la taille d’un carnet et dont la couverture jurait par sa sobriété. Deux noms et deux dates pour titres. Hannah Arendt Walter Benjamin 1892-1940. J’achetai le petit livre et me jetai sur ces pages en rentrant. Il s’agissait, aux éditions Allia, d’une réédition d’une courte biographie écrite par la philosophe sur la vie de l’intellectuel allemand et publiée en 1955. Ce court texte était d’une intelligence absolue. Il résumait une existence. On croisait les figures de Brecht, de Klaus Mann, d’Adorno et de Heine. On trouvait une citation d’Heidegger qui, en l’état, faisait quelque peu sourire. Etaient analysés les rapports de Benjamin avec l’œuvre de Kafka, avec le judaïsme et avec l’Allemagne. Au beau milieu du livre, ces phrases : « Le 26 septembre 1940, Walter Benjamin qui était sur le point d’émigrer en Amérique se donna la mort à la frontière franco-espagnole… Rien ne l’attirait en Amérique, où, lui arrivait-il de dire, l’on ne pourrait sans doute rien faire d’autre que le trimbaler à travers le pays et l’exhiber comme « le dernier Européen ». » Je finis par m’endormir dans un sommeil agité par des images de Stefan Zweig dans son insupportable et provisoire exil new-yorkais.