A l’époque où je tournais un film documentaire dans une petite ville russe appelée Kotelnitch, j’ai connu un groupe de lycéennes dont quelques-unes étaient vraiment charmantes. Elles aimaient qu’on les filme, nous aimions les filmer. Parfois, en les regardant, je pensais à ces filles longilignes, blondes, superbes, qu’on rencontre dans les boîtes de Moscou et qui, maîtresses de nouveaux Russes ou de riches étrangers, vêtues de manteaux de fourrure sur des robes très courtes et très chères, roulant en Mercedes à vitres fumées, jugeant leurs compagnons au seul poids de leur carte de crédit, promènent sur le monde un regard d’une dureté glaçante. Je me disais : beaucoup de ces filles doivent venir de bleds comme Kotelnitch, de familles où on gagne six cents roubles par mois et ne bouffe que des pommes de terre. Beaucoup, avant, devaient être fraîches et joyeuses comme mes lycéennes. Un jour, elles ont pris le train pour échapper au sort de leurs infortunés parents et, armées de leur seule beauté, fait en toute connaissance de cause le choix de la prostitution de plus ou moins haut vol, dont un sondage récent révèle que les deux tiers des jeunes Russes l’envisagent sans aucun scrupule moral comme un moyen de se faire une place au soleil. Je me demandais ce que seraient les vies de mes lycéennes si elles restaient à Kotelnitch, ce que seraient leurs vies si elles en partaient, et où elles en seraient, disons quinze ans plus tard.
Je vis dans un pays tranquille, doucement déclinant, où la mobilité sociale est réduite. Né dans une famille bourgeoise du 16e arrondissement, je suis devenu un bobo du 10e. Fils d’une historienne et d’un cadre supérieur, je suis écrivain et vis avec une journaliste. Mes parents ont une maison de vacances dans l’île de Ré, je projette d’en acheter une près d’Uzès. Je ne dis pas que ce soit mal, ni que cela préjuge de la richesse d’une expérience humaine, mais enfin du point de vue tant géographique que socioculturel on ne peut pas dire que la vie m’a entraîné très loin de mes bases, et ce constat vaut pour la plupart de mes amis. Je suis d’autant plus fasciné par les destins qui couvrent un spectre large, traversent des univers très variés, pas contigus, a priori étanches. Et la Russie, où depuis vingt ans tout change incroyablement vite, où des fortunes colossales s’édifient à partir de rien et où du même coup se creusent des gouffres sociaux vertigineux, la Russie où l’Histoire bouge encore est le pays de tels destins.
J’en ai raconté un récemment, celui d’Édouard Limonov qui a été tour à tour voyou dans une petite ville d’Ukraine, poète underground à Moscou sous Brejnev, clochard puis valet de chambre d’un milliardaire à New York, écrivain branché à Paris, soldat de fortune dans les Balkans et, à Moscou de nouveau, dans le bordel du post-communisme, leader d’une formation portant le nom engageant de Parti national- bolchevique. Et cela fait longtemps que je songe à raconter l’histoire d’une de ces beautés russes qui font tant fantasmer les Occidentaux. On se demande d’où elles viennent, où elles vont, ce qu’elles ont dans la tête en dehors de l’obsession de devenir le plus riches possible ou plus exactement de mettre le grappin sur le type le plus riche possible – parce qu’elle existe, bien sûr, cette obsession, mais je suis convaincu que ce n’est pas tout.
J’ai eu, à un moment, un début et une fin.
Le début, c’est un bled pourri comme Kotelnitch, et une très jolie fille à qui sa mère a transmis sa passion toute soviétique pour le patinage artistique. Enfant, elle rêve d’être une championne de patinage. Adolescente, elle zone avec les petits délinquants locaux mais continue d’aller à la patinoire et d’y exécuter des figures au son de pots-pourris symphoniques sirupeux. C’est son rêve, c’est sa bulle. L’endroit où elle est reine.
Je passe vite sur la suite. Elle part tenter sa chance à Moscou, devient la maîtresse d’un homme riche. En plus d’être belle, elle est intelligente, elle a de la classe, un humour ravageur de survivante, elle s’adapte partout. Plus tard, elle sera mannequin, elle vivra à New York avec un peintre connu. Il y aura d’autres hommes encore, d’autres milieux, d’autres expériences. J’entre d’autant moins dans les détails qu’ils ne m’intéressent pas vraiment, j’en arrive à la fin.
Elle a quarante ans. Elle est devenue la favorite d’un prince saoudien qui pour lui faire plaisir a fait construire à Dubaï une immense patinoire pour elle toute seule. Et la dernière image, c’est elle en train de tourner, inlassablement, sur son hectare de glace au milieu du désert, la sono diffusant les tubes qui ont bercé son enfance à Kotelnitch.
J’aimais bien ce début et cette fin. L’histoire entre les deux, en revanche… Mannequins russes sublimes, faste des oligarques, jet set et cocaïne : il y a certainement une vérité derrière cette procession de clichés, mais c’est une vérité que je connais mal, et qui ne m’attire pas.
Reprenons.
Appelons notre héroïne Macha.
Disons qu’elle est née en 1978, dans une ville de garnison de l’Altaï ou du Kazakhstan. Famille de militaires, le père sert dans les forces spéciales. Dans la dernière décennie de l’Union soviétique, il combat en Afghanistan, infiltre des bandes armées dans les montagnes tadjiks, plus tard il fera la première guerre de Tchétchénie. C’est un héros, son buste est constellé de médailles. C’est aussi un homme au bout du rouleau : ulcères à l’estomac et au duodénum, système nerveux délabré, atroces migraines – séquelles de blessures à la tête. Pendant quinze ans, il a trimballé sa femme et ses deux enfants de caserne en garnison, dans les coins les plus chauds de l’empire. En 1991, quand l’empire s’effondre, il n’en peut plus et se dit que l’heure est venue de revenir à la vie ordinaire, qu’en réalité il n’a jamais connue. Il pense qu’après tout ce qu’il a fait au service de sa patrie, il mérite bien un appartement, une aide à la réinsertion. Mais sa patrie n’existe plus, la hiérarchie militaire n’a rien à lui proposer, le montant de sa retraite, que de toute façon on ne lui paie pas, correspond avec l’inflation au prix d’un demi-saucisson. La seule reconversion qui s’ouvre à lui, c’est comme tueur professionnel : il est qualifié pour ça et dans le chaos de ces années il y a pour cette qualification-là une forte demande. Peut-être a-t-il exécuté un contrat, Macha, qui était lycéenne à l’époque, le soupçonne et préfère ne pas le savoir. En tout cas, son passage dans le privé est aussi foireux que sa sortie de l’armée et le seul repli possible pour la famille, expulsée de son logement de fonction, c’est la petite ville où habitent les parents de la mère. Disons Kotelnitch – étant entendu que c’est un nom générique pour ce qu’on appelle la gloubinka, la cambrousse russe. Poussière l’été, neige sale l’hiver, gadoue entre les deux. Trois cafés mornes, des trains qui passent et que personne ne prend jamais. Ils se retrouvent tous les quatre dans une chambre de la petite maison de bois où les deux vieux survivent grâce à leur potager. Macha arrive là à quatorze ans. Son petit frère Ilia en a neuf. C’est là qu’elle finira le lycée et lui l’école primaire. C’est là qu’elle aura son premier amoureux. J’imagine une punkette de province, traînant dans les squares pelés avec la bande de bons à rien, jeans noirs déchirés, crânes rasés et chiens-loups, usual suspects pour la police et recrues potentielles d’organisations louches comme le parti de mon camarade Limonov. Tous ces gens, que ce soit le père de Macha, son petit frère qui tourne au délinquant juvénile ou ses petits amis qui ne valent guère mieux, communient dans la certitude amère d’être floués, citoyens de seconde zone d’un empire autrefois puissant mais devenu un pays du tiers-monde, largués sur le bord de la route par la société qui sur les ruines de cet empire commence à prendre forme à Moscou, une société de gros gangsters et de petits malins où ils ne trouveront jamais leur place. Mais Macha, elle, veut y trouver sa place. Elle est belle, d’une beauté qui n’a rien à envier aux mannequins qu’elle voit à la télé, elle est maligne, elle a appris l’anglais, ou le français, ou les deux. Le train que personne ne prend, elle le prendra.
Deux ans plus tard, nous sommes en 1998, elle a vingt ans, elle travaille dans une des boîtes de nuit de Jean-Michel, à Moscou, et le moment est venu de présenter Jean-Michel qui, contrairement à Macha, est un personnage réel. Je l’appelle ici par son vrai nom ; il est, après ma productrice Anne-Dominique Toussaint, le principal destinataire de ces notes car j’aimerais, si on va plus loin, qu’il travaille avec moi au scénario.
La Russie des années 1990, sous les deux mandats d’Eltsine, c’était le Far West. Une économie de marché décrétée du jour au lendemain et alors que personne ne savait ce qu’est un marché, une corruption, une criminalité, une pauvreté et une richesse également démentes, pas d’autres lois que celle de la jungle, tout cela est connu. Les étrangers qu’attirait ce monde dangereux et excitant étaient de vrais aventuriers dont les sagas restent à raconter. Jean-Michel est un de ces aventuriers.
Il n’a que trois ans de plus que moi, mais cet écart suffit pour qu’il ait été, contrairement à moi, un soixante-huitard. C’était un jeune bourgeois curieux et dégourdi qui est passé par tous les trips des années 1970 : le maoïsme d’abord, puis la route, l’Asie, les communautés, la drogue, les religions orientales… Un compagnon de route d’Actuel, lié avec tous les gens qui comptaient dans ces diverses mouvances, et qui a négocié le tournant des années 1980 en devenant publicitaire. Il est passé des champignons hallucinogènes à la coke, de la révolution à la world music, il s’est laissé porter par l’air du temps, par ses intuitions, par ses femmes. Ce n’est ni un ludion ni un suiviste, mais quelqu’un qui a l’art de surfer sur la vague et de prendre la vie comme un jeu. C’est aussi un personnage exceptionnellement charismatique : petit, blond, aigu, à la fois ascétique et cool, les yeux d’un bleu extra-terrestre, une certaine ressemblance avec Sting ou, plus frappante encore même si moins de gens le connaissent, avec Brian Eno. Gentil, en plus.
En 1995, il lui est arrivé quelque chose de terrible : la femme qu’il aimait est morte dans le crash de l’avion de la TWA. Il s’est effondré, plus rien n’avait de sens. Sur un coup de tête, comme on s’engagerait dans la Légion étrangère, il est parti refaire sa vie en Russie.
J’ignore comment ça s’est passé au début, je compte bien qu’il me le raconte dans le détail un jour. Je sais que trois ou quatre ans après son arrivée il était à la tête d’un empire de la nuit à Moscou : des restaurants, des bars, mais surtout des boîtes, de plus en plus chic et chères, où nouveaux Russes et expat’ friqués sont accueillis par de très jolies filles pratiquement à poil qui se disent étudiantes et leur font pour cinq cents dollars passer un bon moment. On en pense ce qu’on veut moralement, mais bâtir un tel empire en partant de rien, sans presque parler russe, dans un secteur contrôlé par la mafia et à une époque où on se retrouvait comme un rien les pieds dans le ciment au fond de la Moskova, cela suppose des nerfs d’acier, un sens des affaires et surtout du contact hors du commun. Il faudrait un Scorsese pour raconter cette aventure-là. Ce n’est pas du tout ce que je me propose de faire, tout ce que je veux qu’on comprenne, c’est que Jean-Michel est un type assez impressionnant, d’autant plus impressionnant qu’il n’a rien du patron de boîte de nuit ou du truand style De Niro dans Casino : il ne frime pas, n’élève pas la voix, il a gardé de ses années baba l’habitude quotidienne de la méditation d’où il tire un calme quasi surnaturel. Comme dit un de nos amis communs : Jean-Michel, en fait, c’est maître Yoda.
Je n’ai pas connu Jean-Michel dans les années Eltsine, les plus rock’n’roll, mais après 2000, sous Poutine qui a restauré l’ordre. Un ordre corrompu tant qu’on veut, pas regardant sur les libertés, mais les guerres de gangs sont en veilleuse, le business obéit désormais à des règles, on peut souffler. Jean-Michel crée de temps en temps un nouveau club qui est pour quelques mois la nouvelle attraction de Moscou. Des hommes de confiance gèrent, les pots-de-vin vont à qui de droit, les affaires tournent. Jean-Michel vit aujourd’hui avec une ravissante jeune femme d’origine kazakh qui étudie la philosophie et la théologie orthodoxe. Ils communiquent moitié en français – qu’elle parle assez bien – moitié en russe – qu‘il parle assez mal – et, l’un dans l’autre, s’entendent à merveille. Ils passent de plus en plus de temps ensemble dans le riad qu’il s’est acheté à Marrakech. Là-bas, Jean-Michel s’occupe d’une plantation d’oliviers qui donne du travail à des centaines de paysans, et ces paysans le considèrent comme leur bienfaiteur. Il n’est pas impossible qu’il commence à s’ennuyer.
Revenons à Macha – dont je rappelle qu’elle est, elle, un personnage fictif. Débarquée de Kotelnitch et après un passage rapide par l’université, elle fait ses premières armes chez Jean-Michel. Il faut rendre cette justice à ses clubs qu’on n’y pratique pas l’abattage et que les filles n’y sont pas honteusement exploitées. Boîtes de luxe, filles de luxe, que les clients n’hésitent pas à emmener dans des dîners d’affaires ou de diplomates. Beaucoup sont réellement étudiantes et font ça pendant quelques années plutôt qu’un petit job sous-payé. Personne ne les retient quand elles veulent s’en aller, le patron les pousse même à prendre leur envol, se réjouit de leurs premiers succès professionnels ou de leurs mariages, bref c’est aussi humain et détendu que la prostitution peut l’être.
Disons que notre Macha tombe raide amoureuse de Jean-Michel. Lui, de son côté, l’aime beaucoup : il la trouve non seulement belle, mais brillante, il est curieux de voir ce qu’elle deviendra si les petits cochons ne la mangent pas. Il n’est pas question qu’ils couchent ensemble car Jean-Michel vit avec une autre femme et, s’il en change tous les six ou sept ans, il est durant chacun de ces cycles strictement monogame. Un jour, Macha lui dit, avec beaucoup de calme et de détermination : dans dix ans, tu verras, je serai ta femme. Peut-être bien, répond Jean-Michel qui n’aime rien exclure, qui sait ?
Macha a beaucoup trop de classe et d’envergure pour faire de vieux os comme entraîneuse dans une boîte de nuit. À la suite d’une rencontre qu’a favorisée Jean-Michel, elle fraie bientôt dans le milieu des Russes très riches, ces jeunes hommes brutaux qui braillent sans arrêt dans leur téléphone portable, se déplacent en Falcone avec une escouade de gardes du corps et, à Courchevel, remplissent leurs jacuzzis de Veuve Clicquot. Elle se marie avec l’un d’eux. Elle a un enfant, encore très jeune. Son mari se fait descendre, ce sont des choses qui arrivent. Elle est un peu mannequin, elle fait un peu de business, elle rame mais finalement s’en sort. Ce n’est pas juste une fille qui passe d’homme en homme et n’existe qu’en fonction de ses hommes. Elle trace son chemin seule, elle est déterminée, responsable, et son homme, d’ailleurs, elle l’a depuis longtemps choisi.
Elle retrouve Jean-Michel et le conquiert pour de bon un peu avant le terme qu’elle lui avait annoncé. Il reconnaît de bonne grâce : tu avais raison. Quand l’histoire commence, ils vivent ensemble depuis trois ans.
Elle a trente ans. Son petit garçon en a huit, il a surtout été élevé pendant qu’elle luttait pour survivre par ses grands-parents paternels, mais maintenant que les choses sont stabilisées, elle le voit et s’en occupe davantage. Elle mène avec Jean-Michel, entre Moscou et Marrakech, une vie facile et luxueuse. Elle aime ce luxe, cette facilité, elle vit comme une victoire d’y avoir accès, mais elle n’oublie pas d’où elle vient, ni que l’assiette de sushis qu’elle règle d’une carte Gold négligente représente plus d’un an de la solde de son père, au temps où il avait une solde. Elle est réellement élégante – tout sauf la pétasse écervelée et cupide qui dévalise les boutiques de l’avenue Montaigne. Comme beaucoup de Russes de sa génération, elle est soucieuse de spiritualité. Elle s’est fait baptiser dans l’église orthodoxe, elle porte une petite croix au cou, elle entraîne Jean-Michel à la messe de Pâques, mais elle est attirée aussi par le bouddhisme. Elle fait du yoga, ils en font beaucoup tous les deux. Ils ne boivent pas, ne fument pas – hormis quelques pétards. Ils sont calmes et sereins, je dis ça sans ironie aucune. Par ailleurs, elle s’occupe très activement d’une organisation caritative dans laquelle Jean-Michel investit une partie de son argent. Il s’agit de distribuer je ne sais combien de tonnes par mois de produits alimentaires à des familles miséreuses dans la région de Moscou : quelque chose comme les Restos du cœur . Le charity-business n’existe quasiment pas en Russie, cela viendra comme le reste mais pour l’instant Jean-Michel est un précurseur : quand il demande de l’argent pour ses crève-la-faim à un copain oligarque qui vient de se faire construire à Sotchi une réplique du château de Chenonceaux où il ira deux fois dans sa vie, ce n’est pas que l’autre lui rie au nez, mais il ne comprend pas l’idée. La fondation repose uniquement sur la fortune de Jean-Michel et sur le dynamisme de Macha, qui s’y consacre de façon très concrète et pragmatique.
Pour la suite, c’est encore flou, mais j’aimerais bien que le film pour commencer soit un portrait de femme. On verrait Macha vivre à Moscou, aujourd’hui, et au fil des rencontres et des conversations on saisirait des bouts de ce que je viens de raconter. On la verrait par exemple faire la tournée des petits vieux nécessiteux, et en l’écoutant parler avec eux, dans leur cuisine, on comprendrait qu’elle est à des années-lumière et en même temps très proche encore de leur monde désormais préhistorique. On la verrait suivre un séminaire New Age (les Russes sont très clients pour ça), mais aussi allumer des cierges à l’église et prier devant l’iconostase comme n’importe quelle vieille babouchka. On la verrait avec ses beaux-parents, les parents de l’homme d’affaires assassiné, et avec son petit garçon, qui a la nationalité suisse. On la verrait avec Jean-Michel, on verrait que leur relation n’a rien à voir avec le cliché de la belle fille vénale qui s’est trouvé un riche étranger, que ce n’est pas seulement une relation d’amants mais de partenaires, faite de respect, de confiance, d’humour : on se dirait, il faudrait qu’on se dise, que c’est une belle relation. On la verrait évoluer avec un parfait naturel dans une boîte luxueuse où elle montrerait à la fois l’œil à qui rien n’échappe d’une femme dure en affaires, exigeante avec les employés, et une sollicitude de grande soeur pour des filles dont certaines se trouvent exactement là où elle se trouvait dix ans plus tôt. J’aimerais creuser ses rapports à la fois complices et protecteurs avec une de ces filles, les faire parler ensemble de la vie et des hommes russes, connus pour être grossiers, pochetrons, veules, amants lamentables, mais ça commence doucement, tout doucement à changer. Par exemple, cette fille de vingt ans, qui fait à la fois l’escort girl et des études de management, a un petit ami très sympathique qui s’est récemment avisé qu’il était important dans la vie, que c’était même la chose la plus importante, de bien se conduire : khorocho sébia viésti. Bien se conduire, cela veut dire très concrètement des choses comme ne pas arriver en retard aux rendez-vous, ne pas parler trop fort, ne pas balancer la porte dans la gueule des gens qui arrivent derrière, en somme ne rien faire de ce que fait le gros porc de Russe lambda, riche aussi bien que pauvre et peut-être encore plus riche que pauvre. Avoir découvert ça, l’importance et l’intérêt de khorocho sébia viésti, c’est pour ce bobo russe en début d’ascension sociale une véritable révolution mentale qui fait de lui un mutant dans son pays, l’avant-garde d’une élite dont l’édition russe d’Elle s’emploie à hâter l’avènement et qui fait rêver toutes les filles. C’est bien, découvre-t-il, de faire rêver les filles, pas seulement de les tirer vite fait avant d’aller boire des bières entre potes. Il a pigé un truc que les autres n’ont pas encore pigé, et qui lui donne une bonne longueur d’avance dans la course à la réussite. Je donne cet exemple parce que j’ai entendu récemment une conversation très marrante à ce sujet et parce que toute cette partie du film devrait être tissée de menues notations de ce genre. On verrait qu’une femme comme Macha fait partie de la dernière génération à avoir connu le communisme et le sentiment d’enfermement qui va avec, à trouver du prestige aux étrangers, alors que sa cadette de dix ans a toujours été libre : le goulag, pour elle, c’est Jurassic Park, Soljenitsyne, une figure à peu près aussi familière que le pape Jean XXIII pour une candidate de la Star’Ac, et les étrangers aujourd’hui sont moins riches que les Russes, alors quel intérêt ?
Tout cela fait une chronique, des portraits, des vignettes, pas vraiment une histoire. Pour qu’il y ait une histoire, il faudrait qu’une crise mette en jeu cet équilibre, et la vague idée de crise que j’ai pour le moment a des chances de rejoindre au cimetière des fausses pistes la patinoire de Dubaï. J’en dis un mot quand même.
En très gros : il arrive quelque chose de grave à Ilia, le petit frère resté à Kotelnitch. Il peut être mêlé à un meurtre, et ce meurtre peut être lié à une organisation extrémiste comme le Parti national-bolchevique de Limonov, qui exprime assez bien le désespoir des jeunes gens paumés de la province russe. Ilia, en tout cas, est en prison là-bas, et quand elle l’apprend, Macha décide d’y aller.
Depuis douze ans qu’elle a quitté Kotelnitch, elle y est quelquefois retournée et ces brèves visites l’ont déprimée. Une fois, elle a fait venir Ilia à Moscou, elle lui a même trouvé un boulot mais ça n’a pas marché, il a tout fait pour se faire virer, son séjour a été un cauchemar. Ilia, les parents, Kotelnitch, elle y pense avec compassion, mais une compassion impuissante. Jean-Michel ne les connaît pas, elle ne tient pas à ce qu’il les connaisse. Mais cette fois, comme c’est grave, comme il la voit très bouleversée, il insiste pour l’accompagner.
La seconde partie du film se passerait donc là-bas. Je n’en connais pas les péripéties, mais j’en connais les décors et l’ambiance. Je connais quelques-uns des personnages : le père ravagé par ses nerfs malades, parano, fou d’amertume et de haine ; la mère qui pourrait ressembler à celle d’Ania, une jeune femme que j’ai connue à Kotelnitch, qui m’a servi
d’interprète et qui a fini découpée à la hache par un fou avec son bébé de huit mois ; le groupe d’anciennes copines ; celle qui a épousé l’entraîneur du club de body-building ; le petit frère national-bolchevique… J’imagine des scènes : toute une nuit où on va chez les uns, chez les autres, on ne sait pas chez qui on est, on ne sait pas qui est qui, ami ou ennemi, ça sent l’ivresse et vaguement la menace et ça se finit à l’aube sur la vieille barge rouillée, au bord de la rivière…
Et Jean-Michel, là-dedans… Ce monde-là, il ne le connaît pas. Quand il quitte Moscou, c’est pour Paris, New York ou Marrakech. En fait de Russie profonde, il a été en avion privé participer à une chasse à l’ours dans le chalet de trente pièces d’un oligarque en Sibérie. Il ne comprend pas tout ce qu’on dit autour de lui. Cependant il en faut beaucoup pour le désarçonner. C’est un aventurier, il en a vu d’autres, les hôtels sordides ne lui font pas peur, ni les délires et les provocations d’un vétéran qui se vante du nombre d’hommes qu’il a tués. Il laisse venir, son regard bleu fait chavirer la mère de Macha. Quant à la bande des petits lumpen-bolcheviks, ils jouent les terreurs mais ne demandent qu’à se soumettre à un homme, un vrai, et sur ce terrain-là Jean-Michel vaut bien un Limonov. Ce qui sera difficile, pour lui, mais alors vraiment difficile, ce sera d’aider Macha. De la laisser vivre ce qu’elle a à vivre et en même temps de rester auprès d’elle. D’accepter de la perdre ou de ne pas la perdre, je ne sais pas encore.
Que l’intrigue soit celle-ci ou une autre, qu’elle se déroule à Kotelnitch ou ailleurs, la question du film, c’est : vers quoi va Macha ? Je vois bien d’où elle part, je ne sais pas encore où elle arrive. Quel changement se fait en elle, quel choix elle a à faire.
Quand j’ai parlé de ce projet à Jean-Michel, il m’a raconté une histoire visant à illustrer le caractère complètement irrationnel des femmes russes, même les mieux intégrées et les plus pragmatiques. Un de ses amis, un homme d’affaires français, vivait avec une femme à peu près sur les mêmes bases que sa compagne et lui. Bonne relation, adulte, confiante. Femme intelligente, les pieds sur terre. Du jour au lendemain, elle l’a quitté pour se marier avec un ami d’enfance retrouvé par hasard, milicien dans une petite ville de la ceinture de Moscou. Milicien, cela veut dire flic de base. Sous-payé, corrompu, certainement alcoolique, voué à une vie minable. C’est lui qu’elle a choisi, avec lui qu’elle a eu coup sur coup deux enfants.
Est-ce que je veux que le film raconte ça ? Est-ce que je crois à ça, est-ce que ça m’intéresse d’y faire croire ? Et, question pas du tout subsidiaire : est-ce que je peux considérer une telle issue comme positive ?
Car dans le projet de ce film, il y a cette envie-là : qu’il finisse bien. Enfin, bien, je m’entends : pas forcément un happy end de comédie romantique. Mais que les personnages, à la fin, aient avancé. Que leurs choix les conduisent plus près d’eux-mêmes. Qu’ils ne s’enferment pas, ne se fourvoient pas, ne régressent pas, mais prennent conscience de ce qu’ils sont vraiment, de ce qu’ils désirent vraiment et agissent en conséquence.
Par rapport à ce programme, je ne suis pas sûr d’acheter l’histoire de la beauté russe qui plaque un séduisant aventurier doublé d’un maître zen pour un milicien de province. Je me méfie d’un scénario opposant à la sophistication du dandy cosmopolite la rugueuse authenticité du blaireau russe, et donnant la préférence à celui-ci – car si c’est ce que choisit Macha, il faut que le spectateur puisse approuver son choix. Je dois reconnaître cependant que ce scénario, avec tout ce qu’il charrie d’exalté et de pathologique, est on ne peut plus russe (voir Tolstoï, Dostoïevski et les autres), et que même si moi il me défrise, nombre de jeunes femmes russes civilisées y adhéreraient sans sourciller.
En 1989 a été présenté au festival de Cannes un premier film soviétique – c’était encore, plus pour longtemps, l’Union soviétique –, qui s’appelait Bouge pas, meurs, ressuscite. Son auteur, Vitali Kanevski y racontait ses souvenirs de délinquant juvénile à la périphérie d’un camp de prisonniers près de Vladivostok. Un truc rude. Le film était joué par deux très jeunes adolescents, presque des enfants, un garçon et une fille qui ont enthousiasmé le public par leur intensité, leur grâce sauvage. On attendait beaucoup de Vitali Kanevski mais dans les chaotiques années 1990 sa trace s’est plus ou moins perdue. Il a fait un autre film, qui n’a pas eu le succès de son magistral coup d’essai, il vivote aujourd’hui en tournant des documentaires.
Un de ces documentaires contient une scène extraordinaire. Elle se passe en prison, et on découvre qu’un des prisonniers n’est autre que Pavel Nazarov, le jeune acteur prodige de Bouge pas, meurs, ressuscite. Il était parti pour devenir délinquant et, dix ans après le film qui aurait pu faire dévier son destin, c’est bien ce qu’il est devenu. Il le prend avec un fatalisme goguenard. Déjà, il est surpris de voir débarquer Kanevski, mais il n’est pas au bout de ses surprises car Kanevski a amené avec lui Dinara Droukarova, la jeune actrice.
Ils ne se sont pas revus depuis le film. Ils venaient de milieux différents – lui prolo comme son personnage, elle nettement plus favorisée – mais ils ont été pendant le très long tournage, presque un an, comme frère et sœur. Puis leurs vies se sont séparées. Tandis que Pavel replongeait dans la galère, Dinara a tourné d’autres films, elle est devenue actrice pour de bon, quelques années plus tard elle a épousé un producteur français, c’est maintenant une vraie Parisienne qui habite une péniche et discute avec ses amis acteurs ou cinéastes des dernières sessions de l’Avance sur recettes. Je la connais par Pascal Bonitzer. C’est dire que son chemin et celui de Pavel ont tellement divergé qu’ils ne devraient plus rien avoir en commun.
Or ce qui rend bouleversantes leurs retrouvailles en prison, c’est qu’ils se retrouvent vraiment (Dinara dit qu’en réalité c’était plus compliqué ; je m’en tiens à l’impression que m’a faite le film). Ils évoquent leurs souvenirs de ce tournage éprouvant, aventureux, qui a été l’expérience fondatrice de leurs vies, mais ils n’en restent pas à la nostalgie. Ils se racontent leurs vies au présent et même si clairement un des deux s’en est sorti et l’autre pas, même si l’une a un avenir et clairement pas l’autre, ils sont de nouveau, face à face, les enfants sauvages et merveilleux du film. La vérité de cette scène, qui à la fois serre le cœur et l’exalte, c’est ce qui les unit à jamais, pas ce qui les sépare.
Tout le film que j’imagine pourrait tendre vers une scène comme celle-ci.
Lors de mon dernier séjour à Moscou, mon ami Emmanuel Durand, un Français qui vit là-bas depuis quinze ans, a été décoré de l’ordre « Gloire de la Russie » pour services rendus à la connaissance des expéditions polaires russes. Par curiosité, je l’ai accompagné à la cérémonie, qui avait lieu dans un sous-sol de la basilique du Christ-Sauveur, construite en trente ans par les tsars pour célébrer leur victoire sur Napoléon, démolie en trois mois par Staline et reconstruite en trois ans sous Eltsine, à l’identique. Nous nous retrouvons avec une soixantaine de futurs décorés, plus leurs familles et leurs amis, tout ce monde en robes et costumes du dimanche affreusement mal coupés, cravates s’élargissant et s’arrêtant au-dessus du nombril, couperose et cheveux brillantinés : l’Union soviétique dans toute sa splendeur. On nous installe avec beaucoup d’égards, nous pensons que l’affaire sera vite pliée, ensuite on va dîner, mais nous découvrons avec horreur sur le programme que cette fantasia chez les ploucs est prévue pour durer quatre heures. Impossible de fuir : le traquenard. Coincés pour coincés, nous nous préparons à prendre notre mal en patience en nous disant que ce genre de tribulation, et Manu et moi en avons vécu pas mal ensemble, cela scelle les amitiés. Longue attente, puis discours, musique, applaudissements nourris. Les récipiendaires se succèdent sur l’estrade, on salue leurs accomplissements, il y a des militaires, des professeurs, des bureaucrates, mais aussi bien des responsables de cantines et même des collégiens méritants. Tout cela entrelardé de petits ballets dansés par les enfants des écoles et de chansons sentimentales ou patriotiques interprétées par des artistes amateurs. Et là, cela vient doucement, sans crier gare. Je ricanais sous cape pour tromper l’ennui et je m’aperçois que je suis ému, de plus en plus ému. Car les petits ballets sont kitsch, bien sûr, mais parfaitement exécutés, avec un soin, une conviction, un amour dont nous n’avons en France plus la moindre idée. Car la grosse dame en robe longue ou le petit monsieur en costume étriqué qui se mettent à chanter une chanson chantent vraiment une chanson, avec tout leur cœur, exactement comme chantait Ania, mon amie assassinée à Kotelnitch, et la vérité, c’est que, comme Ania, ils chantent magnifiquement. Par contagion, même le petit discours de l’économe du réfectoire en arrive à me toucher profondément. En y repensant par la suite, je dirais qu’une des choses qui me touchent là-dedans, c’est l’absence d’humour. Nous vivons, en France, sous le règne de l’humour et du second degré obligatoires. Il n’est pas un échange qui n’y soit soumis. Un type qui reçoit une décoration mettra dans ses remerciements un peu de dérision, un petit ton Canal +, pour bien montrer qu’il n’est pas dupe. Ici, dans ce morceau d’URSS congelé et peut-être de Russie éternelle, ça n’existe tout simplement pas : même la joie, on la prend au sérieux. Surtout la joie. Mais bon, ça, c’est ce que je pense par la suite, sur le moment je ne pense rien du tout, je suis seulement ému aux larmes par cette sincérité, cette naïveté, cette application, jusqu’à cette laideur des costumes, cette rusticité bien intentionnée des manières, cette humanité chaude, enfantine, démunie, qui était le revers bouleversant de l’horreur soviétique. Quand je dis que je suis ému aux larmes, c’est littéral : au moment où la grosse dame en robe-serpillière qui chante à pleins poumons une ballade à la gloire de nos valeureux soldats fait lever toute la salle pour reprendre avec elle le refrain, non seulement je me lève et je chante comme les autres, mais je pleure carrément. Manu me surveille du coin de l’œil avec un amusement attendri. Ensuite, il y a un buffet, et moi qui ne bois plus depuis un an, je m’enfile vodka sur vodka, à la santé de quelques-uns des décorés qui trinquent avec nous de bon cœur.
Na zdarovié, na zdarovié.
Le lendemain, à un vernissage où se presse le tout-Moscou bobo, je rencontre Tania, mon éditrice. Je dis mon éditrice parce qu’elle a publié un livre de moi, en fait c’est surtout celle d’Anna Gavalda, qui est ici immensément populaire et avec qui elle est devenue très amie. Je suis un peu jaloux, à la fois de ce succès et de cette relation privilégiée avec Tania, pour qui j’ai toujours eu un faible, et ça ne s’arrange pas quand elle me dit que mon Roman russe, personnellement elle aime bien, mais c’est tout à fait invendable ici. Bref. Tania a le même âge que Macha, notre naissante héroïne de fiction. Elle est plus intello, moins friquée et moins attirée par le fric, elle n’a jamais dû mettre les pieds dans une des boîtes de Jean-Michel et si elle les y mettait elle serait certainement choquée. Mais elle est comme Macha d’une grande beauté, drôle, chaleureuse, et malgré ce qui les sépare elles pourraient tout à fait se connaître et s’entendre. Cette fille splendide, par ailleurs, vit seule avec son chat : c’est que sur le marché russe elle ne trouve pas d’homme à son niveau.
Je raconte à Tania ma soirée de la veille. J’essaie de lui expliquer ce qui m’a submergé au cours de cette soirée, cette vague d’amour pour ce pays, pour ces gens, cette espèce de retour d’acide qui fait qu’en plein cœur de Moscou je me suis cru téléporté à Kotelnitch, au banquet des parents d’élèves. Tania, cette Moscovite branchée, lectrice de Houellebecq, copine de Gavalda, m’écoute en souriant, j’ai l’impression qu’elle se moque un peu de moi mais c’est une impression qu’elle donne souvent. Pour finir, sans cesser de sourire, elle me dit : « Je comprends. Ce que tu as vu hier soir, c’est mon âme. »
Je crois que c’est cela, le sujet du film. Ces femmes qui ont aujourd’hui la trentaine et pas mal d’heures de vol derrière elles, qui dans le gigantesque chamboulement de l’après-communisme ont su par leur talent, leur beauté, leur énergie, se faire une place du bon côté de la société, ces femmes si elles sont un peu sensibles gardent forcément un pied dans le mauvais : le côté des perdants, des englués, des pauvres cons du parti défunt et de l’éternelle gloubinka – qui sont souvent leurs parents. Et quand je dis un pied, je suis timoré, c’est Tania qui a raison : il s’agit de leur âme.


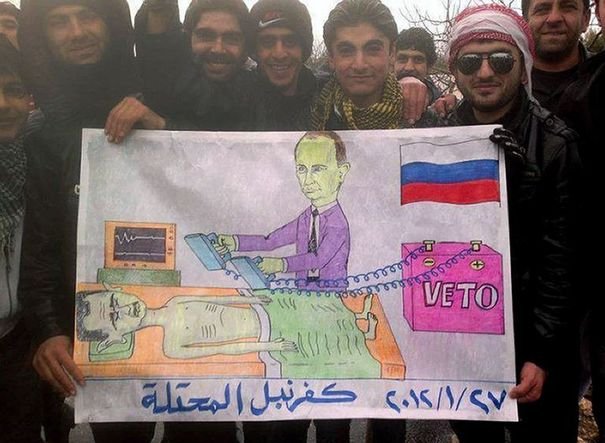





Intéressant, quelle est l’opinion des russes par rapport à ce fléau?
Une histoire est une histoire et ne fait pas un film ce serait trop simple et sans intérêt. Il y a tout le reste contenu dans tous ces chefs d’oeuvre depuis le cinéma muet jusqu’à nos jours. C’est pour cela que le cinéma est un art. Alors à vos caméra et voyons de quoi vous êtes capables….
Vous en aviez testé beaucoup de ces filles avant d’en parler avec autant de certitude?Et pourquoi cette attirance pour les « bleds pourris » comme Kotelnich? Les filles de coins pommés français sont moins jolies?;)
Emmanuel, je vous ai découvert avec un dvd, celui sur Kotelnitch. J’ai depuis lu certains de vos livres parlant de votre rapport à la Russie. J’avais lu les livres de votre mère et si l’histoire de la Russie ne me passionne pas j’éprouve un intérêt certain à essayer de mieux comprendre l’âme Russe dont ils sont si fiers. Votre projet est passionnant mais il me semble qu’il passe à coté de ce qui justement vous a ému. J’ai partagé ces moments ou pris par l’émotion on entrevoit la force de ce peuple, cette âme russe. Je connais bien ces filles (et maintenant ces hommes car de plus en plus de jeune hommes Russe des villes moyennes, cherche une femme mûre et riche) pour qui le seul avenir qui vaille la peine d’être vécu est la sécurité matériel, la garanti d’un avenir. Ces jeunes filles pour qui la priorité est de trouver non plus un oligarque mais un homme suffisamment riche pour offrir une voiture, un appartement et suffisamment d’argent de poche pour qu’elles n’aient pas l’envie de trouver un autre homme. Il me semble que votre projet est trop élitiste, trop éloigné de la réalité Russe. En fait ce confort matériel est un leurre, combien de jeunes filles russes partent pour Moscou pour finalement vire à 5 dans un appartement de deux pièces ? Elles ont toute une amie qui à réussi. Mais quand on demande des détails, c’est finalement l’amie d’une amie. J’ai peur que votre projet participe à ce mythe. L’happy end c’est finalement le retour à l’âme russe, ce mariage avec un homme Russe qui vit la réalité Russe dans sa dureté quotidienne et qui partagera ce qui est non dit, ce qui ne ce voit pas. Cela me fait penser à un vol Paris Moscou, votre mère était à bord. Je n’ai pas osé la déranger. J’ai pensé « comme c’est émouvant, cette personne connait mieux la Russie que la plupart des Russes mais aucun passager Russe de l’avion ne la connait. ». Arrivé à Moscou, c’est le désordre habituel. La délégation qui doit accueillir votre mère n’est pas là et elle se retrouve en compagnie je suppose d’un officiel français dans la file d’attente interminable du contrôle des passeports. Je lui ai alors dit de passer devant tout le monde et de se présenter devant le guichet comme tout Russe de moyenne importance aurait fait. Embarrassée votre mère m’a écouté pour finalement passer rapidement le contrôle. Personne ne c’est ému, c’est normal pour les Russes, si quelqu’un vous passe devant c’est qu’il en a le droit. C’est là le défaut de votre projet, votre vision élitiste de la situation de ces jeunes filles ne résiste pas à la réalité de la Russie.
Admirant vos livres, connaissant la Moscou d’avant, celle de la période 1977 – 1995, j’ai été scotché par le texte si-dessus qui ferait un fabuleux roman ou film.
Vivant à Tbilissi, dont vous êtres finalement originaire, j’en ai vu passablement de ces histoires, plus rudes mais fascinantes.
Bien plus que l’Europe occidentale, l’espace post-soviétique est un fabuleux réservoir de récits.