J’aimerais ouvrir une brèche : celle d’un dialogue, insuffisamment étudié, entre Péguy et Heidegger. Deux penseurs, deux poètes, plutôt que deux philosophes. Péguy est né en 1873, Heidegger en 1889 – seize ans les séparent. Péguy est mort en 1914, Heidegger en 1976. Si Péguy était mort à l’âge de Heidegger, il serait mort en 1960 ; cela donne une idée vertigineuse de la perte monumentale, pour la littérature et pour la pensée, que représente sa mort précoce au combat.
Ce qui d’abord rapproche Heidegger et Péguy est que ce sont des êtres de la parole. « La parole, dit Heidegger, soulève plus de terre que le fossoyeur ne le peut. » Péguy et Heidegger nous parlent. Ce ne sont pas des penseurs de la conclusion, mais du suspens. Ils cheminent. Ils sont là pour réveiller, avec des erreurs, avec des errements, avec des errances, les questions enfouies sous le cliché, sous l’habitude ou sous l’évidence – pour Heidegger, il s’agit notamment de ne plus considérer, comme ce fut le cas pendant des millénaires, que l’Être et l’étant se confondent. Ce sont des penseurs qui posent des questions plus qu’ils n’apportent des réponses.
C’est pourquoi leurs œuvres respectives récusent totalement, en elles-mêmes, le mot d’œuvre. Les « œuvres complètes » de Heidegger, outre qu’elles aiment à se contredire perpétuellement, sont un perpétuel inachèvement, un obsessionnel recommencement – et le plus souvent, ces « œuvres » sont des cours : elles s’inscrivent, même écrites, dans une oralité. Ce qui est également le cas de Péguy, qui n’écrit pas tant qu’il parle au lecteur. Péguy et Heidegger sont à côté de nous, nous sommes pour eux des interlocuteurs. Péguy, cela surprend souvent les lecteurs qui veulent le rejoindre, n’a pas écrit de livre : il a publié tous ses textes, y compris ses poésies, au sein des Cahiers de la Quinzaine – il est très important de le souligner. Péguy et Heidegger s’adressent à. Ils provoquent, mais au sens latin du terme : ils attendent de nous une abolition immédiate de l’assoupissement. Ils nous réveillent. Ils veulent, par la parole, nous arracher à ce qui est susceptible de continuer à nous voiler les choses et la vérité des choses.
« Jamais de plan », lance Péguy. Car Péguy, à sa manière, plus polémique, plus buissonnière, nous donne aussi des leçons ; il donne un cours, un cours libre, qui veut poser les plus éculées questions de manière inédite. Il ne nous dit rien d’autre quand il entend nous faire relire Homère comme s’il venait, je cite de mémoire, de sortir en librairie. Il ne nous dit rien d’autre lorsque, au non de la transmission de la parole, il nous demande de nous méfier de ces classiques qui, abîmés par des siècles de glose, ont couché avec tout le monde et ont été vidés de leur sève. La parole est dans les grands textes ; ces grands textes sont fragiles car susceptibles d’être détruits par les interprétations, les professeurs, les mauvais lecteurs. Or, abîmer la parole, c’est détruire irrémédiablement la source. Avoir accès à la parole, entendre la parole (afin de la transmettre), c’est donc d’abord et avant tout savoir lire.
« L’homme, dit Pascal, écrit Péguy dans Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle (Pléiade), l’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l’ange fait la bête. Il faut entendre cette pensée, il faut lire ce texte, comme tous les grands textes, dans son mot à mot même, dans sa plus grande, dans sa plus extrême littéralité. Dans sa littéralité la plus pure. Il faut se garder surtout, il faut se garder comme du feu d’entendre un texte, un grand texte, de le lire dans des sens de littérature, dans des sens littéraires, d’élégance littéraire, dans des sens de tropes et de métaphores ; s’il y en avait un, c’est lui, qui se gardait du malin et du langage figuré. Il faut donc prendre, il faut donc lire un texte dans toute sa pureté, dans toute sa littéralité. » C’est ce que Heidegger, par ailleurs, a fait avec les Grecs. Il a pris la pensée grecque au mot.
L’évidence, dans la proximité de Péguy avec Heidegger, serait d’immédiatement relever leur résonance particulière dans la pensée de la technique ; comment la nature, puis l’esprit humain, par une aberrante allégeance à la technologie, ont oublié l’Être et se sont dissous dans une existence qui n’existe pas. Mais j’ai préféré entreprendre leur voisinage par la question de l’histoire, centrale chez les deux penseurs, chez les deux poètes, et qui présente l’intérêt de poser le problème de la parole et de la transmission de cette parole, qu’on peut également appeler la mémoire.
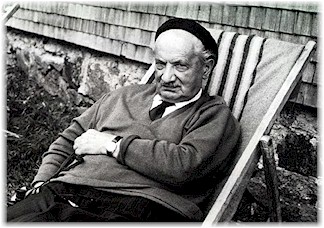
Heidegger nous dit que le mot donne l’être – dans Acheminement vers la parole (Gallimard, 1976) : « Alors, du mot, la pensée l’équilibrant en toute rigueur, il ne serait plus jamais permis de dire : il est – mais au contraire : il donne (es gibt) ; et cela non pas au sens où ‘‘il y a’’ des mots, mais où le mot même donne (Das Wort selber gibt). Le mot : ce qui donne. Donne quoi ? Suivant l’expérience poétique et suivant la plus ancienne tradition de la pensée, le mot donne : l’être. » Péguy, en écho : « avant le commencement sera le verbe ». C’est cela qu’il s’agit d’interroger – « cela » : la parole. Dans le poème, la parole donne toujours l’Être.
La parole, c’est ce qui se transmet ; c’est le contraire de ce qui fait bloc, le contraire de ce qui fait obstacle. La parole est ce par quoi la vérité se transmet au lecteur qui, chez Péguy comme chez Heidegger, est un lecteur qui écoute, un lecteur auditeur. Péguy et Heidegger, par la question, par le questionnement, veulent inlassablement, comme dit Levinas, « remonter à la source même, vers la pensée qui pense la vérité ».
« À la source même » : aux fins de retrouver l’étonnement premier, du temps où le mot donnait immédiatement l’Être, du temps où le mot et l’être étaient encore dans un rapport d’enfantement. « Le vieil Hugo, écrit Péguy en juin 1912 dans Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle (ibid.), voyait le monde comme s’il venait d’être fait. J’entends comme si dedans et ensemble lui Hugo, fragment, fraction du monde, (le plus important), venait d’être fait. C’est naturellement la seule manière de le voir. […] Toute la force de son génie, qu’il voyait le monde non pas comme nous, surtout non pas comme moi l’histoire, non pas comme un objet connu, habitué, non pas comme un objet habitué de regard habitué, mais comme premier, lui(-même premier), comme l’objet premier d’un regard premier, comme un objet tout vert, comme l’objet tout nouveau et neuf et tout vert d’un regard tout nouveau et vert, d’un regard tout neuf. Il voyait le monde comme s’il venait enfin de venir au monde. »
Comprendre, nous dit ici Péguy : non pas seulement comme si Victor Hugo venait de venir au monde, mais comme si le monde venait de venir au monde. On voit donc qu’ici, l’histoire est ici associée à l’habitude, à la sclérose, quand la parole du poète est mode de rafraîchissement total, mode de connexion avec l’étonnement premier, avec le Verbe originel de l’originel monde. La parole restitue ce monde ; mieux : elle le re-présente à nous ; l’histoire, elle, n’est qu’accumulation de connaissances volumineuses et jaunies. C’est, nous dit Heidegger, Geschichte contre Historie. Historie, c’est l’histoire comme science, avec les méthodes que cela implique. Geschichte, c’est l’histoire au sens large, celle qui concerne l’existence humaine en tant qu’elle est le principal événement qui fait l’histoire. C’est ce qui a lieu. C’est ce qui advient. Or, si le discours de l’historien est là pour traiter le passé en scientifique, c’est à la parole de dire l’existence humaine. La littérature est une possibilité de cette parole. Geschichte vient de Geschehen : comme le traduit François Vezin, une « aventure », l’aventure du Dasein. L’histoire, ainsi définie, n’est pas la science historique, mais interroge la « structure aventuriale », elle pense ce mode de « l’advenir ». Elle est concernée, non par les dates et les événements, les sacres des rois, les révolutions, mais par les « conditions de possibilité temporelles existentiales », dit Heidegger. Autrement dit : il s’agit d’ « acquérir une entente ontologique de l’historialité [Geschichtlichkeit] » (Être et temps, Gallimard, 1986). L’histoire comme Geschichte n’est plus l’histoire telle qu’on l’enseigne, celle des historiens ; elle se penche sur l’historialité du Dasein, c’est-à-dire sur le fait que le Dasein est temporel et que c’est la raison pour laquelle il est historial – non pas seulement temporel au sens où il est assis, où il est posé dans le temps comme une pierre posée sur une date du calendrier (ce qu’il est, de toute façon), mais temporel au sens où il est lui-même le lieu, lui le Dasein, d’une « temporellité » originelle. « L’histoire, qui a lieu dans le temps, dit Heidegger (ibid.), est l’aventure spécifique du Dasein existant, de sorte que cette aventure qui s’est ‘‘passée’’ et qui s’est, en même temps, ‘‘transmise’’ [le mot est lâché] et qui se poursuit toujours dans l’être-en-compagnie, prend, au sens fort du mot, le nom d’histoire. » Et Heidegger, dans une manière de révolution copernicienne de la temporalité, se pose donc la question suivante (ibid.) : « Le Dasein ne devient-il historial qu’en s’impliquant dans les circonstances et les événements ? Ou bien l’être du Dasein est-il avant tout constitué par l’aventure de telle manière que c’est seulement parce que le Dasein est, en son être, historial que quelque chose comme des circonstances, des événements et des destinées sont ontologiquement possibles ? »

Or la Clio de Péguy souffre précisément, elle qui se comprend elle-même comme Geschichte, d’être appréhendée par les historiens (par les modernes), comme Historie. « Je suis bien forcé de tout savoir, se lamente Clio, c’est mon métier. Ce n’est pas gai. » (Clio, Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne). C’est devenu son métier, mais ce n’était pas, nous répète-t-elle via Péguy, sa vocation, sa nature. « L’historique, tout l’historique, défini comme historique, est véreux, poursuit Clio (ibid.), […] l’événement est véreux. » Et pour bien distinguer, à son tour, Geschichte d’Historie, Péguy, ventriloque de Clio, lance (ibid.) : « Des millions d’hommes inexplorés sont morts. » La réalité de l’aventure humaine est oubliée par les historiens au profit d’une science chrono-logique. « L’idée du mouvement logique, si je puis dire, mitraille Péguy (ibid.), son orgueil total et son orgueil échelonné, son orgueil d’escalier et son orgueil d’échelle, c’est qu’à chaque fois sachant plus, à chaque fois ainsi il sait mieux. Jamais le mouvement logique ne s’est montré plus indigent. »
L’idée de Heidegger d’une historialité du Dasein, d’un Dasein qui possède sa propre « temporellité », existe chez Péguy, et cette temporellité, chez lui, n’est pas non plus la même que celle de l’histoire : « Ces malheureux supposent, mon ami, leur système suppose que le temps serait uniquement un temps pur, un temps géométrique, un temps spatial, une ligne absolue, infinie (au moins par sa terminaison, si je puis dire, sinon par son origine), un temps imaginaire, arbitraire, imité de l’espace, fait comme un espace, fait à l’image et à la ressemblance de l’espace, un temps fait, factice, arbitraire, trop bien fait, une pure ligne pure, parfaitement continue, parfaitement homogène, au long de laquelle, comme au long d’un espalier temporellement infini, un progrès perpétuellement croissant s’inscrirait en une courbe perpétuellement montante. Je ne veux point me donner le ridicule, mon ami, de refaire l’Essai sur les données immédiates [c’est là que Péguy, en quelque sorte, injecte la temporellité du Dasein], ni de le retrouver, ni de le découvrir. Ni Matière et mémoire. [Une façon, d’ailleurs, de faire dialoguer Péguy et Heidegger est de passer par Bergson, qu’ils ont tous deux étudié de près ; Péguy assistait régulièrement aux cours de Bergson au Collège de France.] […] Le temps homogène et le temps spatial nous le connaissons […] : c’est très précisément le temps de la caisse d’épargne et des grands établissements de crédit. » L’histoire des historiens, pour Péguy, est capitalisation ; cette capitalisation est contraire à toute possibilité de transmission. Rien ne se transmet plus difficilement, disait Malraux, qu’un héritage. L’héritage est même par nature ce qui ne peut pas se transmettre.
D’où le choix de Péguy pour la poésie – pour la littérature ; la littérature au sens où l’entend Bataille. Pour Bataille, la littérature n’est pas une « entrée en soi », comme on l’entend souvent (de la bouche même des écrivains), mais (bien au contraire) la plus extrême, la plus brutale, la plus excessive des sorties de soi, le ek de ek-sistence poussé à son paroxysme). « La poésie et l’art, écrit André Breton dans Arcane 17 (écrit en 1944 et publié à New York en 1945), garderont toujours un faible pour tout ce qui transfigure l’homme dans cette sommation désespérée, irréductible que de loin en loin il prend la chance dérisoire de faire à la vie. […] Là aussi le temps presse : il s’agit de faire rendre à la sensibilité humaine tout ce qu’elle peut donner. » « À cette époque, écrit Sartre dans L’Idiot de la famille, Flaubert est catégorique : la poésie est une aventure silencieuse de l’âme, un événement vécu qui est sans commune mesure avec le langage [je souligne]. » La littérature a plus à voir avec l’ek-sistence qu’avec le langage. Sartre (ibid.) : « [Flaubert] déclare que, par cette redescente nécessaire vers l’expression verbale, le poète s’abaisse, abaisse la poésie. » Plus loin (ibid.) : « Ce qu’il faut comprendre, ici, c’est que [le jeune Gustave] fait usage des mots mais qu’il ne parle pas » ; seule la littérature parle ; seule la poésie parle : seule la parole parle. Seul le silence, quand il est parole, parle.
Les Juifs connaissent bien la parole, car cette parole, ils l’ont écrite ! On sait qu’il y a dans le judaïsme la Torah écrite et la Torah orale, la loi écrite et la loi orale – il faudrait en réalité parler de « Torah orale écrite » et de « Torah orale orale ». La parole pourrait recevoir de nous cette définition : oralité orale ou bien oralité écrite. Levinas dit encore : « La vérité du monde des écrits est elle-même accrochée à la vérité de la parole et s’y transcende en quelque manière.»
Par parole, autrement dit, nous entendons ce qui est hostile à toute forme de rétention. Et c’est là, justement, que Péguy rencontre Heidegger : l’histoire est rétention, la mémoire est fluidité, autrement dit : transmission. Il ne s’agit donc pas, pour Clio, d’avoir un passé, ce qui serait synonyme de lourdeur, mais d’être son passé – et d’être présentement son propre passé. Non pas se confondre avec lui, mais être une part de lui ; non pas « avoir été » mais « être été ». L’histoire est ce qui a un passé (ou qui nous fait avoir un passé) ; la mémoire est ce qui est un passé (ou qui nous fait être un passé).
Il y a une différence entre le passé (en allemand : das Vergangene) au sens de révolu, d’irréversible, d’irrévocable, et donc de livrable à l’histoire, de comestible pour l’histoire, et le passé qui est en nous, au sens où nous sommes quelque chose qui se continue sans cesse (en allemand : das Gewesene) – quelque chose qui fut, mais est actualisé à la seconde où je vous parle : quelque chose qui fut mais n’a pas cessé d’être, ne cesse pas d’être, et ne cessera pas. Il y a là une substitution de l’être à l’avoir au sujet du passé : « avoir un passé » devient « être son passé ». C’est ce que Heidegger appelle le « changement de temporellité ». Mon passé, autrement dit (et avec jeu de mot), est présent en moi. Il n’en aura jamais fini en moi.
Souvenons-nous de cette phrase de Faulkner : « The past is never dead. It’s not even past. » (« Le passé n’est jamais mort, il n’est même pas passé. ») Et souvenons-nous aussi de cette extraordinaire phrase de Rosenzweig, au sujet de la parole : « La parole débusque même dans le passé le fragment de devenir, le fragment de pas-encore qu’il contient. »
Le passé n’a pas tout dit ; le passé n’a pas tout révélé ; il ne s’est pas encore totalement révélé en moi. Pour cela, il a besoin du présent, de mon présent. En allemand, on ne dit pas : « J’ai 20 ans » mais « je suis 20 ans » (« Ich bin 20 Jahre ») ; de même en anglais (« I am 20 »).

Les kabbalistes (Juifs) décrivent souvent les sefirot comme les différents degrés de la révélation de Dieu dans l’émanation et la création, c’est-à-dire du néant divin (aïn) jusqu’à la présence de Dieu (shekhinah), lieu de la figure personnelle de la divinité. Dans le monde dit de « l’émanation », les mêmes kabbalistes ont défini ce qu’ils nomment la « couronne suprême » (keter eliyon), encore appelée la « volonté primordiale » ou, je viens de le dire, le néant. Ce keter eliyon représente la source de toute volonté, la volonté pure au sein de l’Être, qui, comme dirait Heidegger, pousse l’être àek-sister, à se propulser hors de soi. On l’appelle aussi ehyeh (« je serai »), être étant entendu comme : à-venir. Dans le célèbre ehyeh asher ehyeh (Exode, 3, 14), la traduction qu’on rencontre parfois, à savoir : « je suis ce que je suis », n’est pas bonne. Il faudrait traduire : « je suis : je serai ». (Encore que… Le mieux serait sans doute de comprendre que la langue hébraïque n’est pas faite pour les modalités de la conjugaison, qu’elle invente un présent qui dure, un passé qui ne meurt jamais. La meilleure traduction de cette phrase est peut-être « le passé ne meurt jamais » ! Ehyeh asher ehyeh est sans doute la meilleure formulation qui soit de la mémoire et de sa transmission.) C’est, autrement dit, l’ouverture à la transcendance, c’est là que l’on reçoit la lumière, c’est le lieu de l’homme comme projet. C’est le lieu de « l’ici et maintenant » où le maintenant, comme le dit Husserl, est une « multitude d’intentionnalités ». Il s’agit d’assumer l’instant sans le parasiter – dans le monde de l’émanation, le présent n’est pas une coupure avec le passé et l’avenir ; mais en aucun cas le passé ne doit venir l’alourdir. En hébreu, d’ailleurs, présent se dit réga[« réga », en hébreu, c’est l’instant, voire le moment], de la même racine que ragoua : tranquille, paisible.
Pour Rabbi Nahman de Braslav (1772-1810), keter signifie « être prêt à être » dans l’instant, dans le maintenant. Cela pose donc la question d’une présence du passé dans le maintenant, contre l’idée d’un encombrant fardeau de dates, de connaissances, d’archives. Heidegger et Péguy, chacun à leur manière, entendent faire apparaître – et c’est ce qui concerne le keter – l’être dans sa temporellité (Temporalität) et non pas dans sa temporalité (Zeitlichkeit) ; le passé, pour Heidegger comme pour Péguy, n’est pas tant à comprendre dans le temps, qu’à partir du temps, comme quelque chose de conditionné par le temps, traversé par le temps, travaillé par le temps, contaminé par le temps, relié au temps, connecté au temps.
La parole (le génie de la parole) a non seulement pour principe de s’asseoir sur la mémoire afin que la transmission du monde originel au monde moderne soit possible (bien que Heidegger et Péguy définissent le monde moderne comme celui d’une transmission défectueuse, puisque la parole est sans cesse mise à mal par la science), mais la parole a même pour devoir de s’opposer de toutes ses forces à l’histoire – de lui « désobéir », dit Péguy. « Je suis si puissante, mon ami, écrit Péguy dans Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle, qu’en un sens il suffit de me désobéir, un homme, une œuvre, un temps, et de manquer à cette loi universelle du vieillissement, pour que ce soit le génie même qui passe par l’échancrure de cette désobéissance. […] Je suis si grande que de me manquer de respect, d’être insolent avec moi, de me faire une injure, la plus grave, de me taire, de m’oublier, de me passer par prétérition, par profits et pertes, de feindre que je ne sois pas, c’est atteindre à la plus haute fortune, temporelle ; au génie ; c’est se conférer, par un coup d’État, la plus haute fortune temporelle, une fortune qui (dé)passe le temporel sans doute. »
Le génie de la parole est là, qui nous indique que le temps n’est plus un décor pour des événements, un réceptacle pour des sacres, des batailles, des épidémies, des conquêtes, des trahisons ou des amours, mais que le temps est ce qui anime les êtres ; et que les êtres sont, eux, les véritables lieux du temps. Le temps n’est plus un lieu pour l’être (temporalité), mais l’être est un lieu pour le temps (temporellité). Péguy et Heidegger opposent l’histoire, cet « avoir », cette capitalisation, cet amassement de passé, cette temporalité, à la mémoire, cet « être », cette temporellité. La temporellité, c’est l’avancée dans le présent ; c’est la projection vers le futur ; c’est aussi la possibilité de se retourner vers le passé : c’est un « hors de soi ». Le passé de la temporellité, nous dit Heidegger dans Être et temps, est un passé qui « ouvre la voie ».
La mémoire, comme il en va pour les ondes, permet non pas de restaurer le passé mais de le propager ; c’est-à-dire de le préserver, de le garder intact – non pas intact en exhaustivité, non pas intact dans les faits, les événements, non pas intact dans l’exactitude, mais dans les implications de ces faits, dans la digestion et la sensation des événements datés. La mémoire fait « quitter », fait « déloger » leur date à ces événements. La mémoire défactualise, déhistorise, déhistoricise, désévénementise. Elle pousse l’événement passé à être un peu plus que lui-même, à être davantage qu’un événement. Par la mémoire, l’événement devient quelque chose d’autre. Il mute. Il change de statut. Densifié par la symbolique qu’il a inspirée, suscitée, il devient quelque chose de supérieur à lui-même. Par la mémoire, le fait historique s’élève. Il n’est plus répertorié quelque part, en un point immuable et fixe sur l’échelle chronologique, mais se promène, se ballade sur l’axe du temps pour parvenir à toujours exister présentement. Il essaie toujours de nous joindre. Il est toujours joignable. Il est là. Détaché de sa date de naissance, transformé, transfiguré, schématisé, filtré, mais flambant neuf. Il n’a pas pris une ride. Il n’a pas vieilli : seul vieillit, comme la ruine qu’il aspire à être, le « passé historique ». Dans Clio, Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne, Péguy écrit (juillet 1913), donnant la parole à l’histoire, qui dit « je » : « Je suis une pauvre vieille femme sans éternité : moins que rien ; une loque ; un vieux chiffon de femme. Orgueilleuse, et creuse, de tant de passé, à ce que je dis, je suis donc sans (aucun) avenir. […] J’ai mis tout mon bien en viager. […] Moi, l’histoire, je trompe le temps. »
Une parenthèse importante : contrairement à ce que nous pourrions croire, la tradition n’est pas du côté de la mémoire. La tradition est un barrage à la transmission. « La tradition, écrit Heidegger dans Être et temps, en venant y exercer sa domination, rend d’abord et le plus souvent ce qu’elle ‘‘transmet’’ si peu accessible qu’elle l’occulte bien plutôt. Elle livre ce dont elle s’empare au ‘‘cela-va-de-soi’’ [thème récurrent chez Péguy] et barre l’accès aux ‘‘sources’’ originales [obsession chez Péguy, on vient de le voir à travers l’exemple de Victor Hugo] d’où les catégories et concepts traditionnels ont été tirés pour une part de manière légitime. La tradition va même jusqu’à faire entièrement perdre mémoire [je souligne] qu’ils ont eu une telle origine. Elle conforte dans l’absence de tout besoin d’y revenir au point qu’un tel retour ne s’entend même plus comme nécessaire. La tradition coupe l’historialité du Dasein de ses racines jusqu’à ce que celui-ci ne tourne plus son intérêt que vers des types, des courants et des points de vue possibles pour philosopher dont il va pêcher la variété et le pittoresque dans les cultures les plus éloignées et les plus étranges, cherchant à se cacher par là son manque de base. En conséquence, le Dasein, tout à son intérêt historique et à son ardeur pour ‘‘l’objectivité’’ d’une interprétation philologique, en vient à ne plus entendre les conditions les plus élémentaires qui seules rendent possible un retour positif au passé dans le sens d’une appropriation productive [je souligne] de celui-ci. » La tradition, pour Heidegger, c’est ce qui, tôt ou tard, en lieux communs[il manque un verbe] – ces mêmes lieux communs que dénonce Péguy dans ces[« ces » ou « ses » ?] dégagements sur l’habitude et les habitués.
L’histoire veut se souvenir de tout, quand la mémoire est une des modalités de l’oubli ; mais un oubli qui ne retiendrait que l’essentiel – cet essentiel qui doit être transmis. Lorsqu’on lit Péguy, il faut toutefois faire attention à la terminologie ; quand il condamne cette rétention, il emploie le mot de mémoire, mais il faut en réalité entendre histoire. La mémoire allège, quand l’histoire accumule. La mémoire sert à oublier. J’ai retrouvé une interview de Pierre Boulez, sur le site de l’Ina, dans laquelle il dit ceci : « La mémoire chez moi me préserve d’accumuler. On accumule beaucoup trop de connaissances. Et à mon avis, c’est le signe des civilisations qui meurent. »
« Une chose m’humilie, écrit Chateaubriand dans les Mémoires d’outre-tombe : la mémoire [au sens de surcharge, et donc d’histoire] est souvent la qualité de la sottise ; elle appartient généralement aux esprits lourds, qu’elle rend plus pesants par le bagage dont elle les surcharge [je souligne]. »
Écoutons maintenant Péguy (Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle), qui nous dit exactement la même chose : « Là est le secret, le principe, la force, l’économie, l’hygiène du génie ; cette singulière force de jeunesse : manquer de mémoire, n’avoir pas de mémoire ; ou plus exactement manquer de la mémoire, n’avoir pas la mémoire. » On voit bien, ici, que c’est le processus de souvenance, que c’est le trop plein d’hypermnésie qui est condamné – et donc l’histoire telle que nous l’avons définie – et que par conséquent Péguy est partisan de la mémoire comme oubli, contre l’histoire comme rétention exhaustive et maniaque, frein à toute transmission possible. « Ne traîner pas derrière soi, poursuit Péguy, cette lourde masse, ce train de chemin de fer, ce train de marchandises, traîné, déroulé derrière soi sur les rails comme un annelé, comme un gros annelé aux segments parallélépipèdes, comme un gros segmenté, comme un ruban annelé métallique et lourd fidèle et déroulé tout au long de la voie (ferrée), ferraillant aux aiguilles et qui fait badaboum aux plaques tournantes, ce lourd et ce trépidant arriéré ; cette charge, ce train des équipages, cet amas d’essieux, qui s’accrochent dans les roues, et les uns dans les autres, ce bagage qui embarrasse les armées, qui alourdit une manœuvre, qui conduit une campagne vers le désastre des retraites trop lourdes, rapidement changées en déroutes, sous leur propre poids, sous la poussée de la cavalerie ennemie, sous la pression de l’avant-garde ennemie ; ce convoi, ce train qui prépare, qui facilite, qui augmente, qui constitue le désastre ; ce charroi dont les roues s’accrochent dans la poussière, dans la poudre des routes, ensemble, créant des systèmes inextricables, qui ne peut tourner, dont les roues s’accrochent aux essieux, s’embranchent les unes dans les autres, créant le fouillis, inventant le désarroi, la complication, engorgeant, obstruant les vaisseaux [je souligne], comme une obstruction parlementaire [le discours est le contraire de la parole], un envasement parlementaire, bouchant la route [je souligne] aux troupes combattantes, aux vrais soldats, aux armées mêmes ; les fourgons, les célèbres fourgons, qui sont toujours les fourgons de l’étranger ; le génie, lui, est essentiellement une armée non lourde, une armée sans attirail et sans appareil, sans l’attirail d’une mémoire [d’une histoire, au sens de Historie], sans l’appareil d’un système, une troupe combattante qui n’est point embarrassée, empêtrée, entravée [je souligne], qui n’est point alourdie du charroi d’une mémoire. C’est une armée alerte, une troupe haut le pied, un arme au pied léger. »
Voilà qui est clair, et distingue ce qui se transmet et ce qui ne se transmet pas. Yoseph Hayim Yerushalmi, dans Zakhor, histoire juive et mémoire juive (Gallimard, 1991) rappelle, en écho avec ce que vient de nous décrire Péguy, que « ce dont les Juifs du Moyen Âge se ‘‘souvenaient’’ entretenait sinon aucun lien, du moins peu de rapports avec ce que nous entendons communément par ‘‘connaissance historique’’. Les Juifs, dit-il, qui à la synagogue portaient le deuil du Temple, connaissaient tous la date du mois de sa destruction, mais je doute que, pour la plupart, ils aient su ou voulu savoir l’année exacte où furent détruits le premier Temple ou le second, pour ne pas parler des manœuvres ou des armes qui furent employées. Ils savaient que le Temple avait été détruit par les Babyloniens, puis par les Romains : mais ni Babylone ni Rome n’avaient pour eux de réalité historique. Les souvenirs organisés par les lamentations d’une très grande poésie [je souligne] étaient élémentaires et émouvants, mais formulés [je souligne] selon des modes qui échappent à notre notion de ‘‘connaissance de l’histoire’’. »
Rosenzweig écrit : « En général, nous mélangeons sans cesse les grands événements de notre histoire, les trois délivrances des trois exils. Nos fêtes, par exemple, sont-elles des fêtes du souvenir ? Les fêtes ‘‘historiques’’, justement, non. Le jour du souvenir s’appelle justement la fête messianique. » Le temps messianique n’est pas le temps historique ; tous les hiers, tous les aujourd’huis, tous les demains ne se valent pas. Ceux de l’histoire ne sont pas ceux du Messie.
Le mot formule, employé par Yerushalmi, est très important. C’est précisément ce qui sépare la parole du discours. La parole est formulation. Je m’explique. Prenons une huître, par exemple. L’huître, la vraie huître, la chose huître (la vérité de l’huître) peut être occultée au sens où elle n’a pas encore été du tout dévoilée, comme dirait Heidegger. Un poète comme Francis Ponge ne prétend pas que l’huître n’a jamais été dévoilée : sans doute l’a-t-elle, il y a bien longtemps – elle a été usée, plutôt, ensevelie, « enfouie », pour parler comme Péguy. En terminologie heideggérienne, l’huître a « dévalé à nouveau dans l’occultation ». C’est pourquoi Ponge, quand il écrit un texte intitulé L’huître, tente de la désenfouir avec des formules qui la réveillent – il s’agit d’entendre « formule », ici, quasiment au sens d’une formule magique qui redonnerait la vie à un défunt, la chair à un squelette, à un fantôme, le visage à un spectre, le volume à un ectoplasme, une formule comme on en use pour faire jaillir un génie d’une bouteille dans les contes orientaux.
Il ne s’agit pas d’une formule mathématique, mais d’un assemblage de mots qui délivre quelque chose. Un assemblage de mots, c’est-à-dire des mots mis dans un certain ordre et seulement dans cet ordre.
« Comment une expression est-elle belle ?, s’interroge Francis Ponge dans Pour un Malherbe […] Quand elle peut être comprise comme une loi éthique et esthétique : une formule d’art poétique [je souligne]. »
Quelques pages plus tôt, il écrit (ibid.) :
« Pratique du langage :
Il s’agit moins pour nous de poésie que de Parole (prosaïsme résolu, mais d’une telle rigueur qu’en naît une nouvelle forme de poésie, l’oraculaire, l’art de la formulation [je souligne]. »
Saisir le sens de l’être, pour Péguy, mais aussi pour Ponge et pour Heidegger, passe par le sens de la formule. Formuler, c’est donner forme. C’est redonner forme, sa forme, ici, à l’huître devenue informe parce que trop habituelle, trop banalisée. La formule, surtout, est parole. Parole miraculeuse qui ouvre l’huître ou délivre le génie de la bouteille, parole accidentelle, ou exceptionnelle :
« Parfois très rare [je souligne] une formule perle »
Le génie qui apparaît semble bien être le génie de Ponge lui-même : « une formule perle » est une formule (et même une perle de formule). Ponge utilise jusque dans une formule le mot « formule ».
Le texte intitulé L’huître est lui-même la formule « complète » de l’huître. Les mots sont assemblés par Ponge, sur chaque ligne et dans chaque paragraphe, selon un ordre très précis, comme doivent être précisément agencés dans une formule magique les mots que l’on doit prononcer pour ouvrir le Sésame. Le danger, ici, c’est l’oubli – l’oubli de la formule ; formule oubliée, plus rien ne s’ouvre.
La terreur de Péguy est la même que la terreur de Ponge : l’oubli. Quand je dis que la mémoire est l’art d’oublier, je dois dire qu’elle est l’art d’oublier le superflu, le superfétatoire – ce qui entre dans le détail, ce qui alourdit et empêche la pensée. La mémoire est un filtre. Il ne s’agit pas d’abolir le passé, mais de le faire vivre sous forme de présent, de le présenter, de le « présentifier ». Et ce, en tant qu’il peut aider à comprendre le maintenant – sachant, ce qu’on oublie trop souvent, que la réciproque est également possible. Ainsi, Gershom Scholem, en pleine montée du nazisme, écrit à Walter Benjamin : « La catastrophe a certes pris une dimension historique universelle, qui nous permet désormais [je souligne] de comprendre 1492 [expulsion des Juifs d’Espagne]. » Tout, ici, repose évidemment sur le mot désormais. 1492 attendait, de présent en présent, son intelligibilité en 1933. 1492 était une date vivante, remplie, si l’on veut, d’une sorte d’énergie potentielle qui n’attendait qu’une chose : se transformer en énergie cinétique. 1492 n’était autrement dit pas isolée dans le passé, momifiée dans les siècles abstraits des manuels, mais là, en latence d’intelligence, en attente de lecture, prête à exploser comme une grenade, inentamée, fraîche, intacte et conservée, inédite encore. 1492, d’une certaine manière, n’avait pas terminé sa course, elle n’avait pas fini d’avoir lieu, ou plutôt elle n’avait que cela : avoir eu lieu, attendant son tour, attendant le jour où elle libérerait toutes ses radiations, où sa vérité enfin se dévoilerait. Il faut s’élever au-delà et par-dessus les lieux et la date de 1492 pour comprendre 1492. Il s’agit de parvenir à 1933 pour que 1492 se libère, livre son être, scintille dans sa lisibilité. 1492 a quitté la place fixe, figée, morte que « l’histoire scientifique des chroniqueurs », pour reprendre l’expression de Rosenzweig, lui avait attribuée, comme on accroche une toile dans un musée. Péguy, faisant parler l’histoire à la première personne, écrit (Dialogue de l’histoire et de l’âme charnelle) : « Je suis une pauvre femme. En somme je suis une pauvre femme. Tout ce que je puis faire, moi, vous le savez, c’est d’enregistrer quelques résultats. Quand ils sont bien acquis, bien figés, bien arrêtés, bien cadrés, bien enregistrés, bien encadrés, – bien morts. […] Moi, l’histoire, je sais beaucoup par cœur. Vous l’avez tant dit, avec tant de colère, qu’il faut bien que ce soit un peu vrai. Le fait est que moi l’histoire je ne saisis pas les mouvements. Oh non, non, pas les mouvements. Voyez-vous, moi l’histoire je ne suis pas bergsonienne. Il y en a assez de dames qui sont bergsoniennes. Je ne veux pas faire une dame bergsonienne de plus. […] Les mouvements ce n’est pas mon affaire. Non ce n’est pas mon genre. Ca n’entre pas dans mon genre de beauté. Et puis ça n’est pas mon métier. Vous ne l’avez que trop dit : moi je suis une dame de l’enregistrement. Il me faut un guichet, un petit guichet et des cadres. Je suis l’employée en chef des employées de l’enregistrement. La réalité, le mouvement, ce n’est pas mon office. La source, je ne bois pas à la source. »
1492, donc, comme la Joconde, était appelée à rester toujours dans la même pièce, au même endroit – immobile dans l’espace et dans le temps du passé. Rosenzweig, d’ailleurs, résume tout cela d’une manière fracassante et définitive (bien que nous soyons justement en train de nous méfier du définitif !) quand il se penche sur la notion d’histoire : « On demande, écrit-il dans L’écriture, le verbe et autres essais : [est-ce] dans le passé, dans le présent, dans l’avenir : était, est, sera, déjà ou encore [1933 était-il déjà dans 1492 ? 1492 est-il encore dans 1933 ?]. Ce déjà ou cet encore, ceplus ou ce pas encore, ce sont les grandes turbulences à l’horloge de l’histoire universelle. » Et il a un peu plus loin cette formule extraordinaire, que Péguy aurait largement pu faire sienne, et qui entre en résonance avec la lettre de Scholem à Benjamin : « La parole [cela a été traduit par langue, mais il faut bien sûr traduire par parole] débusque même dans le passé le fragment de devenir, le fragment de pas-encore qu’il contient. » Pour Rosenzweig, la mémoire permet au passé de se « mettre à jour » (au sens strict, avec jeu de mots !), d’exprimer le présent que ce passé contenait en germe. « Voici, ajoute-t-il, comment [la parole] nous fait vivre l’histoire : nous y étions. » Et, aussi : nous y serons. « Je suis : je serai ». Ehyeh asher ehyeh… Cette phrase est fondamentale. Que signifie-t-elle ? Elle signifie que l’histoire, qui a trait au discours (discours du témoin, discours scientifique de l’historien), nous rappelle sans cesse que nous n’étions pas là. Tandis que la mémoire, qui est véhiculée par la parole, nous invite sans cesse à être là. C’est précisément ce que Bataille appelle l’expérience intérieure – la communicabilité d’une expérience que la parole finit par nous faire vivre. Quand Jünger est soldat, il est dans la guerre en faisant son métier de soldat : être dans l’action ; il ne peut nous faire voir la guerre car il la fait, il est occupé à la faire. Tout au plus peut-il témoigner, c’est-à-dire nous exclure comme n’ayant pas été à sa place. Tandis que Jünger écrivain, par son lyrisme même, permet de dévoiler la vérité de la guerre ; la vérité de la guerre a attendu son heure, sa parole, et voilà qu’au lieu de discourir de la guerre, Jünger parle la guerre.
On pourrait s’amuser, ce que Péguy fait sans arrêt, à dénoncer ce qui freine la transmission, et à pointer ce qui au contraire la permet, la facilite. Parmi ce qui l’empêche, il y a donc l’histoire, mais il y a également le dessin, la métaphore, l’illustration, la représentation, l’icône (la parole juive a été inventée contre l’idolâtrie, ne jamais l’oublier – Exode : « le peuple voit les voix » ; c’est la parole qui donne à voir), et aussi la digression, le monument, la commémoration (qui n’est en réalité qu’une « historification »), le plagiat, l’hommage, le cliché, l’image d’Épinal, les détails, les précisions, la biographie, l’autobiographie, l’exactitude, la figure, les formules toutes faites, l’objectivité, la colère, le proverbe, le mensonge, la rhétorique, l’éloquence, les menaces, les injures, l’ironie, la haine (chez les Juifs, la haine gratuite est un péché aussi important que l’idolâtrie), la péroraison, l’indignation, la compassion, etc.
Et ce qui la facilite, cette transmission, à savoir : la mémoire, donc, la parole, le pastiche, le palimpseste, la sélectivité, l’esquisse, la vérité, la liturgie, le rite, le symbole, la prière, la circoncision, le vêtement, la codification, le paradigme, le schéma, la lecture publique, la confrontation, le commentaire, la subjectivité, l’humour, etc.

Je reviens brièvement à l’idolâtrie, dont Maïmonide, citant le Talmud, rappelle ceci : « Qui reconnaît l’idolâtrie est comme celui quirenie la Torah toute entière. » L’image, c’est ce qui fige. La figure, étymologiquement, c’est ce qui est figé. La mémoire a choisi la parole parce que la parole ne fige rien, ce qui n’est pas le cas de la formule toute faite (ceci dit, la définition du dictionnaire fige également, définir signifiant « ce qui fixe »). Comme Heidegger, comme Péguy, Maïmonide fait de la formule toute faite, du cliché, une image – et donc quelque chose qui a trait à l’idolâtrie. La parole est fluidité ; le cliché, au contraire, tient du solide. Le verbe clicher provient d’ailleurs de l’onomatopée « klitch », qui exprime le bruit de la matrice sur le métal en fusion. C’est un terme technique de typographie qui signifie « fabriquer l’empreinte d’une forme en y coulant un métal fusible permettant [c’est cela qui est important] d’obtenir une planche solide ». Là, effectivement, est le danger du cliché (danger que Péguy a parfaitement perçu) : le cliché solidifie ce qui était liquide. Le cliché empêche la transmission : il bloque tout mouvement, toute avancée, toute échappée. Le motcliché renvoie bien évidemment aussi à l’image : le mouvement de la vie, fluide, se trouve figé sur la photographie.
Dans son Épître sur la persécution (1162-1163), Maïmonide écrit : « Voici un homme […] qui a écrit ces nobles citations comme des formules toutes faites [je souligne] ; il n’a pas pris soin de les écrire au brouillon puis de les corriger, parce qu’il n’avait aucun doute à propos d’une question sur laquelle il n’était pas nécessaire de revenir ; et il transmis cette réponse à un homme qui l’a diffusée[je souligne] et il a obscurci avec ses paroles [je souligne] le cœur des hommes. » Puis Maïmonide cite les Psaumes (105, 28) : « Il répandit les ténèbres et fit régner l’obscurité. » Voyez encore les dégâts, chez Kafka, dans la Lettre au père, quand c’est un cliché de judaïsme qui se « transmet » – je mets évidemment des guillemets à « transmet ». Il en fallu, à Kafka, du temps (et des heures d’étude) pour pouvoir écrire un jour : « je suis une mémoire devenue vivante », toute la phrase reposant, ici, sur le « devenue ». « Point de transports, écrit Valéry dans Tel quel – ils transportent mal. » Voilà ce qu’il s’agit de dire des clichés.
Dans Clio, celle qui s’appelle l’histoire se plaint (je le répète) d’être traitée en Historie, elle qui se rêve Geschichte. Car Clio regrette (je le répète) que les historiens fassent de l’histoire cette science qu’elle est devenue. Elle regrette que le discours l’ait emporté sur la parole, et l’exactitude (cette obsession moderne), sur la vérité. « Je me livre à des travaux [dit Clio] (Clio, Dialogue de l’histoire et de l’âme païenne), à ces travaux ingrats qui me consument comme un sable altéré, je me consume dans ce désert sans fin. Je présente ainsi un spectacle lamentable, je fais un objet pitoyable, à voir, qui briserait le cœur le plus dur. […] J’aime beaucoup mes jeunes amis. Je les estime presque. Mais quand on leur donne des recherches à faire, quelquefois on ne les voit jamais revenir. Ils prennent au sérieux, au pied de la lettre, mes enseignements, mes célèbres méthodes. Pour moi je suis sotte, vous le dites, vous le savez, mais je ne suis tout de même pas aussi bête que vous me faites. Je sais très bien, parfaitement je sais que jamais on n’en sortirait. Aussi mes bons élèves, c’est pour cela que mes meilleurs élèves n’en sortent pas. Ceux-là je les méprise, beaucoup, et je les estime ensemble et autant. Je les méprise infiniment parce qu’ils me prennent au sérieux, les malheureux, et mes enseignements et mes méthodes, et que naturellement ils ne peuvent pas s’en tirer. Les sots. Nous savons bien que s’il fallait épuiser la LITTÉRATURE d’un homme et d’un sujet avant d’en écrire, avant d’en enseigner, avant d’en traiter, avant d’en faire un livre, un cours et conférences, une note même pour les Archiv et une imperceptible notule, avant d’en penser même, s’il fallait aussi et encore épuiser la réalité d’une question, hein, ça nous mènerait loin. Nul ne verrait jamais le bout de rien. Nul ne verrait la fin du commencement. N’est-ce pas, il faut se faire une raison. Quand je parle d’épuiser une question, tout le monde comprend bien qu’il ne s’agit pas de la réalité, de mon ennemie, de ma grande ennemie la réalité, tout le monde entend que je ne parle pas, que je ne pense pas à épuiser cette odieuse réalité. Cette odieuse femme. Cette femme éternelle. Parce que tout le monde est bien gentil avec moi. Qu’il ne s’agit que de perlustrer, d’arroser du regard, de parcourir un certain nombre, généralement énorme, de monuments. Du moment que c’est gros, pour moi c’estcomme si c’était complet. Un livre, un ouvrage, un travail énorme ne peut pas ne pas être épuisant. Il inspire une sorte de respect, et d’effroi, comme je le veux, non seulement qui me suffit, mais qui remplace avantageusement pour moi le respect de la réalité. La paix régnait, et tout le monde était content. Le contentement planait. Seulement il y a ces veaux, qui ne veulent rien savoir, ces jeunes veaux, vituli, nos jeunes amis, vitelli, nos jeunes camarades, qui font semblant de ne pas comprendre, des godelureaux enfin, des jouvenceaux, juvenci, des béjaunes, qui se mêlent de vouloir épuiserréellement la réalité. Alors on ne les voit jamais revenir. Vous comprenez. »








Il faut être un homme de grande culture pour être capable d’ajointer deux auteurs aux valeurs si fondamentalement inversées. Si les œuvres reflètent leurs auteurs alors Péguy, à l’instar de Hugo, est un grand homme soucieux du genre humain. Quant à Heidegger, fou d’amour pour Arendt tout en étant au ordre d’un système le plus abject de l’histoire : le national socialisme, aussi me semble-t-il difficile de le classer parmi les grands. A mon humble avis leur rencontre n’aurait pas tenu 5 mn sans qu’ils en arrivent aux injures et horions….