L’orphelinat de Loango, au Congo, accueille, comme partout, les enfants abandonnés. Le narrateur du formidable roman d’Alain Mabanckou, avant d’être surnommé « Petit Piment » parce qu’il a assaisonné de façon assez rude la pitance de deux frères qui sèment la terreur dans les dortoirs, porte le nom de Tokumisa Nzambe po Mose yamoyindo abotami namboka ya Bakoko. « Ce long patronyme signifie en lingala “Rendons grâce à Dieu, le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres”. » (p.11). C’est un prêtre qui l’a nommé ainsi, un prêtre bienveillant et attentif, qui sera balayé par la révolution socialiste.
Lorsque le régime change dans le pays, les orphelins de Loango sont soumis à l’endoctrinement. Petit Piment peut réciter par cœur les discours officiels, en soulignant les outrances langagières et les incohérences. Mabanckou fait de son petit personnage une voix de contre-pouvoir, sans autre pouvoir que celui de la dérision et de l’ironie. Le regard que Petit Piment porte sur le monde, ou tout au moins sur son monde, prend le parti de l’humour et de la critique. Cet humour-là n’est pas fait de distanciation, mais au contraire d’empathie généreuse. Son copain Bonaventure, par exemple, celui qui attend qu’un avion vienne l’arracher à sa piètre condition, Petit Piment le prend sous son aile, allant jusqu’à s’allier, pour cela, avec les caïds du dortoir.
Les personnages d’orphelins hantent la littérature mondiale, et leurs trajectoires suivent des flèches différenciées, de la mouise la plus terrible aux victoires les plus éclatantes. Leurs parcours sont en général des échappatoires au déterminisme, et mettent en évidence des constats sociétaux, pour les détourner. L’enfance de Petit Piment est placée sous le double signe du malheur personnel et de la politique locale, mais tout se joue sur le ton de la picaresque et de l’alacrité fragile. L’auteur porte sur ses personnages, et singulièrement sur son narrateur, un regard tendre. Les pensionnaires de l’orphelinat ne se posent jamais en victimes, une vie bouillonnante les anime, des envies, des rêves, des certitudes invérifiables.
L’écriture d’Alain Mabanckou a des allures de français très classique, sous lesquelles se dévoile un monde africain à la fois précis et universel. Mabanckou manie une langue magnifique, aux phrases balancées, aux virgules canoniquement placées, au rythme impeccable. Un exemple : « Niangui ne revint pas me donner un verre d’eau et de l’aspirine le lendemain. Quelque chose me disait qu’elle ne reviendrait plus, que si elle m’avait parlé avec autant de détails sur son existence, c’était peut-être parce qu’elle savait qu’elle ne me reverrait plus et que pour elle, comme elle disait, une page de l’orphelinat avait été arrachée avec pour premier signe l’humiliation faite à Papa Moupelo. » (p. 110). Niangui est l’infirmière et Papa Moupelo le prêtre de l’orphelinat. Tous deux balayés par la révolution socialiste. Les moments d’émotion, dans le roman, sont à percevoir et identifier en creux, jamais étalés, toujours retenus. La langue du roman, en plus du langage socialiste normé et raillé, évoque les dizaines de langues du Congo (p. 94). Et les ethnies, du nord ou du sud. Et leur hiérarchie. Tout est évoqué mais non souligné, pour ne pas perturber la lecture, pour que le texte avance comme avance Petit Piment. Le lecteur non averti des spécificités congolaises n’est en rien perdu dans la narration. Mabanckou parsème son récit d’incises évocatrices : « J’étais le lien entre ces religieux et les pensionnaires lorsque ces derniers ne pouvaient s’exprimer que dans certaines langues de nos régions que je maîtrise encore à ce jour » (p. 93) ; ou encore : « Après deux mois pendant lesquels la jeune maman ne voyait pas comment s’en sortir seule avec Bonaventure, une de ses cousines lui parla du “Bembé” qui dirigeait l’orphelinat de Loango et qu’il suffisait qu’elle s’exprime en bembé, une langue qu’elle parlait bien même si elle était dondo, pour que le directeur donne suite à sa demande » (p. 71). Alain Mabanckou ancre l’histoire de Petit Piment dans une réalité sociologique et ethnolinguistique très précise, sans que jamais le lecteur perde pied. Au contraire. Ces strates de compréhension s’agencent et vont de soi, sans heurt. Petit Piment, au-delà de l’itinéraire picaresque d’un orphelin, décrit aussi la réalité d’un pays, de ses fondements et de sa courbe politique. Sans que jamais cela passe par la didactique ou le discours appuyé. C’est l’attachement du lecteur au personnage narrateur qui permet d’entrer dans une réalité sociale, économique et politique. La preuve, s’il en était besoin, du talent d’Alain Mabanckou.
L’itinéraire de Moïse-Petit Piment suit aussi la trajectoire des femmes : de Niangui, l’infirmière de l’orphelinat, aux protégées de Maman Fiat 500, la maquerelle. Et l’orphelin grandit. Devient homme. Puis devient fou. D’une folie peut-être salutaire. Entre lucidité et naïveté, la destinée de Petit Piment n’a rien d’un destin tracé au cordeau.
Avec Petit Piment, Alain Mabanckou rend « hommage aux errants de la Côte sauvage » (exergue). Mais il rend également hommage à tous les enfants mal partis, chaotiquement balancés dans des mondes où l’hostilité le dispute à l’incompréhension, où la seule façon de s’en sortir et de tenir debout est de faire face différemment. Petit Piment y laisse une bonne part de sa raison, mais pas forcément la plus belle. La belle part de sa raison reste fidèle à ses attachements d’enfance. Le copain Bonaventure, entre autres, au nom si évocateur. Petit Piment est un roman d’une conscience très contemporaine, nourri de classicisme, de picaresque et de Dickens, signé par un des plus beaux auteurs francophones.


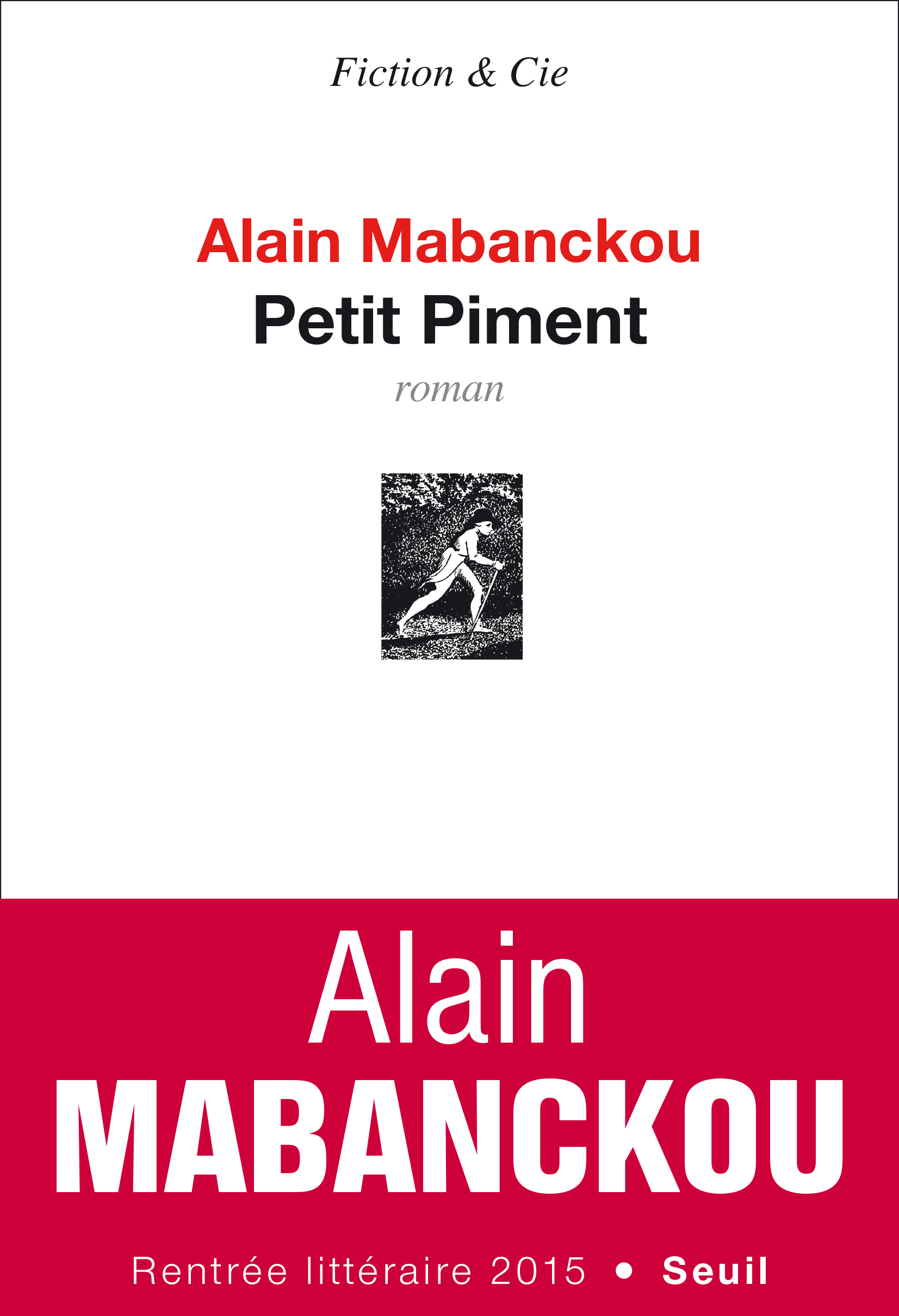






Mabanckou est l’un des plus solides défenseurs de la francophonie à l’étranger. C’est un grand écrivain et un grand homme.
Alain Mabanckou est un formidable conteur qui sait faire voyager ses lecteurs. Ce roman a l’air d’être à nouveau une réussite. J’ai hâte de m’y attaquer.