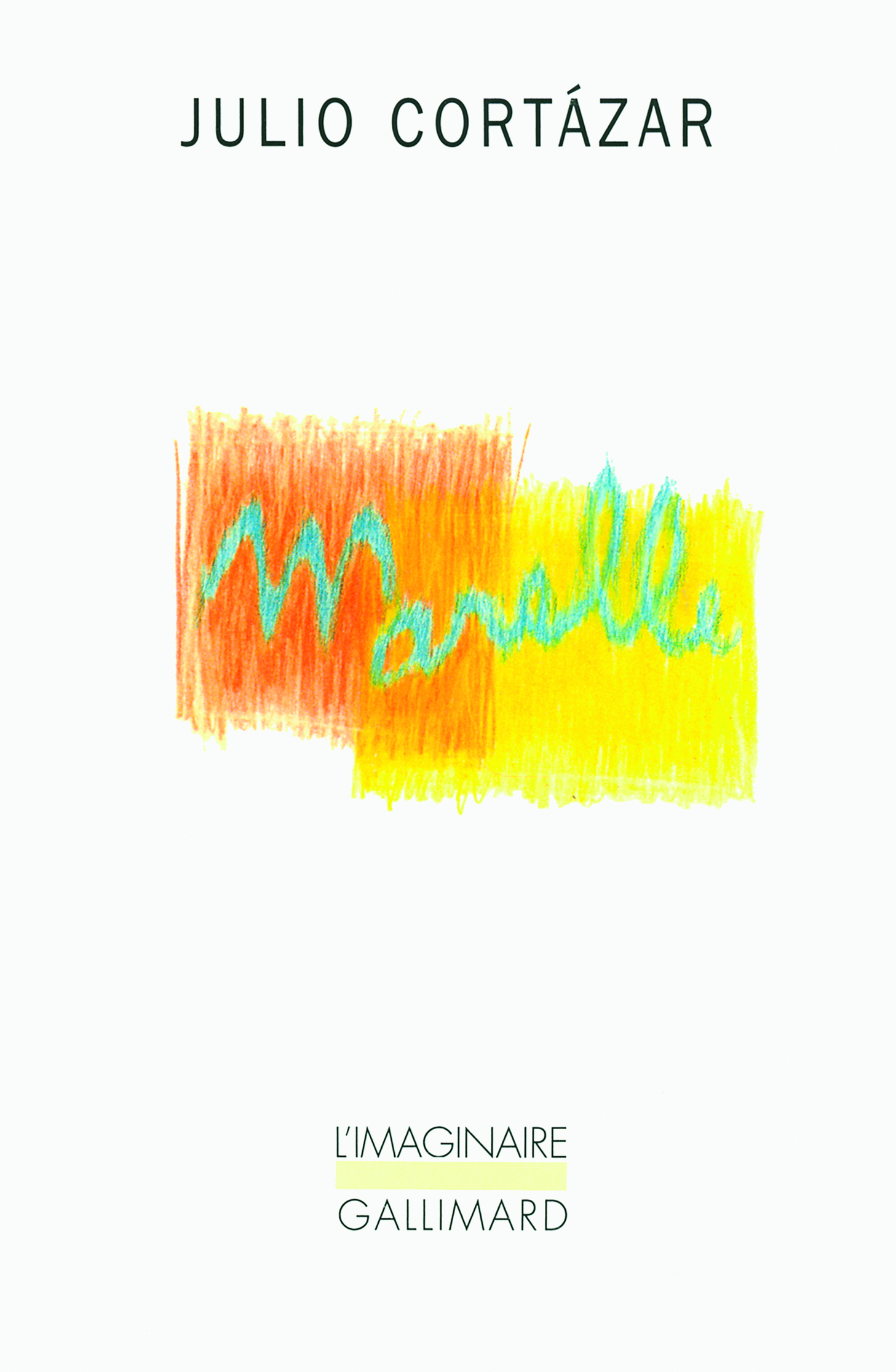Il y a cinquante ans, éclate le « boom latino-américain ». Pleines d’audace, remplies de poésie, d’humour, de grâce et d’élégance, ces œuvres expriment une maturation littéraire surprenante. Mouvement intemporel, le « réalisme magique » prend son essence autour d’auteurs tels que le colombien Gabriel Garcia Marquez – prix Nobel de littérature 1982 – ou le péruvien Mario Vargas Llosa – primé en 2010 – et tant d’autres au centre desquels figure l’œuvre de l’argentin Julio Cortázar et dont l’Argentine fête cette année le centenaire de sa naissance. En 1963, la parution de son roman novateur Marelle (Rayuela) créé l’effet d’une bombe. Ce mélange expérimental et complexe d’éléments surnaturels et irrationnels dans un décor réaliste, entre Paris et Buenos Aires, nous ouvre les portes d’un univers fantastique aux multiples sorties.
Dans Marelle, les règles laissent place aux nuances, hasards et improbabilités. Illusion romanesque et jouissance de s’éloigner d’une phrase à l’autre, ligne après ligne, de tout ce qui nous entoure. Comme dans un vaste éventail de tempos bercé par une rythmique diversifiée, rien n’est continuité mais tout est lié. Les 155 chapitres du livre se lisent, soit de façon linéaire, du chapitre 1 au chapitre 56, soit en partant du chapitre 73 et en suivant un ordre proposé en début de livre par l’auteur, en sautant ainsi de case en case. L’argentin, né à Bruxelles puis naturalisé français, introduit donc son lecteur dans son œuvre de manière ludique pour qu’il puisse reconnaître les innombrables allusions et décrypter leurs couleurs et leurs tons. Truffé de références savantes, le roman détonne par son lot d’occurrences. Si c’est une véritable bouffée d’air, il ne faut toutefois pas s’attendre à une simple récréation.
Terre. Un. Deux. Exil volontaire. Récit d’élans, en miroir entre les rues parisiennes et porteñas. Tourmentée et conversée : Marelle est une destination intercontinentale. Un roman dans lequel se croisent plusieurs mondes et où la nostalgie d’être et de ne plus être ensemble, nous envahit.
Trois. Quatre. Cinq. Urbain et musical. Sur fond de jazz comme pour symboliser le Paris en noir et blanc, Horacio Oliveira – figure de l’auteur –, immigré argentin, vit avec Sybille, une uruguayenne dont le fils Rocamadour est malade. Dans la capitale française, Horacio côtoie un groupe d’amis artistes : Le Club du Serpent. De l’érotisme, du bon vin, l’art et la Seine où circule un courant de ‘Pataphysique.
Six. Sept. Paradis et Enfer. Les mots de lunfardo – langage du tango – et la mélancolie prédominent les rapports entre les personnages et nous rapatrient dans le Buenos Aires des années 1940. Des passerelles se sont élevées. Horacio croit voir Sybille en une autre femme, Talita, la fiancée de son ami Traveler. Entre temps, il suffit de lire la lettre à Rocamadour pour s’entendre sangloter. Personne n’en est à l’abri. Le destin politique et poétique des mots se croisent dans un sens comme dans l’autre.
Huit. Neuf. Ciel. Le procédé littéraire sophistiqué dresse en dédale la force d’imagination du lecteur. Le récit s’écrit au temps du rêve. L’écrivain Morelli, mise en abîme de Cortázar lui-même, en est désormais le créateur singulier. Vous devez savoir comment déplacer vos pieds et Morelli choisit de quel côté vous sauterez. Dans Marelle où l’on se rend compte que l’aller est en fait le retour, l’auteur nous offre un autre accès – insolite – au roman.