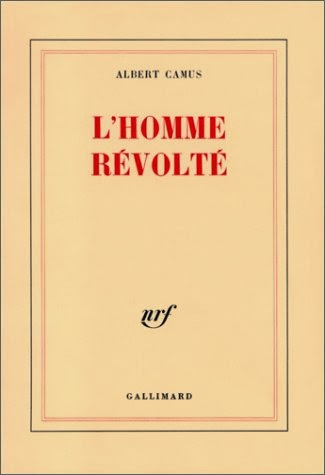Mourir pour des idées, d’accord ; mais de mort lente.
Lorsque l’on parle de Camus, on évoque souvent L’Étranger, La Peste et parfois Caligula ; on en fait l’écrivain de l’absurde, profondément inspiré par son Algérie natale. Sa philosophie est pourtant bien loin de s’arrêter à l’absurde et à sa prise de conscience. Camus sait que le constat de l’absurde n’a de valeur que dans les conséquences que l’on en tire, ce qui constitue le deuxième pan de son œuvre philosophique : L’Homme révolté, publié en 1951, livre bruyamment critiqué par les intellectuels communistes de l’époque. Il condamne les idéalismes qui prétendent consacrer des principes qui ne peuvent triompher ; idéalismes qui, dans leurs convictions, massacrent l’homme d’aujourd’hui pour des lendemains hautement hypothétiques. C’est cette lucidité désillusionnée mais non-cynique, qui se passionne pour l’homme plutôt que pour l’histoire, qui va ici nous intéresser.
Pour comprendre L’Homme révolté, il faut connaître Le Mythe de Sisyphe. Cet essai de 1942 est, avouons-le, encore un peu brouillon : la révolte qui y est brièvement décrite apparaît comme encore assez individualiste, et la « morale des conséquences » qu’il tente de définir ne convainc pas ; ce livre a néanmoins ceci de grandiose qu’il offre une rigueur nouvelle à la définition de l’absurde. Dans le chapitre « Les suicides philosophiques », Camus montre en effet que l’absurde ne se rencontre jamais en un seul élément, mais dans la comparaison et la confrontation entre différentes vérités. Ainsi, lorsque Faust clame dans la première version de la pièce : « Philosophie, hélas ! jurisprudence, médecine, et toi aussi, triste théologie !… je vous ai donc étudiés à fond avec ardeur et patience […] Et je vois bien que nous ne pouvons rien connaître ! », l’absurde n’est pas dans l’impossibilité de toute connaissance ; il est plutôt dans l’opposition entre cette incapacité et notre immense envie de connaître, ou entre la faiblesse de la raison − qui non seulement ne sait jamais rien, mais qui en plus croit savoir − et ses indiscutables forces − car enfin, le progrès technique existe −, ou encore, pourquoi pas, entre la raison comme source des dictatures sanguinolentes du XXe et comme formidable source d’avancées, ne serait-ce qu’en médecine.
C’est ce qui différencie Camus des précédents penseurs de l’absurde : alors que ceux-ci − qui se nomment, entre autres et dans le désordre le plus complet, Chestov, Kierkegaard, Heidegger, Nietzsche, le Marquis de Sade ou Breton − tendaient à placer l’absurde du monde dans un fait particulier − on peut évoquer la raison pour Chestov, ou les figures paternelles pour Nietzsche −, Camus place l’absurde dans toutes ces choses à la fois, et plus encore : plutôt que d’affirmer, comme Nietzsche, que l’homme est bien trop soumis à toutes sortes d’autorités, Camus démontrera que c’est à la fois un mal et un besoin ; il prouvera aussi que cette soumission n’est pas totale, et qu’elle se combine avec un certain degré d’émancipation qui dépend de l’individu comme de l’époque. Autre exemple, l’absurde ne se décèle pas dans le crime ou dans la morale mais dans la coexistence des deux en tout monde et même en tout individu ; il est surtout dans l’absence d’explication de leur présence conjointe et dans le manque visible, en deux millions d’années d’humanité, de prise de position définitive dans un sens ou dans l’autre.
L’absurde est aussi pêle-mêle, dans l’impossibilité de connaître un homme, y compris soi-même, à travers l’analyse approfondie ou même permanente de sa vie ; elle est tout autant dans le contraste entre le savoir scientifique et réalité de la chose ; on la retrouve à nouveau dans le choix de la routine métro-boulot-dodo, et ce en dépit de tous nos instincts et de toutes nos envies, ou dans le malaise d’Antoine Roquentin de La Nausée de Sartre face à tous les plaisirs de l’existence. L’absurde est, en quelque sorte, l’opposition inévitablement perpétuelle et incompréhensible entre toutes choses de la vie ; il est dans une multitude de tensions plutôt qu’en un seul principe, et peut se rencontrer « au détour de n’importe quelle rue ». Ce constat de l’absurde est d’autant plus véridique qu’il se forme malgré nous et tous nos espoirs originels – car nous voulons toujours, en première intention, donner un sens au monde : l’homme a créé la religion pour cette raison ; c’est aussi pour celle-ci qu’il vit pour demain plutôt que pour aujourd’hui. Plus encore que le manque de progrès ou même de direction stables, c’est le manque de justifications qui nous indigne : le cri de l’absurde est celui du « pourquoi ? ». On peut ici se référer à Caligula :
« Si tu savais compter, tu saurais que la moindre guerre entreprise par un tyran raisonnable vous coûterait mille fois plus cher que les caprices de ma fantaisie » ; et la réponse, rarement citée : « Mais, du moins, ce serait raisonnable et l’essentiel est de comprendre ».
Si lutter contre l’indépassable absurdité du monde peut, presque par définition, sembler vain, il n’est pas non plus possible de s’y résoudre : l’absurde mène à l’indignation. Là est le sens de la révolte. Le renoncement face à l’absurde est interdit ; Camus bannit donc le suicide désespéré. Les Carnets de Camus ne laissent à ce propos aucun doute : « Poser la question du monde absurde, c’est demander : « Allons-nous accepter le désespoir, sans rien faire ?« . Je suppose que personne d’honnête ne peut répondre oui. ». Si l’on ne peut qu’accepter l’absurde, on ne peut pas non plus le tolérer, et ce d’autant plus que cette tolérance ouvre la voie au désespoir subi ou à l’indifférence, deux postures qui autorisent toutes les horreurs sans même répondre à l’absurde. Toute horreur a en effet ses limites : si le mal absolu peut en théorie paraître être une réponse, il est en réalité impraticable ; Camus se rapporte à ce sujet au personnage d’Ivan Karamazov, déchiré par sa conviction que « tout est permis » au moment de tuer son père – meurtre auquel il renoncera, mais qu’il laissera faire.
En ces termes, la révolte semble s’apparenter à un simple pari ou, pour être plus précis, à un anti-pari pascalien. Alors que Pascal met l’accent sur le risque mis en jeu − notre éternité −, Camus ne ferait qu’insister sur la probabilité extrêmement élevée de sa non-existence – car enfin, comment peut-on croire qu’une éternité heureuse nous est réservée avec le monde que l’on connaît ; car surtout, comment s’assurer de posséder la bonne croyance ? Comme prononcé dans La Chute : « Le plus haut des tourments humains est d’être jugé sans loi ».
S’il y a certes un peu de cela dans la révolte de Camus, on aurait tort de la résumer ainsi. La prise de conscience de l’absurde se fait toujours contre nous et notre volonté ; il est logiquement et historiquement indépassable – c’est d’ailleurs pour cela qu’il est absurde. Imaginer trouver le réconfort de Dieu dans l’absurde, c’est ne pas en comprendre la vraie nature, faite de rage et d’arrachement. Ainsi, à supposer qu’une Raison supérieure existe tout de même, que celle-ci soit en Dieu ou non ; à imaginer, contre tout ce que l’on a observé, qu’une fin heureuse soit au programme, qu’elle soit « fin de l’histoire » ou « fin de la vie » ; à présumer encore que l’on adopte la conduite parfaite − en tant qu’homme dans nos vies individuelles ou, et le domaine du fantasme est alors amplement outrepassé, en tant qu’humanité dans l’histoire − pour accéder à cette fin heureuse sans même savoir ce que l’on attend de nous… Et bien, l’indignation reste la même : rien ne justifie le monde actuel ; si un meilleur monde est possible, pourquoi n’y aurions-nous pas accès dès maintenant ? L’excuse du péché originel ne tient pas : pourquoi serions-nous punis pour le péché d’un lointain ancêtre ? Qui plus est, pourquoi Dieu en voudrait-il tant à l’homme alors que celui-ci est tel qu’il a créé, c’est-à-dire à son image ?
Si Dieu et le Paradis existent, le monde est, au contraire, bien plus absurde : ce qui a encore moins de raisons d’être. Si seul Dieu existe, c’est qu’il est, au choix, sadique, impuissant ou désintéressé. Le feu de l’absurde n’est pas éteint.
C’est pourquoi l’on aurait tort de résumer la pensée de Camus à une attitude morale : si sa philosophie se forge effectivement sur les sentiments de l’absurde et de la révolte, elle n’est pas gratuite : elle est plus que rationnellement étayée.
Faire l’examen de l’absurde est alors difficile, mais nécessaire : savoir dans quel monde l’on vit est la base indispensable à toute action ; l’histoire nous l’a montré, nier l’absurde dans toute la complexité de son équilibre mène aux pires erreurs. La solution ne peut être dans l’ignorance de l’absurde : ne pas le regarder ne le rend pas moins réel et douloureux ; et il faut apprendre à vivre avec l’absurde. Aussi, si l’absurde n’est pas souhaitable, il a quelques aspects positifs : il nous libère paradoxalement de certaines de nos attitudes elles-mêmes absurdes, comme sans cesse repousser nos vies à des lendemains censés être plus chatoyants. Saisir l’absurde est donc pénible, mais positif. Incombe à la révolte de répondre à ce problème : si la vie n’a pas de sens, puisque le suicide est écarté, il faut tout de même bien la vivre.
Spontanément, la révolte peut paraître égoïste et amorale : si le monde n’a aucun sens, désintéressons-nous et partouzons ou, tant qu’à faire, torturons et exterminons. C’est ce que Breton, mentionné par Camus, prône : « L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule ». Or, même dans un monde absurde où tout triomphe éternel est inenvisageable, les actions ont des conséquences ; on ne peut les ignorer. En outre, nous avons vu que cette attitude radicalement nihiliste n’est supportable que dans le confort de son fauteuil : elle est concrètement intenable.
Mais l’argument essentiel de Camus est ailleurs. Si l’homme révolté ne dédouane pas l’homme de toute responsabilité, son ire est surtout adressée au monde ; car enfin, notre solidarité ne peut pas lui advenir. En affirmant cette colère, l’individu ne parle donc pas pour lui-même : le contenu de sa révolte ne le concerne pas en tant qu’individu, mais en tant qu’homme ; si nous apercevons l’absurde à travers nos vies respectives, c’est pour mieux le découvrir en tant que vérité universelle :
« Dans l’expérience absurde, la souffrance est individuelle. A partir du mouvement de révolte, elle a conscience d’être collective. » (L’Homme révolté, p. 37-38)
Nous sommes tous, pour utiliser une expression consacrée, dans le même bateau. C’est bien là la richesse de la révolte camusienne : puisqu’elle porte sur l’existence tout entière, elle porte aussi – nécessairement – sur et pour celle d’autrui. Du reste, la révolte peut aussi se déclencher à travers autrui : il n’y a pas besoin d’être intime avec la notion d’absurde pour comprendre qu’il peut être plus aisé de se révolter pour les grandes atrocités de ce monde, comme le Mali aujourd’hui, que pour nos vies respectives, où l’absurde, s’il est tout aussi présent, se fait plus discret, moins atroce et peut-être justement moins atténuable.
L’homme révolté se révolte donc pour l’homme : s’il nie un criminel, c’est seulement dans sa nature de criminel. En même temps qu’elle se constitue en tant qu’indignation, la révolte se fait aussi fraternité : elle est à la fois conscience de notre petitesse, c’est-à-dire de la futilité de certains enjeux par rapport à d’autres, et de notre hauteur, puisque nous nous mettons au niveau de Dieu, si ce n’est au-dessus. Camus résume parfaitement le mouvement de la révolte en ces quelques phrases :
« Primitivement, au moins, il [le révolté] ne supprime pas Dieu, il lui parle simplement d’égal à égal. Mais il ne s’agit pas d’un dialogue courtois. Il s’agit d’une polémique qu’anime le désir de vaincre. » (L’Homme révolté, p. 43)
« Elle [la révolte] dit en même temps oui et non. Elle est le refus d’une part de l’existence au nom d’une autre part qu’elle exalte. Plus cette exaltation est profonde, plus implacable est le refus. Ensuite, lorsque, dans le vertige et la fureur, la révolte passe au tout ou rien, à la négation de tout être et de toute nature humaine, elle se renie à cet endroit. La négation totale justifie seule le projet d’une totalité à conquérir. Mais l’affirmation d’une limite, d’une dignité et d’une beauté communes aux hommes, n’entraîne que la nécessité d’étendre cette valeur à tous et à tout et de marcher vers l’unité sans renier les origines. » (L’Homme révolté, p. 313)
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la révolte n’est pas non plus pessimiste : si elle est désespérée, elle est bien trop agitée et agitante pour ressasser la nature du monde et, si elle ne mise pas sur un avenir nécessairement meilleur, elle s’occupe avant tout de l’homme d’aujourd’hui : on pourrait presque parler d’un carpe diem indigné et solidaire. Ni les hommes ni leurs actions sont immortels, seule l’histoire l’est ; Camus en tire pour conclusion une révolte de réaction plutôt que d’élaboration politique, conclusion d’autant plus sage que nous savons aujourd’hui à quel point les hommes peuvent pervertir un idéal ; c’est pourtant sur ce point que nous essayerons de le dépasser.
Une pensée parfaitement rationnelle, logique, rhétorique et sophiste ne suffit pas à fonder une pensée juste ; celle-ci doit en plus, évidemment, être pédagogue, démontrer sa nécessité et encourager la pratique ; elle doit aussi, et cela on l’oublie trop, retransmettre l’exacte complexité du réel. En cela, une pensée juste ne peut qu’être multidisciplinaire − et l’on retrouve alors le concept de pensée complexe introduit par Edgar Morin dans les années 80 − ou choisir de définir une méthode, une attitude face à la vie, ce que propose Camus.
Les idéalismes du XIXe ont, eux, intuitivement placé l’absurde en un seul élément, l’élément variant selon le penseur ; étudié l’homme et l’histoire à travers cette idée au lieu de chercher leur idée dans l’homme et l’histoire : ainsi, tout allait dans le sens de leur conviction ; et proposé une solution souvent extrême, parfois même définitive, à cet absurde, sans se soucier de la cohérence de cette solution avec l’homme − ou si peu. Ils ont abouti à toute une variété de grands soirs ou à de despotismes − phénomènes que ces idéalismes n’auraient, il est vrai, pour la plupart pas approuvés − ; et, s’ils prétendent généralement combattre pour l’humanité entière, ils exterminent surtout l’homme d’aujourd’hui pour un éventuel et improbable homme de demain ; cela est d’autant plus ignoble que ces idées peuvent être fausses, perverties ou tout simplement dépassées − car il n’y a pas de fin de l’histoire. Cette inhumanité serait encore supportable si les chances de réussite étaient élevées ; l’histoire, et Camus avec, ont démontré qu’il n’en était rien. Comme dit dans Caligula, « un tyran est un homme qui sacrifie des peuples à ses idées ou à son ambition » ; et le révolutionnaire n’en est pas si loin : « La révolution, obéissant au nihilisme, s’est retournée en effet contre ses origines révoltées. L’homme qui haïssait la mort et le dieu de la mort, qui désespérait de la survivance personnelle, a voulu se délivrer dans l’immortalité de l’espèce. Mais tant que le groupe ne domine pas le monde, tant que l’espèce ne règne pas, il faut encore mourir […] la terreur reste dans le plus court chemin vers l’immortalité » (L’Homme révolté, p. 308). Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les révolutions mènent souvent à une dictature qu’elles prétendent, et même qu’elles croient, provisoires : pour créer un nouvel homme, il faut au moins cela.
« Le révolutionnaire est en même temps révolté ou alors il n’est plus révolutionnaire, mais policier et tortionnaire qui se tourne contre la révolte. Mais s’il est révolté, il finit par se dresser contre la révolution. Si bien qu’il n’y a pas de progrès d’une attitude à l’autre, mais simultanéité et contradiction sans cesse croissante. Tout révolutionnaire finit en oppresseur ou en hérétique. » (L’Homme révolté, p. 311)
C’est ce qui rend le désespoir de Camus formidable : il est un fantastique antidote aux maux du XXe siècle, antidote utilisé encore trop parcimonieusement. La révolte est, avec l’absurde, notre seule certitude ; elle est donc le principe de toute action, que celle-ci soit réalisée en tant qu’individu ou en tant qu’homme. Puisque aucune construction ne peut être durable, il faut, dans nos vies personnelles, savoir vivre aujourd’hui – tout en pensant au lendemain, mais pas au surlendemain ; tout en pensant à l’homme, mais en tant qu’essence humaine et pas en tant que pantin de l’absurde. Puisque le monde n’a aucun sens défini, il faut, dans nos vies collectives, savoir s’indigner pour l’homme ; combattre pour lui, et jamais contre lui.
C’est pour cette raison qu’aucune justification rationnelle du meurtre n’est concevable. L’homme révolté ne peut accepter le meurtre que si celui-ci privera très certainement le monde d’autres meurtres, et encore ; s’il commettra ce crime, il ne le pensera pas excusé pour autant. C’est pour cela que Kaliayev, dans Les Justes comme dans la vie, désire mourir après son attentat : il ne peut pas défendre son meurtre, et il ne peut plus vivre avec lui-même. Camus analyse le sens de cette posture avec brio : « Dans le même temps, ces exécuteurs, qui mettaient leur vie en jeu, et si totalement, ne touchaient à celle des autres qu’avec la conscience la plus pointilleuse ». Camus décrit alors ce qui a aussi fait le thème de sa pièce : Kaliayev avorte sa première tentative d’attentat contre le grand-duc Serge afin d’épargner les deux enfants qui l’accompagnent.
« Dès lors, incapables de justifier ce qu’ils trouvaient pourtant nécessaire, ils ont imaginé de se donner eux-mêmes en justification et de répondre par le sacrifice personnel à la question qu’ils se posaient » (L’Homme révolté, p. 216-217). Si l’homme révolté ne regrette pas son acte, s’il le considérait déjà horrible au moment de le commettre, il ne sait pas vivre avec. Il préférera toujours le non-meurtre au meurtre, et même le suicide révolté au meurtre ; si un innocent peut souffrir des répercussions de son geste, il y repensera à deux fois.
Qu’elle soit révolutionnaire ou réformiste, l’activité dans le cadre politique n’est pas donc pas encouragée en soi : elle ne l’est que lorsqu’elle répond parfaitement aux critères, ou plutôt à l’essence, de la révolte ; c’est-à-dire : la solidarité entre les hommes, qui, puisque l’absurde est partout, se déduit immédiatement de la solidarité des hommes face à l’absurde. Tous les moyens ne sont pas pertinents dans cette révolte désespérée ; le succès n’est assez assez probable pour cela.
L’histoire a évidemment, à différentes échelles, ses directions : elles sont les conséquences des désirs et du fonctionnement de l’homme et du monde absurde. Mais ces directions ne font pas autorité en elles-mêmes, et rien ne permet de préjuger de leur pérennité ou de leur valeur. L’absurdité est une fatalité, mais l’histoire n’en est pas une : elle est justement immortelle, au sens où elle ne finit jamais. Si l’homme n’est pas le créateur de l’absurde et qu’il en est d’abord la victime, il décide aussi de le perpétuer : il y a donc en l’homme un désespoir de la possibilité, désespoir que Camus remarque, mais sans le distinguer du désespoir face à l’absurde lui-même. On ne peut pourtant pas les confondre : alors que le sentiment d’absurde voit dans un premier temps l’homme comme victime, il le découvre ensuite coupable : il se rend compte que l’absurde n’est pas non plus dans le monde, mais dans la confrontation entre le monde et l’homme. Ceci vient s’ajouter au projet que nous entretenons : comprendre Camus, c’est-à-dire ses vérités et ses réponses, pour nourrir une ambition plus large à partir de sa pensée.
Camus n’est pas anarchiste : il sait tout comme Hobbes que, si l’homme peut être un Dieu pour l’homme, il peut aussi lui être un loup : on ne peut pas s’attendre à ce que tout le monde embrasse, du jour au lendemain, les principes de la révolte – ou les principes du Contrat social, ou tout autres principes.
Est-ce à dire que la révolte n’a pas sa place dans l’antre du politique ? Camus prétend que « si la révolte pouvait fonder une philosophie […] ce serait une philosophie des limites, de l’ignorance calculée et du risque » (L’Homme révolté, p. 361). Or, il n’apporte aucun argument contre cette potentialité, et tout porte à croire que la philosophie politique peut se l’approprier, et donc la politique elle-même ; en tout cas, la question mérite au moins d’être posée ; nous l’avons d’ailleurs déjà présagée plus haut. Cette question n’est pas gratuite : s’il n’est pas non plus permanent, le cadre politique facilite l’initiative. Entendons-nous immédiatement sur ce point : s’il s’avère qu’une « politique révoltée » est constructible, elle devra être des plus prudentes, et reposer sur des principes rares mais précis afin de ne pas être déformable. Son rôle sera surtout de réfléchir aux mondes immédiatement possibles ; elle devra aussi, évidemment, se demander comment mener ces idées à l’ordre politique et au succès politique, et comment les concrétiser ; tout cela aux échelles nationales et internationales, en ayant toujours pour priorité la modestie de la pensée.
Poser la question d’une politique de la révolte, c’est aussi se demander : la révolte peut-elle anticiper les événements ? Peut-on en transmettre le sentiment à l’homme éduqué par TF1 d’une façon plus continue dans l’histoire, en sachant que l’effort sera toujours à renouveler ; et, si oui, par quels moyens ; et, si oui, comment accéder à ceux-ci ; tout cela en respectant les fondements de la révolte, c’est-à-dire, entre autres, la plus grande précaution ?
La réponse à ces questions est positive : si l’absurde se vérifie effectivement à travers une addition d’absurdités, il devient ensuite une vérité en elle-même, indépendante de ses manifestations. La révolte peut donc être à la fois une révolte contre l’absurde en soi et contre les différentes absurdités du monde et des hommes ; même, les deux se combinent : si l’absurde est bel et bien inévitable, on peut espérer calmer quelque peu la confrontation entre les hommes et le monde, entre les hommes et les hommes ; en plus des luttes éphémères et permanentes contre telle ou telle absurdité, on peut convoiter, avec un soin infini pour fuir les dérives et sans certitude de permanence, un enseignement et un éveil progressifs à la philosophie de l’absurde et de la révolte. L’histoire étant un perpétuel aujourd’hui, cette entreprise est à la limite de l’irréalisable ; mais, puisque le monde ne nous propose rien d’autre que de l’absurde, c’est à l’homme, par tâtonnements successifs et en se fondant sur une révolte sans idéalisme, de redonner éternellement un sens à l’histoire.
Il ne s’agirait alors pas de fonder un parti de la révolte : bien trop de questions échappent aux fortes évidences que fait apparaître la révolte ; surtout, gouverner signifie agir en conviction, c’est-à-dire prendre des décisions sur maintes sujets ; la révolte, elle, se veut certitude. C’est pourquoi la lutte pour l’influence est, pour l’homme révolté, peut-être la plus cohérente. Reste à en définir plus précisément les modalités, ce qui n’est pas l’objet de ce texte : il ne prétend qu’en démontrer la potentialité, voire − c’est un bien grand mot − la nécessité.
La modestie de cette attitude n’est pas tant dans la passivité − la révolte n’accepte pas de rester les bras croisés − que dans son absence de prétention à la durabilité : elle ne veut pas risquer aujourd’hui pour un futur trop incertain. Elle est, au contraire, extrêmement active : elle ne se satisfait pas de la pure vie intellectuelle et ne s’épanouit que dans la pratique.
C’est à travers cet alliage entre prudence et pédagogie, entre pragmatisme et colère, entre incertitude et remodelage quotidien que peut se former une politique de la révolte. Rien de cela n’en trahit l’esprit originel : elle est toujours engagement contre tout ce qu’il y a d’inhumain.
Il y a, à mon sens, un autre enjeu qui mérite que l’on y revienne : l’oubli. Si la non-compréhension de l’absurde est au cœur des idéalismes, l’oubli est, lui aussi, omniprésent dans notre monde. Nous connaissons tous ces moments où nous pensons faire de grandes réalisations ; nous poursuivons pourtant nos vies le lendemain comme si de rien n’était. Nous négligeons aussi nos nombreuses résolutions, non pas tant parce que nous ne croyons pas en leur valeur que parce que nous ne nous exerçons pas à les respecter et à les remémorer. C’est la raison pour laquelle le cadre politico-médiatique peut et doit contribuer à la révolte : outre les actions que celui-ci rend possibles, il offre en effet le seul moyen de répandre et de maintenir la conscience de ces principes. Camus a bien vu ce problème mais ne s’y est pas attaché : il a négligé la transmission de la mise en pratique, et pour cause : il était convaincu qu’un « homme est toujours la proie de ses vérités » (Le Mythe de Sisyphe, Folio essais, édition de 1985, p. 52). C’est d’autant plus étonnant qu’il cite dans L’Homme révolté deux cas d’oublis de la révolte :
« Le trône de Dieu renversé, le rebelle reconnaîtra que cette justice, cet ordre, cette unité qu’il cherchait en vain dans sa condition, il lui revient maintenant de les créer de ses propres mains et, par là, de justifier la déchéance divine. Alors commencera un effort désespéré pour fonder, au prix du crime s’il le faut, l’empire des hommes. Cela n’ira pas sans de terribles conséquences, dont nous ne connaissons encore que quelques-unes. Mais ces conséquences ne sont point dues à la révolte elle-même, ou, du moins, elles ne viennent au jour que dans la mesure où le révolté oublie ses origines. » (L’Homme révolté, p. 43-44)
« Rimbaud n’a été le poète de la révolte que dans son œuvre. Sa vie, loin de légitimer le mythe qu’elle a suscité, illustre seulement – une lecture objective des lettres au Harar suffit à le montrer – un consentement au pire nihilisme qui soit » (L’Homme révolté, p. 118)
Ici, l’on souhaiterait presque que Camus ait davantage emprunté aux philosophies grecques, et plus précisément aux exercices proposés dans leurs enseignements. Réfléchir à la notion d’absurde en soi et de fait cinq minutes matin et soir, agir dans le sens de notre révolte au moins une fois par jour, sont autant de gymnastiques qui ont aussi leur place dans la révolte ; car enfin, celle-ci ne peut qu’être dans l’action.
Camus parle de la révolte comme une conséquence inévitable de son absurde, et il a raison. Seulement, il vit à une époque où la révolte, si elle peut être mal comprise, est en tout cas bien plus intuitive que pour nous autres, occidentaux de ce début de troisième millénaire. Si nos vies citadines sont elles aussi absurdes, elles sont assurément moins révoltantes que les génocides que l’histoire continue à connaître. La révolte n’est cependant pas difficile à retrouver : il suffit de décrire le monde tel qu’il est, ou même d’étudier un quelconque sujet d’actualité en profondeur, pour la ressentir. Il y aura toujours de l’injustice et des guerres : c’est pourquoi la révolte est un mécanisme permanent. En ce sens, elle est vaine. Mais c’est justement parce que le monde ne nous sauvera pas que nous nous devons d’agir : c’est à nous de prendre nos responsabilités ; l’homme est sa propre destinée, mais aussi son propre but. L’homme est fragile ; il a besoin d’être défendu, et seul l’homme peut s’en charger.
La grandeur de Camus est de saisir la complexité du monde et d’y trouver une source de solidarité pour l’homme sans tomber dans l’idéalisme. Si son système philosophique est remarquable, le lire − et le pratiquer − est aujourd’hui d’autant plus essentiel que l’histoire des deux derniers siècles lui donne raison : L’Homme révolté est, plus que jamais, d’actualité.