Céline a écrit que New-York était une ville debout ; depuis quelques jours, c’est devenu une cité de flaques : une ville de boue. Sandy a ravagé toute la côte est des États-Unis, mais encore les tropiques, mais encore les Caraïbes et tous ces archipels couleur mangue fendue. Parmi eux, il y a Haïti, où cinquante personnes au moins sont mortes, et où l’on redoute à peu près toutes les catastrophes possibles et concomitantes, depuis les épidémies jusqu’aux glissements de terrain. Depuis quelques heures, à présent que Manhattan est sauvé des eaux, beaucoup de journalistes scrupuleux s’interrogent : « N’en avons-nous pas trop fait sur Brooklyn inondé ? ». Ils redoublent : « Pourquoi la Corrèze de verre et d’acier plutôt que le Zambèze de tropiques et de fleurs? ». Ils se morfondent : « Mon Dieu mon Dieu, le deux poids-deux-mesures, signe de notre indécent tropisme occidental ? ». Le traitement de l’information est toujours perfectible ; probablement, la fraternité a des élans spontanés procédant par cercles concentriques ; je voudrais cependant citer ici le témoignage (recueilli par le Point.fr) d’Emmelie Prophète, que j’ai connue, en Haïti, au Ministère de la Culture, éveillant dans les yeux de centaines d’écolières sages et attentives la petite luciole de la fibre littéraire : « Pour ma part, et je crois que cela est partagé par mes compatriotes, je ressens comme devant le tsunami au Japon – où je souffrais autant que les Japonais – un sentiment de solidarité muette par rapport à ce que vivent les New-Yorkais aujourd’hui. Je compatis à leur sort. »
Vous avez bien lu : nul complotisme façon coups de billard à trois bandes, nulle américanophobie du café du gauchisme, pas la moindre trace de victimisation paranoïaque, seulement et simplement l’émotion spontanée, celle de l’universalité infinie de la douleur. Les Haïtiens ont cette capacité étonnante de repousser sans cesse les limites de l’élégance humaine. De ce peuple artiste et sans ressentiments, qui transcende en un sourire ou un seul roman la farandole entière des sept plaies du monde, je pourrais citer encore le cas de Makenzy Orcel, qui vient de faire paraître « Les Immortelles », un livre qui fait jaser à Canapé-Vert et à Télérama, ce qui, en soi, justifie de le lire. Makenzy Orcel est, très probablement, l’homme le plus gentil de l’hémisphère nord ; il possède en tout cas le même sang-bleu des Princes célestes, ceux qui peuplent la petite île en forme de trident émeraude ; sa générosité n’a d’égards que sa superbe, son courage d’être écrivain dans un pays, où, très franchement, en toute sincérité, il vaut mieux faire maçon, jardinier ou dictateur pour tenter de thésauriser quelques calories chaque jour, tiens donc, une ration d’igname, mon Dieu, quel trésor, un morceau de banane-fleur mal lavé.
Bon.

Vous me direz : n’est-ce pas là un cas de copinage littéraire tout à fait honteux, idéal-typique, exemplaire, caricatural, grotesque ? Voyons voir. Je crois bien que oui. Mais dans le même temps que j’avoue, j’assume tout-à-fait : Makenzy Orcel est bien mon ami. Certes, on peut voir dans cet éloge de son livre, c’est plus que probable, c’est même certain, un moyen (peu glorieux, ignoble, scandaleux) de détourner les voies les plus prestigieuses de la presse française pour solder une dette franchement faramineuse contractée en consommations de rhum sawer (deux tiers de citron, un tiers de rhum Barbancourt, une pointe de Martini, sucre, servir frais, à la cuiller, on n’a pas de shaker de toute façon, en Haïti), et ce, dans les bars les moins honorables de la Rue Capois de Port-au-Prince ; c’est indubitable, c’est une évidence ; mais l’assurance de mon intérêt n’a d’égal que la valeur du très bel ouvrage de Makenzy, « Les Immortelles », donc, qui, soit dit en passant, est si bon qu’il n’a nul besoin spécifique de mon concours et récolte quantité de prix et d’éloges, tout seul, comme un grand.
Les toilettes et la prostitution occupent une place injustement minuscule dans la littérature mondiale. De ce constat sans appel, Makenzy Orcel a tiré deux ouvrages : les « Latrines » (2011), roman célinien sur les entrailles de Port-au-Prince, et « les Immortelles », adjectif d’éternité glorieux recouvrant pour lui le plus périssable des commerces : celui de la chair, du sexe. « Pour moi une pute c’est comme l’œuvre d’un grand peintre. C’est fait pour être exposé. Pour être vu. Etre une fête pour les yeux », écrit-il notamment. « Les Immortelles », ce n’est pas, pour ainsi dire, un roman : plutôt une collection de poèmes en prose, soi-disant écrits par un auteur un peu minable, qui, en échange de quelques minutes de plaisir auprès d’une vieille courtisane, prête sa plume à la mémoire d’une petite péripatéticienne, disparue dans le séisme de Janvier 2010. La vieille pute s’achète ainsi un mausolée pour sa jeune compagne, et le livre « écrit à compte de sexe » tente de ranimer, façon vaudou, la mémoire de la trop jeune gagneuse de « Christianisme Hôtel » ; mais comme dans les cérémonies envoûtées du Baron Samedi, le poète s’embarque et s’emporte, s’incarnant tour à tour dans trois personnages différents, et ramenant de ce long dérèglement de tous les sens une œuvre charogne, rapiécée et odoriférante, et pour tout dire, bouleversante. On oubliera peu aisément cette jeune « Shakira » (ainsi appelée parce « ça sonne presque comme : ça ira ») martyre de Port-au-Prince, libre et suppliciée, anéantie dans sa révolte, écrabouillée et éclaboussée de souillure, une image transparente mais si juste de ce beau pays. Comme en abordant les Haïtiens eux-mêmes, les premières lignes de Makenzy Orcel peuvent déconcerter par une sincérité, un dénuement, une maladresse, pour nous, lecteurs trop littéraires ; comme en abordant les Haïtiens eux-mêmes, cette première impression pleine de condescendance ira se dissolvant peu à peu dans un tremblement de toutes les entrailles, un attachement éternel.
Je ne sais pas si on parle assez des morts de Sandy ; on ne parlera jamais suffisamment, en tout cas, des romans d’Haïti.






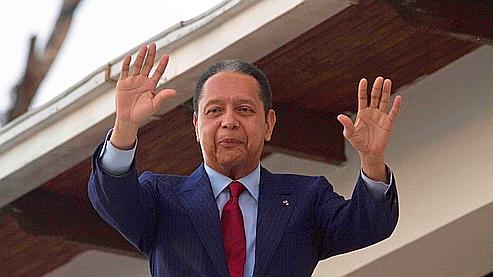

[…] Shakira la louchette […]