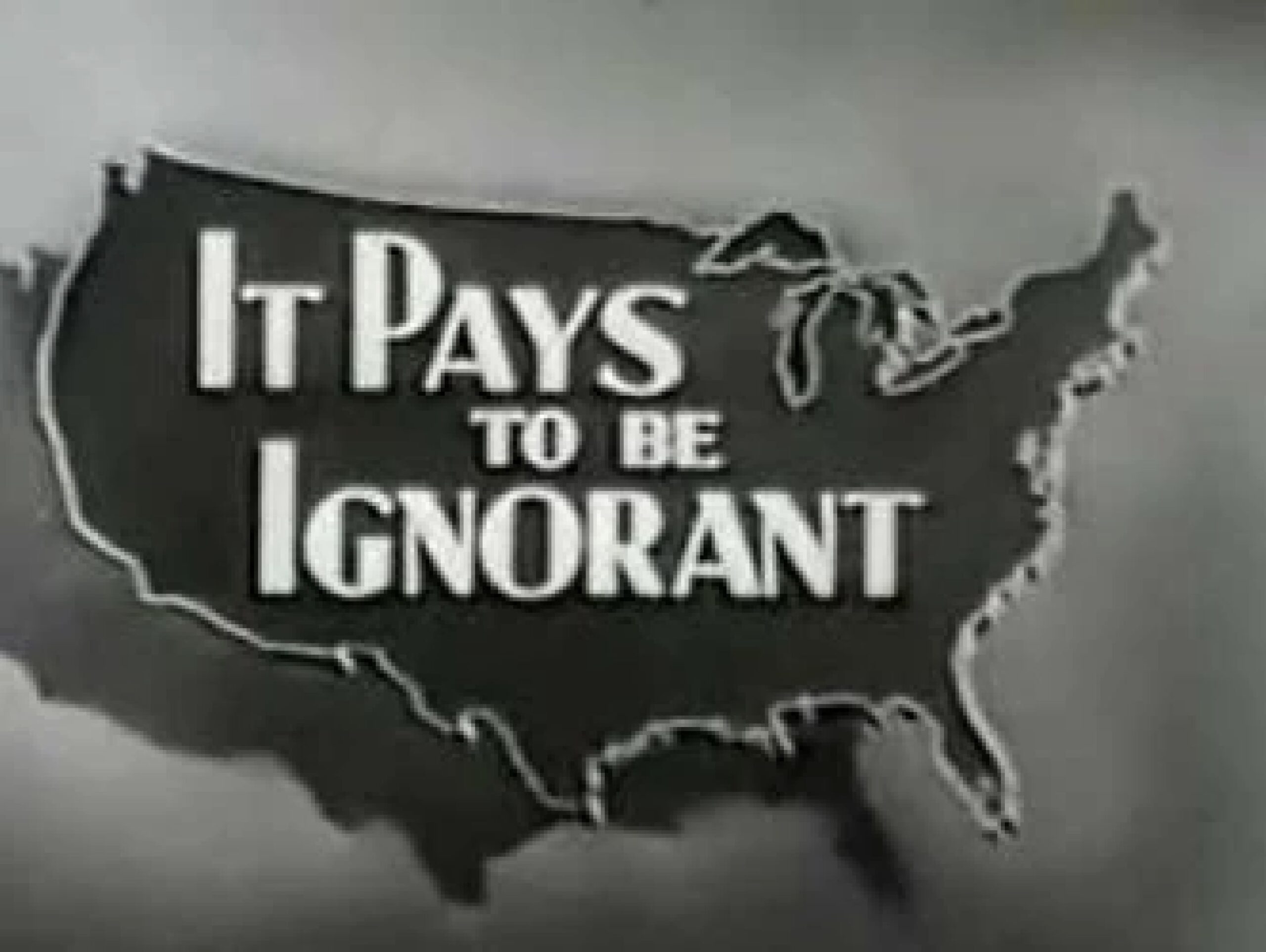La première fois que je l’ai vue – c’était il y a plus de trente ans – j’ai d’abord été frappé par son apparence générale : sa maigreur, son teint blafard, ses vêtements trop grands, et ses cheveux. Très vite pourtant, il m’a semblé que cette impression de laideur qui se dégageait était quelque chose à quoi elle s’obligeait. Une laideur, en quelque sorte, fabriquée, et d’abord par une « coiffure » étonnante : elle avait très peu de cheveux (et ce pour l’excellente raison qu’elle se les arrachait, littéralement, par poignées), et taillait elle-même au hasard dans ce qui restait. La seconde chose qui m’a frappé fut sa voix. D’une grande douceur, très fragile, comme portée au bord d’elle-même, et presque sans modulation.
La première chose qu’elle me dit fut qu’elle ne voulait pas faire d’analyse (je ne lui avais encore rien demandé, et encore moins offert quoi que ce soit), mais qu’elle voulait plutôt « simplement parler avec quelqu’un ». Je lui demandai donc comment elle était venue jusqu’à moi – et si elle savait, au juste, chez qui elle était. À ces questions, ses réponses furent plutôt évasives – et de toute évidence mensongères : elle avait entendu parler de moi par un collègue, mais ne savait pas, au juste, qui j’étais, ni ce que je faisais… Je souris, mais ne fis aucun commentaire. Devant mon silence, elle se tut également un bon moment, puis me dit, de manière à peine audible, qu’elle s’agressait.
« C’est-à-dire ? »
« Je me brûle, je me lacère les bras et les cuisses, je m’arrache et me coupe les cheveux, j’avale des médicaments… et je me fais baiser par des inconnus, dans leur voiture. »
Je choisis, sans vraiment savoir pourquoi, de ne pas la relancer là-dessus, mais plutôt de lui demander comment, de quoi, et avec qui elle vivait. Elle me répondit de manière assez confuse : son père était magistrat, sa mère institutrice ; elle avait 37 ans ; vivait depuis une dizaine d’années avec une femme ; n’avait eu aucune liaison avant ; n’avait pas d’emploi fixe mais ne manquait jamais de travail ; enfin entretenait depuis quelques années une liaison clandestine avec une jeune femme, mais une liaison d’un type, dit-elle, assez particulier. En effet, cette jeune femme refusait tout contact sexuel, mais l’obligeait à « prendre du plaisir » devant elle. En clair, cette jeune femme lui indiquait à quelle gymnastique elle souhaitait la voir s’adonner. Et s’il lui arrivait, quoique rarement, de la toucher, elle n’avait en revanche jamais consenti à se laisser toucher.
Le premier entretien, qui avait duré près d’une heure, s’acheva là-dessus. Je me contentai de lui dire que si elle souhaitait continuer à en parler, elle pourrait le faire, mais qu’elle ne pouvait plus prétendre ignorer à qui elle avait affaire. J’ajoutai que je ne savais pas encore, quant à moi, si j’accepterais de la prendre en analyse, mais que je serais là-dessus fixé assez rapidement. Nous convînmes de nous revoir le lendemain.
Dès son arrivée, elle me fit part de son embarras. Elle était en thérapie (sic) depuis quelques années, mais souhaitait quitter son analyste (sic), parce que, disait-elle, les choses avaient pris une tournure telle qu’il lui semblait être dans une impasse. Je lui dis que dans ces conditions, il n’était pas question que je la reçoive, et qu’elle devait tirer au clair cette situation avec son analyste. J’ajoutai que si elle décidait de mettre un terme au travail engagé avec lui, elle pourrait revenir me voir et que je verrais alors, d’après ce qu’elle me dirait, si le travail avec moi me paraissait possible. Sur ce, je mis fin à l’entretien.
Elle retourna voir son analyste, lui dit qu’elle m’avait vu, et lui fit part de ma position. Cela, je l’appris non d’elle, mais de son analyste : il me téléphona en effet, pour me dire que les choses avec elle étaient devenues pour lui impossibles, qu’il ne se sentait plus capable de travailler avec cette femme, et qu’il se réjouirait de la voir engager avec moi un autre travail. Il ajouta qu’il lui semblait – car nous nous connaissions – qu’elle pourrait avec moi faire un travail qui était avec lui impossible en raison de ce qu’il appela lui-même ses « inhibitions ». Il voulait par là désigner la nécessité pour lui d’une certaine « rigidité » du cadre analytique, et entre autres l’impossibilité pour lui de travailler avec cette femme en face à face. Or, il en convenait, elle ne supportait pas d’être allongée. Cette rigidité avait d’ailleurs conduit cette femme, me dit-il, à certains passages à l’acte violents (elle avait mis le feu aux rideaux de la salle d’attente), et il craignait de ne plus pouvoir ni contrôler, ni contenir la situation. Je lui dis donc que j’accepterais de revoir la patiente si elle le souhaitait, mais que je préférais qu’il ne lui en dise rien afin qu’elle prenne toute seule l’initiative de me rappeler. Ce qu’elle fit, un peu plus de trois mois après l’interruption du travail chez son premier analyste.
Pendant un premier temps assez long (près de un an et demi) il ne fut question, presqu’exclusivement, que de deux choses : sa liaison avec la jeune femme, et l’ennui profond dans lequel, par ailleurs, elle vivait. Elle disait vouloir mettre fin à une situation dans laquelle elle se voyait réduite au statut d’objet, mais elle craignait qu’une fois affranchie de cette aliénation elle ne connaisse plus que cet ennui. Et c’est d’où elle se demandait ce qu’au juste elle venait chercher chez moi : la délivrance d’une histoire douloureuse, ou la restauration d’une sujétion qui était peut-être un mal nécessaire à sa vie ? Elle penchait plutôt, d’ailleurs, et tout à fait lucidement, pour cette seconde hypothèse. La cure n’allait pas être facile, pensais-je, car cette femme était de toute évidence – et cette évidence allait se révéler être l’obstacle majeur à mon propre travail – en proie à ce qu’il me faut bien appeler une pulsion d’emprise. Rien ne me permettait de penser que les choses allaient pouvoir avec moi se passer autrement. Vous l’aurez compris, je veux parler ici de ce qu’il est convenu d’appeler la réaction thérapeutique négative, c’est-à-dire une de ces cures au cours desquelles le pire est toujours sûr. Comme le dit Alice Miller, j’avais peut-être affaire à quelqu’un qui pensait : « plutôt rester malade que tomber guéri ». Je me suis très vite demandé si cela allait être pour elle une douleur toujours reprise. Pour elle – et pour moi.
Et en effet, l’analyse allait rencontrer – ou plutôt : allait elle-même devenir – ce qui la nierait. Peu à peu, cette liaison allait se vivre sur un mode tel que seule sa dimension destructrice serait éprouvée. La patiente se mit ainsi à employer tout le temps que je lui accordais à inlassablement reprendre la même plainte, plainte qu’elle formulait invariablement dans les mêmes termes. Le scénario lui-même ne variait que bien peu : après un repas au cours duquel elle s’était vu rabrouée, elle se retrouvait au lit avec son amie, qui s’en tenait à mettre en scène l’offrande de plaisir qu’elle réclamait.
Cette dernière phrase est volontairement ambigüe : on ne sait plus très bien, en effet, qui est cette « elle », autrement dit laquelle des deux est en position d’assujettissement au fantasme d’offrande. Sans doute l’hypothèse de T. Reik est-elle juste, selon laquelle le fantasme masochiste est un ordre sadique visant à obliger celui qui se croit en position de maîtrise à ajuster sa jouissance au fantasme de sa soi-disant victime. Le masochiste est toujours le maître du jeu, et en ce sens il souligne peut-être mieux que quiconque l’impensable du plaisir, à savoir qu’il est peut-être radicalement impossible de s’affranchir de la souffrance de ne pouvoir se passer d’un autre, ni pour aimer, ni pour parler, ni pour penser. Aussi ai-je cru bon, à un moment de la cure, de lui indiquer cela, de lui dire que c’était bien elle qui maîtrisait le jeu. Cela, il me semble, fut décisif – ce qui ne veut pourtant pas dire que j’eus raison de le lui dire. Cela veut simplement dire qu’à partir de ce moment son intérêt pour cette liaison (à moins que ce ne fût pour le récit qu’elle en faisait…) n’a plus été le même : elle s’est mise, là aussi, à s’ennuyer, et ce jusqu’à désinvestir la liaison à un tel point qu’elle put y mettre fin.
Seulement voilà. Cette déliaison faite, il ne restait plus rien. Et presque aussitôt, de très anciens symptômes sont réapparus, et en particulier ce qu’elle appelait (mais sans s’apercevoir du jeu de mots) ses auto-agressions, c’est-à-dire tout à la fois de fausses tentatives de suicide médicamenteuses, et le racolage d’étrangers par lesquels elle se faisait baiser dans leur voiture. De cela, très vite, elle me tint responsable. « Vous m’avez encouragée à mettre fin à cette liaison, mais vous ne m’offrez rien pour la remplacer. » Et à partir de ce moment, il me fut impossible de l’arracher à la position de total assujettissement à moi dans laquelle elle s’installa : je ne devais plus, disait-elle, être son analyste, mais « un homme ». Je devais lui offrir quelque chose de « vrai ».
Et j’ai en effet été tenté de lui accorder davantage de latitude : la possibilité de me téléphoner en dehors du temps des séances, une occupation de l’espace de ma consultation comme bon lui semblait (et il est même arrivé que quelques séances aient lieu, à sa demande, dans… la salle d’attente), l’ajout de séances, dans les limites de mes disponibilités, au cours d’une même journée, etc. Bref, j’ai admis, même encouragé, un certain jeu sur, ou avec, les limites du cadre. Je dois même dire avoir choisi de laisser le cadre devenir, certes non pas élargi à l’infini, mais presque dépourvu de toute mesure objective autre que celle que lui donne le besoin, ou l’arbitraire de la volonté. Du coup, et je ne peux que le regretter, la situation analytique elle-même est devenue infiniment plus aliénante que ne l’avait été la liaison, car les limites qu’impose le corps au masochisme érogène sont en effet plus fermes et, d’une certaine manière, plus nettes, que celles qu’oppose la psyché au masochisme moral. Mais, en même temps, ce que cette situation m’a permis de formuler, c’est que c’est peut-être pour pouvoir continuer de croire qu’il peut y avoir quelque chose de partageable, et sans reste, que le masochiste se laisse réduire au non-sens de l’autre, qu’il se laisse couper de ce qui devrait lui être vital. C’est donc peut-être toujours pour, en quelque sorte, pouvoir croire qu’il intéresse un autre, qu’il le touche, que ce qu’il dit lui parle, le concerne, que le masochiste s’engage sur la voie de cette réduction.
*
Cette femme, ai-je dit au début, était venue pour parler avec, et non à quelqu’un. Très vite pourtant, elle abandonna cette requête pour dire – et cela n’a plus varié – qu’elle voulait qu’on lui parle. En effet, le plus remarquable chez elle est qu’elle n’avait jamais su se construire autrement que par identification à l’agresseur qu’avait tour à tour été sa mère, son beau-père, puis chacun des enfants de celui-ci. Elle avait en quelque sorte très tôt inscrit les mots des autres dans sa chair, et d’abord celui de salope. « Je sais bien », répétait-elle sans arrêt, « je ne suis qu’une salope, une ordure ». Et il est ici important de rappeler que le seul rêve qu’elle n’ait jamais raconté fut un rêve dans lequel elle se voyait fouiller une poubelle, et ce sous mon regard attentif. Bref, elle n’a jamais réussi à s’inventer, n’ayant pu que laisser s’inscrire, donc, ces mots qui provoquaient en elle quelque chose que j’appellerai des hallucinations d’absence : elle disparaissait derrière ces mots orduriers qui composaient les archives de son identité, qui lui disaient son inévitable, sa nécessaire, son obligatoire corruption. Et cela eut pour conséquence de l’empêcher de croire que nous faisions autre chose, en nous adressant à elle, que de nous payer de mots.
Comment, dans ces conditions, faire autrement que de réclamer ce à quoi elle ne croyait pas : quelque chose de vrai ? Elle tenait donc comme elle pouvait : en excluant à l’intérieur d’elle-même ce dont elle fut de tout temps exclue : l’humanité.
Quant à ses auto-agressions, elles lui faisaient dire deux choses. En ce qui concerne les mutilations (brûlures et lacérations), elle répétait les paroles de Fritz Zorn : « Partout où ça fait mal, c’est moi. » Et pour ce qui en était des « baises » en automobile : « Après, je me dégoûte – et je sais que j’existe. »
Ces mots, « salope », « pourriture », « pute », étaient ceux de sa mère. Elle avait donc été nommée par sa mère dans un rapport à la corruption, au sens à la fois juridique et, si j’ose dire, médical, du terme, nomination à partir de laquelle, un peu comme pour le Schreber de Freud, elle ne pouvait se voir que depuis un effet de voix : elle percevait la parole (ich vernahm seine Sprache, disait D.P. Schreiber). Elle ne se voyait plus (mais s’offrait à voir), et cet aveuglement créait le vide d’où lui parvenaient les mots de sa mère. Et il me semble bien que l’hypothèse de J.-B. Pontalis, selon laquelle la réaction thérapeutique négative est une folle passion pour guérir la mère folle à l’intérieur de soi, est ici tout à fait pertinente : elle était possédée par le corps étranger de sa mère, corps étranger interne, qui faisait sans cesse effraction, comme si sa mère tenait lieu de pulsion.
*
J’en étais là avec elle, à essayer de faire en sorte qu’elle puisse se laisser marquer par une parole vraiment autre, à partir de laquelle elle aurait pu s’inventer comme femme. Mais je me rends bien compte qu’à dire les choses à ce niveau de généralité, on ne dit pas grand-chose. Alors, de manière plus précise : j’ai essayé de travailler à partir de cette affaire de limites que j’évoquais plus haut. D’autre part, je me suis efforcé de lui permettre de reconnaître à quel point elle fut dépossédée par les mots d’une autre, mais que cette dépossession en quelque sorte paradoxalement la satisfaisait : cela lui permettait d’éviter le risque d’un lien véritable.
Le rangement de cette femme sous le signe de la saloperie fut, me semble-t-il, la ruse par laquelle elle arrivait à maintenir l’espoir de guérir sa mère. Car si elle faisait par là l’aveu qui est nécessaire au fonctionnement interne de toute famille, elle ouvrait en même temps cette famille sur ce qu’il y avait en elle de pourri. En clair : c’est sa propre voix que chacun est contraint d’entendre, comme c’est aux limites de son propre désir que sa partenaire était confrontée dans les mises en scène qu’elle croyait gérer.
En d’autres termes, l’hypothèse que je voudrais ici proposer, c’est que le masochiste rend insupportable à son bourreau la douleur (morale, physique) à laquelle pourtant celui-ci le contraint. Et c’est sans doute à ce qu’il peut y avoir de sadique non seulement dans la relation analytique, mais encore en moi, que cette femme m’a confronté, et devant quoi j’ai reculé en lui accordant toujours plus de liberté. Je me suis identifié à ce qu’elle a fait de moi, m’étant laissé prendre au jeu, ou à l’offrande, au spectacle de sa détresse. Mon erreur fut, je crois, de me laisser prendre au fantasme que j’aurais pu être cet autre grâce à qui elle aurait pu devenir capable de se lier autrement, c’est-à-dire grâce à qui elle aurait pu devenir capable de l’aliénation ordinaire dans laquelle nous sommes tous installés. Mon erreur fut donc de laisser cette relation devenir, elle aussi, duelle. Si j’avais su reconnaître la position qu’elle m’assignait, peut-être aurais-je pu éviter de m’y identifier, et peut-être alors aurait-elle pu commencer d’inventer un nouveau type de rapport. Ma bêtise fut d’avoir voulu être plus fort qu’elle.