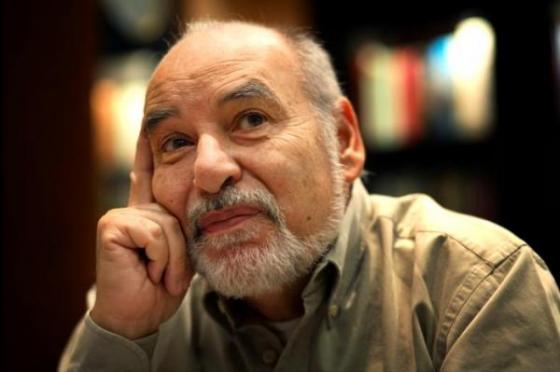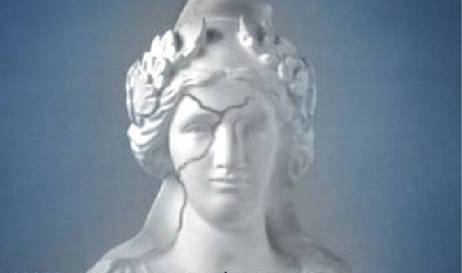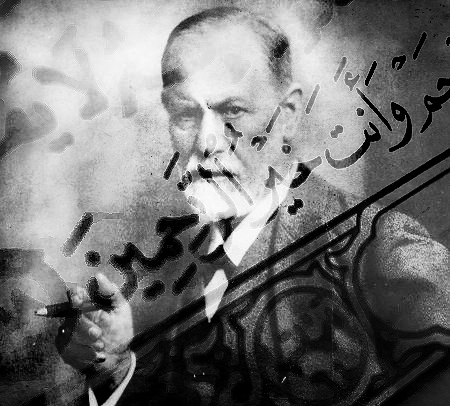Guy Scarpetta : On commémore 1492 : date, tout à la fois, de la découverte de l’Amérique, de l’expulsion des juifs d’Espagne, et de la prise de Grenade, qui acheva la « reconquête ». Comment percevez-vous cet anniversaire ?
Abdelwahab Meddeb : Il faut sans doute ajouter un quatrième événement sur lequel insiste Bernard Vincent, dans l’un des meilleurs livres parus à propos de 1492[1] : la parution de la première grammaire concernant une langue vernaculaire, qui marque d’une certaine façon la fondation du castillan, et l’intention de diffuser la langue castillane par le monde. C’est intéressant, d’ailleurs, parce que la naissance de la grammaire chez les Arabes repose sur le même type d’objectif. Comme si, dès que s’installe la vocation de l’Empire, du débordement, la grammaire devenait essentielle pour fixer la loi d’une langue destinée d’être en usage chez des locuteurs étrangers… Pour en revenir à 1492 : on ne peut pas ne pas commémorer une telle date. Il y a là une rupture à l’échelle de l’histoire universelle. Dans l’histoire juive, l’expulsion d’Espagne est un événement majeur, profondément marqué dans la mémoire. Et il en va de même pour la mémoire arabe : c’est à partir de la chute de Grenade que les Arabes vont vivre l’Andalousie comme le lieu même de la nostalgie. À partir de là, la poésie, le chant, l’esthétique de la décadence vont se fonder sur le thème de l’âge d’or perdu, incarné par la perte d’Al-Andalûs… Évidemment, en termes braudeliens, le plus important, c’est, à partir de la découverte de l’Amérique, le fait que la « capitale-monde » va déserter définitivement la Méditerranée, se déplacer vers Amsterdam, vers Londres, puis vers New York… En bref, la célébration d’une telle date est inévitable, même si on risque d’y voir triompher le point de vue des vainqueurs sur le point de vue des vaincus…
G.S. : Comment cela a-t-il été vécu dans l’imaginaire du monde arabe, jusqu’à aujourd’hui ?
A.M. : La perte d’Al-Andalûs (qui est le terme qui nomme pour les Arabes, toute l’Espagne musulmane, et pas seulement l’actuelle Andalousie) est probablement un symptôme. Un parfait exemple de ce que j’appellerais l’inconscient dans l’Histoire : ce qui échappe à la conscience, à la raison. Jusqu’à ce jour, les musulmans, les Arabes, les Maghrébins, n’ont pas compris comment l’Espagne avait pu leur échapper, alors qu’en termes proprement militaires il y avait égalité de puissance entre l’Islam et la chrétienté. Cela a donc été assimilé à une fatalité de déclin, pratiquement inexplicable, et que l’on a relié, du côté arabe, au règne des Taïfas, ces petits royaumes qui ont succédé au califat unitaire, avec Cordoue comme capitale. C’est ainsi que les musulmans imaginent l’histoire de la perte : ça a commencé avec la fin du califat omeyade, lorsqu’on est passé du califat unitaire à la division, et malgré les deux vagues, almoravide et almohade, des deux empires berbères venus du Maroc, qui n’ont pas su empêcher le processus de division. Ils n’ont fait que retarder la reconquête. C’est là que s’origine la nostalgie, et le fait que les Arabes, jusqu’à aujourd’hui, doivent affronter l’unité impossible, la division intérieure, – selon un modèle qui a déjà eu lieu, en Espagne, et qui est un peu vécu comme un cauchemar, l’un de ces rêves où l’on essaie de marcher et où l’on ne parvient pas à marcher. Cela demeure, pour le monde arabe, une sorte de mystère de l’Histoire. C’est le mauvais rêve qui hante l’imagination arabe.
G.S. : Même si 1492 représente une coupure historique, nous savons bien qu’aucune coupure n’est absolue. Il y a eu, par exemple, une présence arabo-islamique en Espagne après 1492, et aussi quelque chose d’espagnol qui s’est transféré et prolongé au Maghreb… Est-ce que cela est perçu dans le monde arabe ? Ou mieux : est-ce que cela est pensé ?
A.M. : C’est une question capitale. On peut mettre ici face à face deux impensés : quelque chose est impensé aussi bien par les Arabes que par les Européens, et c’est l’expérience d’un vécu minoritaire de l’Islam. Des deux côtés, l’Islam a la réputation de ne pas pouvoir exister en tant que minorité, d’être toujours conquérant, et donc d’avoir forcément une vocation majoritaire. Or, l’Espagne d’après 1492 est le lieu d’un début d’expérience d’Islam minoritaire, même si l’État classique n’a pas su la gouverner. Une génération après 1492, il y a eu l’obligation de la conversion : les musulmans devaient devenir catholiques ou s’en aller. Et c’est là que l’on peut situer les deux impensés, symétriques. Du côté des musulmans, tout le monde a estimé que ces conversions ne pouvaient être qu’insincères, que répondre à une stratégie de dissimulation, imposée par la situation. Il y a même eu une fatwa, décrétée par un mufti d’Oran, qui recommandait aux musulmans d’Espagne de pratiquer en secret leur croyance (la takia). Or, c’était exactement ce que pensait l’autorité catholique, et l’Inquisition, avec tout le dispositif que l’on connaît pour traquer et dénoncer les faux convertis. Par exemple, en plein mois de Ramadan, l’Inquisition demandait aux « vieux chrétiens » d’aller à midi déjeuner chez les « nouveaux chrétiens », et de préférence de partager avec eux de la cochonnaille, et du vin : ça donnait lieu à des histoires terribles, avec ceux qui ne parvenaient pas à manger, ou ceux qui mangeaient mais qui vomissaient immédiatement ce qu’ils venaient d’avaler… En somme, l’idée s’imposait, des deux côtés, que les musulmans sont « inassimilables ». Or, l’impensé, et peut-être même l’impensable, c’est qu’il y a vraiment eu des sujets musulmans qui ont choisi la terre, et qui se sont sincèrement convertis. Pour preuve : nombre de ces conversos, après avoir été chassés d’Espagne, ont préféré rester en pays chrétien, s’installer en Aquitaine, en Languedoc – certains ont même eu un destin rhénan, comme le rapporte le conte inséré à l’intérieur du Quichotte de Cervantes (l’histoire de Ricotte et de sa fille). Car il faut attendre Cervantes pour que cet « impensé » apparaisse en pleine lumière… Vous voyez, tout cela réactive des questions très contemporaines. Aujourd’hui, de façon peut-être moins aigue, en dehors des structures de l’Inquisition, et avec l’immense acquis de la tradition démocratique dans un pays comme la France, la question de l’Islam se repose malgré tout dans des termes très proches. L’Islam peut-il être minoritaire ? Peut-on entrer dans une expérience où l’Islam serait seulement intérieur au sujet, ne concernerait que la croyance, l’expérience spirituelle, la culture, et serait dissocié de la question du Droit qui gère la cité ? Face à tous ceux (aussi bien l’extrême-droite française que les intégristes musulmans) qui déclarent l’islam inassimilable par nature, il importe de revenir archéologiquement sur cette période de l’après-1492. Et sur cette expérience islamique interne à l’Europe où des sujets musulmans ont tenté de vivre sous l’autorité d’un État étranger à la loi islamique… Quant à la façon dont l’Espagne s’est transférée au Maghreb : ça c’est d’une importance extraordinaire. Et ça ne concerne pas seulement le Maroc qui est un prolongement naturel de l’Espagne. En Tunisie, par exemple, il y a eu toute une série de vagues d’immigration andalouse, qui a commencé dès la chute de Cordoue. Le fameux historien Ibn Khaldûn (XIVe siècle), par exemple, est né à Tunis, mais d’une famille originaire de Séville. Après 1610, c’est-à-dire après l’expulsion des derniers moriscos, on a même créé, à Tunis, qui était à l’époque sous administration turque, un ministère spécial pour recevoir les Andalous – l’État sentait qu’en les accueillant, il injectait de la civilisation. Ces musulmans d’origine andalouse ont toujours eu le sentiment de provenir d’une civilisation supérieure, d’appartenir à l’élite, et aujourd’hui encore c’est un signe de distinction que d’avoir cette origine-là… Cette présence andalouse, on la retrouve encore à Tunis ; beaucoup de noms de familles signalent une origine castillane, cordouane, grenadine, etc. Une des plus belles rues de la médina de Tunis s’appelle la rue des Andalous. Tunis avait en outre accueilli des artisans moresques qui avaient reconstitué l’ensemble de la chaîne de l’industrie de la chéchia (ces calottes en feutre) : des plantations agricoles à la fabrication et la commercialisation internationale.
G.S. : Et dans la culture ?
A.M. : La musique dite « arabo-andalouse » vient de là… Et cela concerne la mémoire poétique aussi. Par exemple, ces deux formes prosodiques qui proviennent de la tradition arabe créée dans Al-Andalûs, le mowachah et le zajal : ces propositions de poèmes strophiques, chantés, avec un refrain, et un système de métrique et de rimes qui changent de strophe à strophe, et qui rompent avec l’ode arabe monorime… Telle est la tradition qui vient d’Al-Andalûs, et le corpus est resté vivace dans tout le Maghreb – avec des différences d’écoles très nettes, selon les lieux (il y a des écoles de musique andalouse à Rabat, à Tlemcen, à Fez, à Alger, à Béjaia, à Tunis, qui diffèrent sensiblement), mais à partir d’un tronc commun directement venu d’Espagne, à moins que ces différences n’enregistrent des variables marquant déjà les écoles en Espagne. Cette influence est même sensible dans le monde paysan. Les Andalous, qui étaient des grands maîtres de la culture irriguée, se sont installés en Tunisie le long de la Medjerda, et aujourd’hui encore, lorsqu’on se rend dans ces gros bourgs prospères, fondés sur la culture maraîchère, on se trouve dans des villages qui ressemblent aux villages espagnols : non seulement les murs blanchis à la chaux (ce qui est commun à tout l’espace méditerranéen), mais les toits en pente, et couverts de tuiles… Tenez, un emblème de cette présence, ou de cette influence : nous avons, à cent kilomètres de Tunis, dans un de ces gros bourgs (Testour), à l’intérieur de la grande mosquée, un mihrab baroque ! Avec cet élément typiquement baroque qu’est le fronton triangulaire brisé couronnant la niche…
G.S. : Revenons, si vous le voulez, à l’Espagne d’avant 1492, à Al-Andalûs, au califat de Cordoue… On en parle parfois comme d’un âge d’or où les trois civilisations du Livre coexistaient, et même se fécondaient, s’interpénétraient, se métissaient… S’agit-il d’un mythe ?
A.M. : C’est devenu un mythe, mais bien évidemment fondé sur des éléments de réalité. Au fond, je crois que c’est quand les gens sont en posture d’Empire, quand ils se sentent assez souverains, qu’ils acceptent l’altérité. La langue arabe, à l’époque, était non seulement la langue du pouvoir, mais aussi celle du savoir, de la pensée, et toutes les forces vives, culturelles, intellectuelles, s’exprimaient en arabe, au-delà des croyances de chacun… Mais le vrai mélange a eu lieu avec l’affaiblissement du pouvoir islamique ; quand les frontières fluctuaient, la circulation des sujets s’intensifiait. À ce moment, naquit l’art meidéjar qui est l’art métissé par excellence.
G.S. : On sait assez peu que Maimonide, le grand philosophe juif de Cordoue, écrivait en arabe…
A.M. : Et possédait la même méthode que les penseurs arabes qui consiste à accorder « l’instrument » grec aux Écritures. Cette situation est assez proche, d’ailleurs, de ce qui s’est passé à l’autre grand moment de la civilisation islamique, celui du califat de Bagdad. Pensez à ce fameux rêve d’El Mamoûn (début du IXe siècle) où apparaît Aristote, et où El Mamoûn dialogue avec lui pour savoir ce qui mène le mieux au Bien suprême, la raison ou la religion, et finit par conclure que les deux y conduisent… On a là l’un des fondements de la pensée arabe ultérieure, et précisément dans une civilisation elle aussi « ouverte », avec des influences grecques, persanes, indiennes… En Espagne, c’est tout à fait clair : entre les chrétiens, les juifs et les musulmans, il y avait non seulement des contacts, mais des débats, des échanges spirituels ou intellectuels. C’est ce que relatera, plus tard, en catalan, le fameux livre de Ramon Lulle, sur la rencontre des trois sages, représentant chacune des trois civilisations du Livre… De tels débats, où chacun était hautement respectueux de l’autre, ont réellement eu lieu, et fréquemment. Mais l’exemple venait de Mésopotamie, comme en témoigne, au IXe siècle, un voyageur andalou, musulman, qui avait été très impressionné par ce type de débat, auquel il avait assisté, à Bagdad – et qui rassemblait, lui, non seulement les gens du Livre, mais aussi des athées, des mazdéens, et des zoroastriens… II raconte la déférence extraordinaire qui régnait dans ces discussions, ou lorsqu’un grand penseur ou théologien arrivait, quelle que soit sa foi ou sa tendance, tout le monde se levait… En fait, le fanatisme, qui refuse le moindre écart et le sanctionne, n’a rien à voir avec ces grands moments de la civilisation islamique, où le pouvoir se sentait stable, assuré. Je l’interpréterais plutôt comme la posture des faibles, la posture du déclin.
G.S. : Vous parliez de cette tradition islamique interne à l’Europe. Difficile, ici, de ne pas penser à des penseurs considérables de l’Espagne musulmane, comme Averroès, sans lesquels on ne peut guère comprendre l’évolution de la pensée occidentale elle-même (puisque c’est à travers lui qu’Aristote a été réintroduit)… Pourquoi est-ce que la culture officielle, scolaire, leur accorde si peu de place ?
A.M. : Si les Allemands ont travaillé, depuis Hölderlin, sur la nécessité d’être dans la technique tout en ravivant l’origine oubliée (les pré-socratiques) – il importe, pour nous, de raviver cette autre origine oubliée, ce « chaînon manquant », dont l’Espagne musulmane fut le site. Ce qu’il faut comprendre, ici, et Renan l’explique très bien, c’est la raison du discrédit d’Averroès en Occident. En fait, autant Averroès a été un novateur, autant les écoles averroistes, très vite, sont devenues des lieux d’académisme, conservatrices, figées. C’est tout le sens de la fameuse polémique de Pétrarque contre l’université de Padoue, qui demeura fidèle à l’averroisme jusqu’au XVIIe siècle. D’où l’idée, à la Renaissance, selon laquelle il fallait revenir à la lettre, au texte grec, pour restaurer l’Aristote authentique, que les Arabes auraient « trahi ». Cette lutte contre l’averroisme a sans doute été nécessaire dans l’évolution de la culture occidentale. Mais aujourd’hui, avec le recul, nous pouvons aborder cet héritage plus sereinement. Voir, par exemple, comme Avicenne aura fait se redéployer l’aristotélisme en son époque ; c’est chez lui, en particulier, que l’on trouve l’un des fondements de la philosophie occidentale, la distinction entre l’essence et l’existence, qui, au sens strict, n’est pas grecque… La philosophie allemande a inventé le « miracle grec ». Il serait temps d’inventer aussi le « miracle andalou ». Ce miracle a eu lieu. Et ce n’est pas seulement un mythe, c’est aussi quelque chose de fondamental, pour nous, aujourd’hui. Quelques éléments le signalent, scénographiquement : je pense au livre d’Henry Corbin sur Ibn Arabi, et à la rencontre, dont il traduit la relation, entre Ibn Arabi et Averroès. Rencontre hautement emblématique, entre le « second Platon » et le « second Aristote », où sont à l’œuvre, schématiquement, les deux grandes polarités de l’esprit : la raison, la technique, d’un côté, et de l’autre l’idéalisme, la spiritualité… À travers ces deux grands Andalous, en langue arabe, c’est le grand débat du monde et du ciel qui s’incarne…
G.S. : J’ai envie d’actualiser un peu tout cela. Est-ce qu’aujourd’hui, alors que nombre d’enfants d’immigrés arabes vivant en France perçoivent leur « double culture » comme une déchirure, il ne serait pas extrêmement utile de populariser cette dimension islamique à l’œuvre dans l’histoire de l’Occident ? De raviver la mémoire de ces zones de contact et d’interprétation ?
A.M. : Sans aucun doute. Il y a toujours un va-et-vient dialectique entre l’universalité de l’Unique et la particularité, la différence. Aujourd’hui, en Occident, on a trop tendance à considérer l’Islam du côté de la « différence » – il faudrait rappeler qu’il a procédé de l’universalité, et qu’il y a en lui des éléments très proches de la culture occidentale. L’intégrisme procède aussi du rejet occidental. Si la référence islamique était intégrée dans sa dignité, il y aurait le démantèlement d’un argument majeur de ce prurit identitaire qui s’exprime de nos jours à travers l’intégrisme islamique. J’évoquerai quelques exemples simples. Chaque fois que je me retrouve sur les rives de la Méditerranée, du Nord au Sud, j’emprunte le regard que m’a rapporté un visiteur japonais. Sa radicale différence l’amène à percevoir l’unité des formes et des structures. Pour lui, il est évident qu’il n’y a pas de différence majeure entre un palazzo italien fondé sur le cortile, et une maison arabe fondée sur les mêmes principes, utilisant les mêmes éléments. On pourrait évoquer aussi l’exemple des bains arabes. Certes, ces bains, dans la cité islamique, avaient un rôle particulier, lié à des raisons rituelles, de purification. Mais de fait, architecturalement, c’était une pure et simple reprise des thermes romains, avec la même division tripartite ou quadripartite… J’aime bien réfléchir à partir de l’architecture, dont Viollet-le-Duc disait qu’elle était le « miroir de l’idéologie »… Prenez le cas de Brunelleschi, de la réflexion qu’il a engagée à partir de l’articulation entre le cube et la demi-sphère, telle qu’elle a pu se déployer dans la sacristie de San Lorenzo, ou dans la Chapelle des Pazzi, à l’extérieur de Santa Croce ; eh bien, trente ou quarante ans auparavant, il y avait une mosquée, à Bursa, la Mosquée Verte, qui n’était rien d’autre qu’un emboîtement d’une série de cinq ou six espaces répondant à la même problématique architecturale…
Il y a donc une solidarité entre le monde islamique et l’Occident, beaucoup plus importante qu’on ne le croit généralement. Ainsi, il est absurde de parler de « science arabe » et de « science occidentale » : la science obéit à la même diachronie. Elle a été d’abord grecque, puis latine, puis arabe (le développement de la mécanique, de l’astronomie, de l’hydraulique, de l’optique), avant de devenir occidentale… Et l’on pourrait presque dire la même chose des diachronies mystiques… Le cas d’lbn Arabi est ici tout à fait passionnant. C’est l’une des thèses majeures du livre d’Acin Palacios : entre les Pères du Désert, dans la tradition chrétienne, et les deux grands mystiques de la Contre-Réforme (Jean de la Croix et Thérèse d’Avila), il y a une sorte de vide, de trou vertigineux. Eh bien il suffit de placer Ibn Arabi à cette place-là, et il n’y a plus de trou. Le relais se fait. C’est le chaînon manquant. On touche ici, évidemment, un immense problème, car on n’a aucune trace des traductions d’Ibn Arabi, et de la façon dont son œuvre s’est propagée (contrairement à Averroès, dont on peut suivre la transmission dans ses moindres détails). Mais il n’en reste pas moins qu’lbn Arabi a déployé une forme de mystique (à la fois expérience et spéculation) qui se prolongera chez les deux Espagnols. Et qu’on trouve, souvent, des proximités étonnantes. Par exemple, sur la question du corps, et même de la jouissance. Chez Ibn Arabi, la jouissance féminine dans le coït devient le support de l’épiphanie, ce qui n’est évidemment pas sans évoquer la façon dont Thérèse d’Avila relate ses « extases », celle-là même qu’a matérialisée le Bernin. Ou encore, on trouve chez Ibn Arabi dans le même texte une alternance entre la poésie et la prose (le poème condense, cristallise, tandis que la prose se déploie en argumentaires et en commentaires) que l’on retrouvera chez Jean de la Croix.
Il y a un autre texte majeur d’Acin Palacios où il évoque les interférences entre Ibn Arabi et Dante. Cette conception dantesque de l’imagination comme l’espace qui accueille la vision, et qui par là même devient moyen de connaissance, à l’opposé de tout l’appareil aristotélicien – eh bien, cela a été théorisé admirablement par Ibn Arabi… Le plus étrange ici, c’est qu’on peut repérer des rapprochements, des similitudes, des influences, mais qu’on a aucun signe, aucun indice de transmission, aucune trace, par exemple, de traduction d’Ibn Arabi en latin ou en quelque langue « romane ».
G.S. : Il y aurait évidemment là tout un pan de l’histoire à désenfouir, concernant ces interprétations, ces zones de contact… Je pense, aussi, à la façon dont l’Espagne musulmane a pu influencer certains aspects de l’art roman français (il suffit d’aller se promener du côté de Poitiers, où l’on a prétendument « arrêté les Arabes » : c’est frappant) ; ou encore à la façon dont le zajal, dont vous parliez, a pu trouver une transposition presque directe dans l’art des troubadours (Guillaume de Poitiers, Rimbaut de Vacqueyras, Bertrand de Born, Bernard de Ventadour). Tout cela est généralement occulté dans l’histoire française officielle… Mais qu’en est-il du côté arabe ? Assiste-t-on, pour des raisons inverses, mais symétriques, au même type de refoulement ?
A.M. : L’oubli est grand, aussi, du côté arabe. Au fond, si l’on assiste à cette diffusion de l’intégrisme dans les têtes, c’est en très grande partie dû à cet oubli. Car si l’on s’accroche stricto sensu à la Loi Islamique dans sa « pureté » – c’est toute la culture arabe qui disparaît. Tout ce qui s’est fait de grand dans la culture arabe est non canonique. Tenez, j’ai travaillé récemment sur un poète andalou, musulman, du XIIIe siècle, né près de Séville et mort près d’Alexandrie, à Damiette, qui s’appelle Chouchtari… Eh bien, ce poète a osé, par exemple, pousser la métaphore bachique jusqu’à ses extrêmes aboutissements, alors qu’il appartient à une religion qui interdit l’alcool… Derrière la précaution, ou la clause de style, qui consiste à avertir que le vin dont il parle n’est pas le vin réel, pas le fruit de la vigne, il y a chez lui tout un dispositif assimilant le vin profane à l’extase spirituelle. Souvent, dans la poésie arabe profane, on va boire du vin chez le chrétien, ou chez le juif, parce que, pour eux, le vin est licite. Lui, il va plus loin : il hante les celliers des couvents… Il y a un poème très significatif où on le voit pénétrer dans un couvent, assister à une cérémonie, décrire les chants, la procession de croix, l’extrême beauté des images ; personne ne le reconnaît pour un musulman, on le prend pour un moine chrétien. Et puis, lorsqu’on s’aperçoit qu’il est étranger, il dit qu’il est venu là pour le cellier. S’ensuit tout un marchandage, les moines lui disent que le vin est très cher, il discute le prix… Finalement, il ne va pas jusqu’au bout de la transgression, il revient à son Coran. Mais ce qui fait tout l’intérêt du poème, c’est qu’on y sent une véritable tentation, et même une reconnaissance très profonde de la valeur symbolique du vin pour les chrétiens, liée au dogme de l’Eucharistie… On voit très bien jusqu’où peut aller, en plein XIIIe siècle, le vacillement des préjugés…
En bref, l’oubli de ce type de contact existe aussi du côté arabe, et c’est terrible. Je suis persuadé qu’un des moyens d’atténuer les tensions entre le monde arabe et l’Occident européen serait de restaurer, pour les sujets arabes, cette scène commune. Il faudrait rappeler aux Arabes que cette scène commune a eu lieu (notamment en Espagne, avant 1492), et qu’il n’y a aucune honte pour eux à s’ouvrir aux autres mondes… Peut-être que la guerre du Golfe aura été, pour les Arabes, le dernier avatar de l’impossibilité de constituer leur propre horizon. Ils ont aujourd’hui un horizon qui est l’horizon du monde, auquel ils ont participé autrefois, glorieusement, et auquel ils devraient pouvoir participer de nouveau la tête haute, sans renier les traces qui sont les leurs. Tout mon travail d’écrivain et de poète consiste à fertiliser cette trace qui a circulé dans un espace commun.
G.S. : Le programme, donc, serait pour l’Occident de se réapproprier cette dimension islamique de sa propre histoire, et pour le monde arabe de se réapproprier la part d’Europe présente dans son expérience propre ?
A.M. : Tout à fait. Et ça peut avoir une portée politique considérable.
[1] Bernard Vincent, 1492, l’Année admirable, Aubier éd., Paris, 1991.