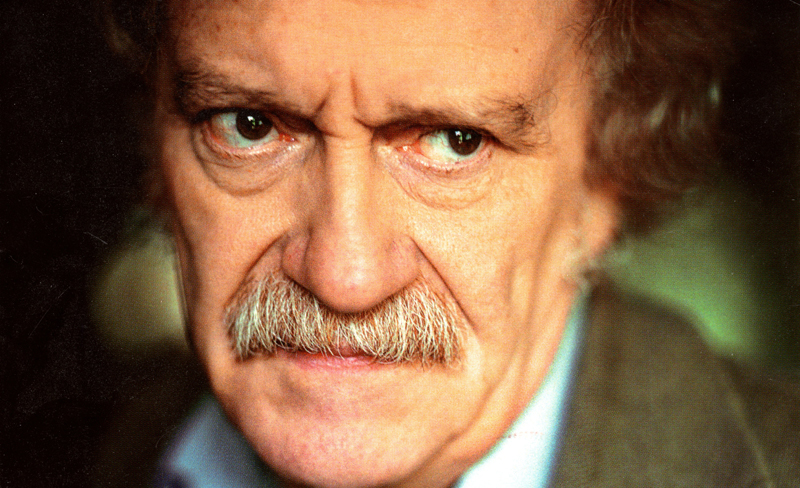Comment naissent et déclinent les genres littéraires ? Outre les dynamiques strictement historiques, l’idée est répandue qu’ils apparaissent ou disparaissent en miroir des sociétés où ils font irruption, comme si leur devenir épousait au gré des siècles l’évolution de la conscience humaine.
Des légendes ancestrales à la bande dessinée, de la Bible aux autofictions contemporaines, une normativité souterraine travaillerait la création littéraire : écrire pour répondre à l’appel de son temps. Dans ce primat qu’aurait le monde sur sa représentation, la forme serait elle-même une question de fond. On n’écrit jamais de « livres » en soi, car ces derniers ne procéderaient pas d’une essence unitaire, mais toujours des types de livres : des tragédies en alexandrins, des poèmes en vers libres, des romans de mœurs, des mémoires aristocratiques, des chansons de geste ou des drames sociaux. Autant de textes codifiés, façonnés, modelés selon des paradigmes en vigueur, dont la structure contiendrait déjà, sinon une doctrine ou une « hypothèse substantielle » (Thomas Pavel), du moins une pré-vision du monde.
Georg Lukács a montré par exemple, dans le cas du roman, que ce genre hybride était né d’une triple cassure : entre le moi et le monde, l’intention et l’intuition, le signe et le sens. Contrairement à l’épopée, qui chantait la trajectoire de héros occupant une place bien définie, à l’image d’un cosmos harmonieux et finalisé, bâti pour que l’homme y réside au sein de la nature – contrairement à cette unité primitive entre l’âme et les choses, qui engendra les poèmes vigoureux des Antiques, le roman apparaît comme une prolongation en prose de l’esprit élégiaque. Ce qu’il signalerait par son existence même ? Le désenchantement collectif d’une existence apprenant à perdre ses idoles. Si bien que tous les romans pourraient, d’une manière ou d’une autre, porter le nom des « illusions perdues ».
On pourrait, dans cette perspective, esquisser à grands traits l’histoire d’une littérature dont les modes, les progrès, les marasmes et les avancées suivraient les étapes d’une autre dialectique : celle des époques où les textes prennent place. Des mentalités dont ils deviennent, qu’ils le veuillent ou non, les étendards ou les porte-drapeaux. Des goûts qu’ils cristallisent. Des tendances qu’ils reflètent. En somme des générations qu’ils incarnent à leur corps défendant, même quand ils pensent s’adresser à la postérité.
Il serait ainsi tentant, dans cette logique, de livrer un pronostic sur les temps présents et à venir : quel serait le genre par excellence du monde d’aujourd’hui ? Or, sur ce point, le bât blesse et la théorie d’une littérature réfléchissante est bien forcée de rendre les armes devant une objection de taille. Car notre époque est marquée par une contradiction massive. D’un côté, elle semble marquée par une accélération de nos modes de vie : accélération des transports, de l’information, des outils de communication, des innovations techniques et des actualités. Ce phénomène, couplé au passage de la « graphosphère » à la « vidéosphère » (Debray) – une structuration de la société où l’image se substitue au texte –, s’inviterait jusque dans nos consciences. Dès lors que nous passons plusieurs heures par jour à scroller sur les réseaux sociaux au lieu de lire, notre capacité de concentration s’amenuise continuellement. Diminution qui se répercute inévitablement sur notre rapport aux livres : même si nous nous efforçons de nous plonger dans Balzac ou Proust, le rythme de leur style emmailloté d’échappées indolentes demeurera trop lent, trop complexe, trop diffus pour nos esprits hyperactifs et drogués aux hashtags. On pourrait donc naturellement imaginer que, dans notre « civilisation du poisson rouge » (Bruno Patino), nous assistions à un essor des genres les plus courts : poésie contemporaine, haïkus en langue française, recueils d’aphorismes – et que nous observions, dans le champ du récit, un retour triomphal de la nouvelle. Or, tous ces genres, qui ont naguère été florissants dans la société française, ont connu au XXIe siècle un net recul auprès du grand public. S’il existe incontestablement des poètes et des nouvellistes importants, si certains rencontrent un certain succès populaire et commercial en plus de leur reconnaissance critique, il n’en reste pas moins qu’ils ne connaissent pas le triomphe d’un Aragon, d’un Morand ou d’un Scott Fitzgerald. Nous sommes loin du temps où la parution d’un court récit de Madame de La Fayette ou d’un recueil de nouvelles préfacé par Proust pouvait être considérée comme l’événement littéraire de l’année, voire de la décennie. Dans un pays où ces genres ont connu leurs heures de gloire, la nouvelle et le poème semblent être devenus des passions d’initiés. Paradoxe d’autant plus frappant que de son côté, le roman-fleuve se porte plutôt bien. Loin d’avoir été menacé par l’accélération générale, il continue, année après année, de s’affirmer comme un format moderne.
D’où cette contradiction entre le rythme de nos vies et celui de nos lectures. Plus notre société pourchasse la vitesse dans son agitation quotidienne et son rapport au monde, moins elle la privilégie quand elle se préoccupe de littérature. L’écriture ralentit à mesure que l’époque accélère.
On peut s’émerveiller d’un tel désaxement.
Y voir une ruse de l’Histoire.
Déceler dans cette syncopation la marque de cette éternité intérieure de la littérature, la signature même de son écriture : sa faculté de résonner à contretemps de la réalité.
Mais on peut également songer à cette autre bataille : outre l’aspiration à la perpétuité des lettres, le combat pour leur universalité. Pour cette liberté qui devrait être reconnue comme inaliénable, le droit d’aimer vivre de mots. La possibilité, pour chacun, d’apprendre à voyager à travers l’écriture.
Sous cet angle, le décalage entre la littérature contemporaine et l’accélération du monde se révèle sous un jour moins favorable : n’a-t-il pas fait fuir quantité de lecteurs en puissance vers les séductions de la vidéosphère ? Tous ces jeunes ou moins jeunes qui ont déserté les livres au profit des écrans, comment les reconquérir ? En commençant, peut-être, par les écouter. Leur demander d’où leur vient cette désaffection pour la littérature. Pourquoi lui préfèrent-ils ces autres formes d’évasion virtuelle et de divertissement que constituent ici les jeux vidéo, là les reels d’Instagram ou les tweets à gogo ? En les écoutant donc, sans mépris, leur dire que les romans, avec leurs descriptions interminables et leurs digressions volubiles, parlent d’un monde qui ne leur parle plus. Un monde trop bavard et pas assez rapide. Un monde qui, par son rythme même, se situe aux antipodes de la modernité.
Ce babil méprise en apparence notre passion pour les livres. Il se peut pourtant qu’il contienne son éloge le plus franc. Car qu’est-ce que la littérature, sinon un art où l’écriture n’a de sens qu’à condition de se vivifier continuellement – et donc de se compromettre : de quitter ses zones de confort chaque fois qu’elle éclot, toujours identique car sans cesse en mouvement ? Qu’est-ce que la littérature, sinon une destitution perpétuelle des formes qu’elle revêt ? Sinon la trahison systématique de ses automatismes ?
Nous pourrions ainsi imaginer une littérature anté-moderne, plus moderne encore que la modernité du monde, dont l’engagement premier serait de se défendre elle-même en prenant de l’avance sur les temps contemporains : veiller à ce que l’écriture continue à exprimer l’éternelle variation de l’existence humaine.
Dans cette littérature, la nouvelle occuperait, comme le poème en prose, un poste d’avant-garde. À l’image de l’ère actuelle, un siècle de bavards en surchauffe où la saturation du langage répond à leur obsolescence, cette dernière se caractérise moins par sa concision que par son rythme : l’écriture n’y est plus que vitesse. Contrairement aux idées reçues, la nouvelle ne saurait être définie comme un court récit – certaines comptent plus de pages que tel ou tel roman –, puisqu’elle se démarque avant tout par la manière dont le temps s’y rétracte. Dans une nouvelle, l’auteur ne respire pas. En cela, il serait erroné de percevoir la nouvelle de façon négative, comme un moindre roman. Elle incarne au contraire un précipité de prose. Un récit captant directement et en instantané la substance de l’histoire qu’il raconte. Une « notation » à l’état pur (Barthes) sans cette « ductilité » (Segalen) qui l’étirerait pour lui donner du corps. La nouvelle, précisément, n’a presque pas de corps. Avec elle, l’écriture se condense avant de s’envoler.
N’oublions pas ce qu’en disait Baudelaire, éminent penseur de l’intimité qui se tisse entre la poésie et la modernité, dans sa préface aux Nouvelles Histoires extraordinaires de Poe. Dans ce texte méconnu, il rend hommage à ce genre souvent méprisé par certains de ses contemporains, affirmant même que la nouvelle est supérieure par bien des aspects à son rival du moment. « Elle a sur le roman à vastes proportions cet immense avantage, soutient-il, que sa brièveté ajoute à l’intensité de l’effet. Cette lecture, qui peut être accomplie tout d’une haleine, laisse dans l’esprit un souvenir bien plus puissant qu’une lecture brisée, interrompue souvent par le tracas des affaires et le soin des intérêts mondains. » Son apologie va même plus loin, lorsqu’il compare la nouvelle à un genre qu’il situe au sommet de l’art : la poésie elle-même. Certes, reconnaît-il, rien n’égale la manière dont cette dernière est rythmée tout entière pour qu’y germe le sentiment d’une perfection esthétique. L’émergence de la beauté est son « but » premier, qu’aucune forme d’écriture ne parvient à atteindre avec autant de grâce. Mais justement, cette téléologie est tellement contraignante qu’elle conduit à sacrifier d’autres richesses littéraires. Elle écarte tout d’abord une « multitude de tons, de nuances de langage », à l’instar des registres sarcastiques ou humoristiques qui, peu propices au lyrisme, représentent des « dissonances », voire des « outrages » envers « l’idée de beauté pure ». Mais, obnubilée par la quête du beau, elle néglige aussi le souci de vérité.
Cette exigence, soutient Baudelaire, seule la nouvelle s’en préoccupe à sa juste mesure. Taillée comme un poème, vive et preste, dénuée d’ornements superflus, elle va à l’essentiel de ce qu’elle signifie. Par-delà la liberté stylistique que ce genre a toujours garantie, il y a, suggère l’admirateur de Poe, une droiture fondamentale de la nouvelle – droiture dans les deux sens du terme, moral et géométrique. Un désir de dire son fait au monde, et de l’exprimer sans détour. L’écriture s’y montre-t-elle réductrice ? C’est le risque de l’exercice, pouvant conduire à rogner les nuances, à lisser les aspérités de l’existence pour qu’elle soit contenue dans l’espace du récit. À ce danger répond toutefois la possibilité d’une narration libérée du bla-bla qui, tout en relatant une histoire, ne cesse de s’épurer, pour atteindre ce degré d’efficacité que seul un aphorisme oserait revendiquer. On aurait tort de voir dans cet esprit de simplicité la marque exclusive d’une économie de moyens, comme si les nouvellistes étaient des avares littéraires ; il traduit, derrière son austérité de façade, l’ambition d’intensifier les effets qu’il suscitera. Un minimum de moyens pour un maximum d’effets, telle est la définition que donnait Leibniz de la perfection.
D’où notre conviction, qui tient du vœu autant que du pari : et si la nouvelle était le genre du siècle ? « Le genre du siècle », ce génitif mériterait d’être entendu dans toutes ses résonances. Un génitif subjectif, indiquant que la frénésie permanente de notre siècle y trouverait sa forme naturelle. Un lien organique se tisserait entre notre époque en surchauffe et le souffle de ce genre lui-même hyperactif, comme si la nouvelle constituait l’équivalent de son corps de langage. Mais, puisque nous avons exprimé quelques doutes quant à cette conception même de l’histoire des lettres, c’est surtout au sens du génitif objectif qu’il faudrait prêter attention. La nouvelle, dès lors, se manifesterait comme une modalité d’écriture destinée à retrouver le siècle. À lui faire renouer avec la lecture quand il tend à la délaisser. À le réconcilier, surtout, avec la dimension littéraire qu’il recèle à son insu.
Persuadés que ce genre n’a pas dit son dernier mot, nous avons souhaité consacrer ce dossier à la nouveauté de la nouvelle. Nos contributeurs avaient carte blanche pour s’approprier ce genre comme ils l’entendraient. On verra, dans les pages qui suivent, la nouvelle s’éparpiller dans toutes les directions. On l’observera s’approprier des langages bariolés, tantôt académiques et tantôt argotiques, emphatiques ou tranchants, candides ou cyniques. On la lira explorer des thématiques diverses : les miracles de la transmission, l’ubérisation des tueurs à gages, le harcèlement scolaire, un pèlerinage sur les pas de Sholem Aleichem, l’empreinte d’un vers d’Apollinaire, le primat de l’imaginaire sur la réalité, les angoisses et les charmes de la recherche universitaire, les affres d’un amour qu’on ne peut oublier ou encore la licence post-adolescente des étés étudiants. On remarquera que, loin de simplifier le tissu du réel, cette écriture véloce en restitue les lumières et les ombres dans leur complexité.
Une dernière arrière-pensée a présidé au choix de ce dossier. À La Règle du jeu, nous savons d’expérience que les revues littéraires sont des laboratoires. Des romans y germent. Des textes y paraissent qui, semblant achevés sur le moment, deviendront plus tard les brouillons d’œuvres en gestation. Des romans y naissent, déguisés en billets – ou parfois en nouvelles… Il arrive que des styles s’y construisent, encore inchoatifs et parfois balbutiants. Il se peut, autrement dit, que la nouvelle soit une porte d’entrée vers une œuvre future. Une introduction pratique à la littérature.