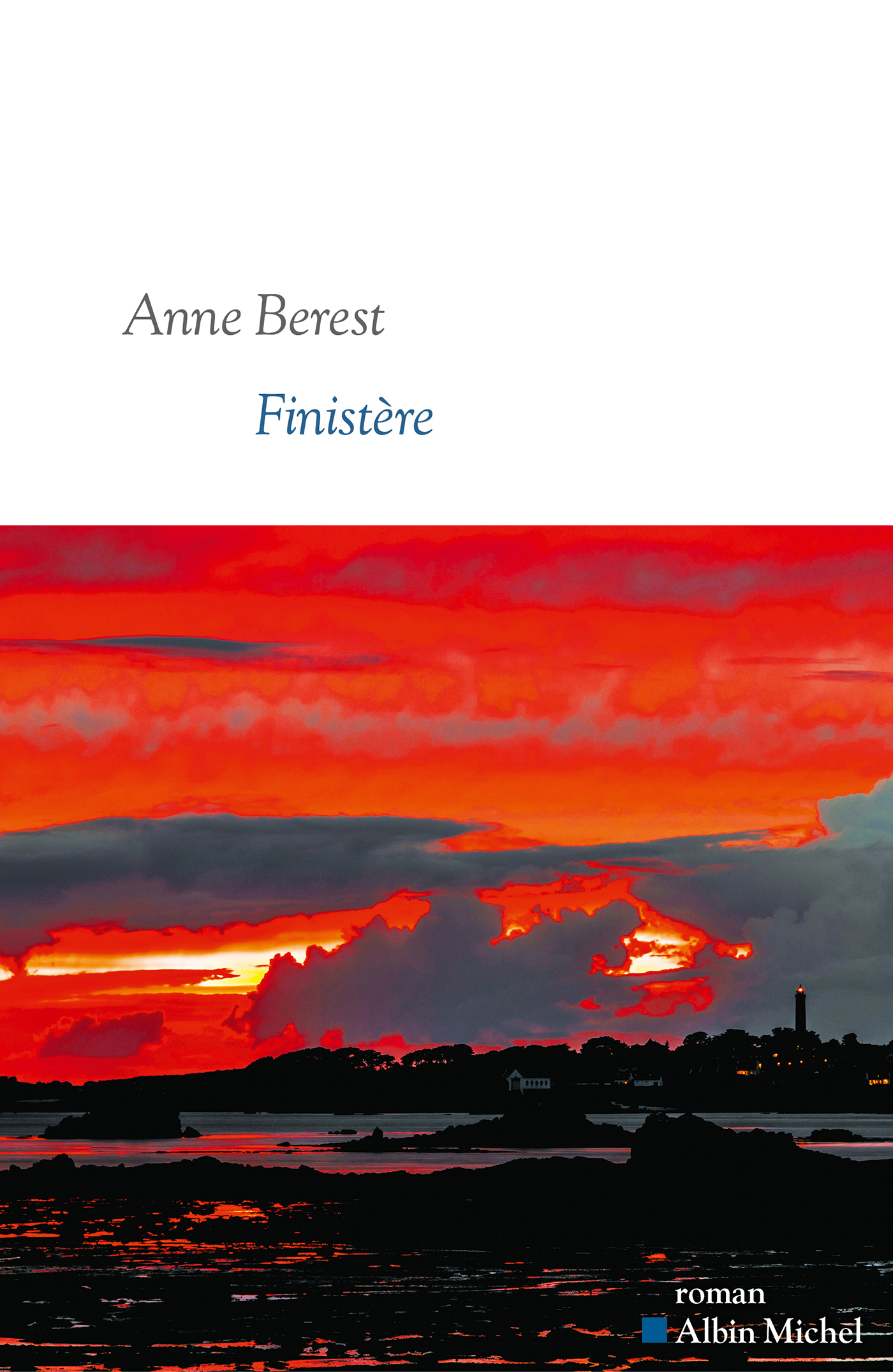La première fois que j’ai entendu les mots d’Anne Berest, ce n’était pas dans un livre mais lors de sa participation à La grande librairie. Elle a terminé l’émission en dévoilant un texte inédit qu’elle avait écrit. Il y était question d’interroger ceux qui se trouvent à côté de nous, de tirer le fil de leurs vies, de leurs rencontres, de l’intime, et d’y trouver, peut-être à l’intérieur, sa propre histoire.
Un an plus tard, j’ai lu Sagan 1954 et j’ai été surprise, non pas par l’allure que prenait la vie de Françoise Sagan lors de la publication de Bonjour tristesse, mais par l’élan que Françoise Sagan donnait à Anne Berest. Pour la première fois, j’ai compris que les mots, lus, écrits peuvent créer une forme de mouvement, donner une impulsion physique. Quelques mois plus tard, j’ai croisé Anne Berest lors d’un événement autour d’un prix littéraire et j’ai balbutié que j’avais été très touchée par La fille de son père. Étonnée que je lui parle de son premier roman, elle m’a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai répondu que j’étais étudiante en lettres. Peut-être ressentait-elle cette inquiétude pour l’avenir, propre à une jeune femme de vingt ans qui étudie une discipline aussi riche que béante ? Elle m’a pris les mains, les a serrées fort dans les siennes, elle m’a regardée et, avec un grand sourire, m’a lancé: « Tu verras, je suis sûre qu’il y a des choses merveilleuses qui t’attendent ! »
Dix mois plus tard, je suis allée voir un documentaire autobiographique au cinéma. Coïncidence : Anne Berest y figurait. Furtivement, on voyait quelques vidéos d’elle à mon âge. Elle paraissait sûre d’elle et désorientée, audacieuse et trouble. C’est alors que j’ai compris pourquoi elle avait serré si fort mes mains dans les siennes, et le sens de ce qu’elle m’avait dit.
Pendant trois ans, Anne Berest m’a guidée. Aujourd’hui, elle revient sur la scène littéraire avec un roman sur son père, et c’est à moi de l’interroger, de tirer le fil de sa vie, de ses rencontres, de l’intime – et d’y trouver, peut-être à l’intérieur, ma propre histoire.
Entretien avec Anne Berest
Vous avez commencé par écrire de la fiction, puis, avec La carte postale, vous avez mené une enquête sur la famille de votre mère ; et dans Finistère, vous évoquez sans détour votre père. Est-ce l’aboutissement d’un processus ?
J’ai commencé un cycle qui, pour moi, est le cycle du roman vrai avec Gabriële. Avant La carte postale, avant Finistère, j’ai écrit avec ma sœur ce livre sur notre arrière-grand-mère et notre arrière-grand-père, le peintre français Francis Picabia et sa femme Gabriële Buffet-Picabia. Et là, j’ai eu une sorte d’épiphanie : j’ai compris qu’écrire sur mes ancêtres était mon lieu d’écriture et que j’étais rentrée dans ce que j’appelle « mon pays d’écriture ». J’étais comme un musicien qui soudain comprendrait, entendrait qu’il joue juste. Jusque-là, je n’avais écrit que de la pure fiction – même si, bien sûr, la pure fiction, au fond, n’existe pas, parce qu’on y met beaucoup de soi-même. Mais en parlant de mes ancêtres, une bascule s’est produite et j’ai entamé un dialogue avec les morts ; j’ai ressenti une si grande connexion avec eux que mes personnages m’ont semblé être dans une vibration ; j’ai éprouvé quelque chose de très vivant qui est devenu fécond dans mon écriture. Et à partir de là, j’ai eu une vision de mon arbre généalogique formant une sorte de pilier d’une œuvre dont chaque branche allait être un livre ; et tous les livres que j’allais écrire jusqu’à la fin de mes jours seraient des morceaux de cet arbre généalogique. Un projet d’une clarté absolue s’est donc mis en place.
Quand on lit Finistère, on sent chez vous, à la vingtaine, une grande effervescence propice à l’écriture. Pourtant, vous avez publié votre premier roman à peu près à l’âge de 30 ans, à un moment où il semble que vous vous étiez assagie.
Écrire et publier sont deux choses différentes. J’ai toujours écrit mais je dirais que j’ai voulu devenir écrivaine avant de vouloir écrire des livres. L’image de l’écrivaine m’attirait pour ce qu’elle représentait : la liberté absolue. Il me semblait qu’on pouvait écrire n’importe où, n’importe quand, qu’il n’y avait pas d’horaires ni d’astreinte à un lieu géographique ; et surtout, on n’avait besoin de personne d’autre, il y avait une indépendance du travail. Très tôt, cela m’a fait rêver. Ensuite, il a fallu écrire, et j’ai mis dix ans à écrire mon premier roman. Je ne l’ai pas écrit en dix ans mais il m’a fallu dix ans pour y travailler ; j’en ai commencé plusieurs pour réussir à en terminer un, pour réussir à me faire publier et aussi pour m’autoriser à le faire.
Vous avez déclaré avoir eu envie d’écrire parce que, pour vous, cela supposait une vie romanesque. Votre expérience a, par la suite, démontré le contraire…
À vingt ans, j’avais le sentiment d’avoir tant de choses à expérimenter, tant de gens à aimer, tant de pays à découvrir que le temps de l’écriture était moins intense qu’aujourd’hui où ma vie entière y est consacrée. Heureusement que j’ai vécu ! Autrement, j’aurais moins de choses à écrire aujourd’hui…
C’est le rapport au temps qui crée le roman. Nous avions des vies romanesques mais nous ne le savions pas. C’est la distance et le regard qu’a posteriori on porte sur une époque qui nous permet d’y voir la fougue, la grâce, la dramaticité ; mais au moment où nous le vivions, nous pensions que ce n’était jamais assez. C’est vrai de tous les êtres. Par exemple, quand j’ai travaillé sur Finistère, je me suis soudain intéressée à des personnages qui, sur le papier, pouvaient sembler avoir des vies très communes ; mais quand on s’y plonge, chaque vie est folle. J’ai appris cela lorsque je travaillais comme biographe pour des particuliers. Pendant des années, j’ai écrit la vie de personnes à la demande de leurs enfants qui offraient ce cadeau à leur mère ou à leur père. Et parfois ces gens me disaient : « Je ne sais pas pourquoi mes enfants me demandent de raconter ma vie dans un livre, parce que je n’ai rien fait de spécial dans ma vie ; j’ai été une mère au foyer, je me suis occupée de mes enfants, je n’ai pas grand-chose à raconter. » Or, après, en me plongeant dans la vie de ces gens, même si elle ne semblait a priori pas héroïque ni dramatique, j’ai réalisé que chaque vie était folle, passionnante. Mais c’est aussi l’effet d’un rapport au temps, car se plonger aujourd’hui dans la vie quotidienne d’une femme née dans les années 1930 et qui passait sa vie à s’occuper de ses enfants, d’un point de vue sociologique, d’un point de vue émotionnel, c’est passionnant.
Comment avez-vous eu l’idée d’écrire des biographies ?
Je voulais devenir écrivaine, je voulais écrire, mais il fallait que je gagne ma vie, je devais payer un loyer parisien ; tout cela, c’était beaucoup d’argent que je n’avais pas. La vie en entreprise semblait me dévorer, avoir des horaires me donnait la sensation de d’entamer mon impulsion d’écriture. Donc je me suis dit que pour écrire mon premier roman, il fallait que je trouve un métier dans lequel, d’une part, je pourrais écrire, et d’autre part, je n’aurais pas d’horaires. C’est ainsi que j’ai eu l’idée de créer cette petite maison d’édition qui s’appelait Porte-Plume. Même si je n’écrivais pas encore mes romans, au moins j’étais payée pour écrire, c’était mon métier, et pour moi c’était extraordinaire.
Et en plus, cela touchait à quelque chose de l’ordre de la transmission.
Oui. J’ai commencé à écrire ces biographies et c’était au fond un chemin très cohérent avec ce qu’aujourd’hui j’appelle « mon pays d’écriture », c’est-à-dire raconter la vie des gens, même si ce sont des gens qui sont morts aujourd’hui. C’est pour cela que j’ai parlé du rapport au temps : au moment où j’ai créé cette maison d’édition pour écrire la vie des gens, je ne pouvais pas imaginer que cela allait être fondamental dans mon parcours d’écrivaine, c’est seulement le temps qui m’a montré cela. Lorsqu’on a 20 ans, il ne faut pas avoir peur de se disperser ou de ne pas arriver là où l’on veut arriver, parce qu’en fait on construit quelque chose. C’est comme un puzzle : au bout du compte, quand on prendra du recul, on verra que ce puzzle dessine une image…
J’ai lu qu’en voyant une photo de Marguerite Duras jeune et très maquillée, vous aviez compris vouloir être écrivaine. Pourquoi ?
Quand j’ai vu cette photo, je savais qu’elle était écrivaine mais je n’avais pas lu ses livres. C’était à l’époque de la sortie du film L’Amant, je ne sais plus quand exactement, peut-être en 1995, j’étais adolescente. Beaucoup d’articles ont paru sur Marguerite Duras dans les journaux et dans les magazines à ce moment-là, parce que le film rencontrait un immense succès. Et c’est vrai que lorsque j’ai vu cette photo d’elle jeune, très maquillée, qui ne correspondait pas à l’image d’une écrivaine telle que la représentait la culture commune, je me suis dit qu’une écrivaine pouvait être une femme très féminine, avec les attributs du féminin. Jusque-là, l’image qu’on m’avait imposée était une sorte de masculinité de la femme écrivain, et cette image-là de Marguerite Duras jeune m’a ouvert un champ.
Elle vous a aussi donné une forme de liberté, car vous dites que la féminité, dans votre famille, c’était presque un continent noir.
Ma mère était très féministe. Elle a été au début des premiers mouvements – le MLAC, puis le MLF –, elle a fait partie des premières organisations, elle a travaillé avec les jeunes médecins qui aidaient à l’avortement… Elle était donc très en avance, et nous avons reçu une éducation qui allait avec cela. Une extraordinaire éducation selon laquelle les attributs de la féminité devaient être la liberté de l’intellect et l’indépendance ; et tout ce qui caractérisait un certain cliché féminin – le maquillage, les talons hauts, le vernis à ongles, le soin de soi… – était considéré comme quelque chose d’imposé par la masculinité et le patriarcat. Mais moi, j’étais un peu triste, parce que, même si je voyais que cette éducation que me donnait ma mère était extraordinaire, j’étais aussi attirée par des images féminines qui étaient combattues par mes parents – et je comprends pourquoi : c’était une étape nécessaire. À cet égard, j’ai l’impression que notre génération n’en est plus là et qu’aujourd’hui on peut inventer qui l’on veut être ; on peut à la fois être engagée dans des combats féministes et s’habiller exactement comme on a envie de s’habiller. Mais c’est un chemin.
Dans votre premier roman, La fille de son père, il est question d’une jeune femme qui apprend qu’elle n’est peut-être pas la fille de son père. Et dans votre dernier roman, Finistère, vous revenez sur l’histoire de votre père. Quelle correspondance établissez-vous entre les deux ?
Le premier roman est de la fiction pure. Il m’a semblé que pour devenir écrivaine, il fallait que je sache inventer des histoires, que je sache trousser une histoire. Évidemment, j’y ai mis mon cœur, j’y ai mis de moi-même, mais il m’a fallu tout un chemin pour me dire que pour moi, être en littérature, ce n’était pas inventer des histoires, c’était partir du réel, respecter le réel et mettre en lumière ce qu’il y a de fiction dans la réalité.
En vous lisant, j’ai cru ressentir et de la tendresse et de la frustration à l’égard de votre père. Les deux se nourrissent-elles ?
Tendresse et frustration sont deux mots très justes. Dans ce livre, j’ai voulu explorer le lien des pères et des filles quand ce lien n’est ni violent, ni traumatique, ni dramatique, mais un lien assez commun qui est peut-être celui que vivent la plupart des filles et des pères. J’ai donc eu envie d’explorer quelque chose d’un peu banal, ou en tout cas qui est partagé par beaucoup de gens, par exemple quand on sait qu’il y a de l’amour mais qu’on ne le dit jamais. Puisqu’il y a de l’amour, normalement il n’y a pas de problème, en tout cas du moins pas de souffrance. Mais si on ne le dit jamais, avec les années, avec l’éloignement physique lié au fait d’avoir des vies d’adultes, qu’est-ce que ce silence va générer, non pas comme drame, mais comme chagrin ou comme incompréhension ? Avec ce livre, j’ai essayé d’écrire sur quelque chose de ténu, de presque impalpable, quelque chose qui d’ordinaire n’occupe pas le champ de la littérature, puisqu’on a l’habitude qu’elle embrasse des grands sentiments, des sentiments violents. Moi, au contraire, j’ai travaillé sur le quasi-silence de cet amour-là, de cette tendresse qui, parfois, creuse un sillon de tristesse, parce qu’au bout d’un moment on n’est plus sûr de s’aimer.

Vous racontez que votre père a été marqué par le tournant de Mai 68, qu’il vous offrait une grande liberté, une forme d’affranchissement vis-à-vis de l’autorité patriarcale. Et pourtant la figure du père revient fréquemment dans vos livres.
Je ne suis pas afranchie de ma relation avec cet homme. Mais ce dont je suis sûre, c’est qu’il n’y a jamais eu aucun patriarcat dans notre organisation familiale. De ce point de vue-là, je dirais que mes parents avaient une génération d’avance. Lorsque je pense à mon père, je me dis qu’il était comme un homme déconstruit d’aujourd’hui. C’était un homme qui ne mettait pas sa masculinité en avant, il ne s’en préoccupait pas. Les attributs du masculin, le bricolage, la voiture, etc., c’était à mille lieues de lui. Chez nous, il y avait une vraie égalité intellectuelle. Mon père était un homme qui avait une très grande sensibilité ; et il n’était pas le seul, au fond il y avait beaucoup d’hommes comme cela, mais ce sont des hommes qu’on n’a peut-être pas assez regardés ou pas assez mis en avant. Aujourd’hui où l’on essaie d’inventer de nouveaux rapports, je suis heureuse de dire qu’on a déjà des modèles d’hommes comme cela – et qu’ils ont été très heureux. C’est comme si mes parents avaient incarné cette utopie. J’ai grandi dans une période où la société était encore patriarcale, mais il n’y a jamais eu de patriarcat au sein de notre cellule familiale.
Vous aviez une immense liberté – mais cette liberté était vertigineuse. N’avez-vous pas aussi eu besoin de vous créer vos propres limites ?
C’est sûr. Comme j’ai compris assez jeune que j’avais le droit de tout faire, j’ai également compris qu’il allait falloir que je sois mon propre gendarme, parce que sinon la vie allait être très dangereuse pour moi. Je vivais en banlieue, très jeune je prenais le RER toute seule à des heures tardives… Quand j’y pense aujourd’hui, je me dis que je dois être née sous une bonne étoile car je suis passée à côté de catastrophes… Je crois que je suis devenue mon propre contrôle parental.
Et avez-vous fini par comprendre qui était votre père ?
Je ne suis pas sûre qu’on puisse jamais comprendre les êtres. Je ne crois pas qu’on puisse se mettre à leur place ou avoir accès à ce qu’ils pensent, qu’on puisse les saisir, les enfermer dans un halo de connaissances qu’on pourrait avoir d’eux. En revanche, je me suis rapprochée de mon père, d’abord en accumulant une connaissance de faits. Je connais un certain nombre d’actions qu’il a faites dans sa vie, et les êtres se définissent aussi par leurs actions, cela veut dire quelque chose, et par ses actions je connais mieux ses valeurs. Par ailleurs, j’ai la sensation d’avoir touché quelque chose de cet homme si mystérieux, qui m’a toujours fascinée.
Le travail généalogique que vous faites dans Finistère, mais aussi dans vos autres livres, est-il un moyen de comprendre les êtres ?
Ce qui m’intéresse dans ce travail sur la généalogie, c’est, à un moment donné, d’en dégager un fil narratif, avec quelque chose qui va se raconter et se transmettre de génération en génération. Dans la branche paternelle de ma famille, il s’est transmis un rapport à l’action politique : mon arrière-grand-père a créé les premiers syndicats des paysans du Léon ; son fils est entré en politique jusqu’à devenir maire de Brest ; et mon père a été un leader des mouvements lycéens en Mai 68 à Brest, ensuite il est entré dans un militantisme d’extrême gauche et est devenu trotskiste. Il y a donc là une ligne de force qui se dessine dans un arbre. C’est ce que j’appelle les « transmissions invisibles », parce qu’aucun d’eux n’a eu vraiment conscience qu’en fait il continuait un geste entamé par le père, chacun a même pensé qu’il allait complètement ailleurs – alors que nous, avec le recul, lorsque nous regardons l’arbre, nous nous rendons compte que c’est un seul et même mouvement.
Je suis passionnée par cette dimension généalogique, transgénérationnelle, et je m’intéresse au champ scientifique relatif à la question de la mémoire cellulaire, selon lequel nos cellules ont une mémoire des émotions sur trois générations, ce qui veut dire que nos ancêtres vivent en nous puisque, d’une certaine façon, ils nous ont légué leurs émotions. Tout cela, c’est le terreau de mon travail littéraire autour de ces champs-là.
Une autre chose qui me passionne quand je travaille sur de longues périodes, c’est la dimension de l’étude sociologique d’un groupe de personnes. Dans ce livre, par exemple, il y a un premier mariage qui est le mariage de mon arrière-grand-père, où toute la ville est invitée, peut-être trois cents personnes ; c’est un mariage selon certaines traditions. Ensuite, il y a le mariage de mon grand-père, qui a voulu rompre avec les traditions, un mariage plus intime. Et puis il y a le mariage de mon père, où seulement cinq personnes étaient invitées à la mairie. Et l’on arrive jusqu’à moi qui ne me suis jamais mariée. C’est donc comme si le roman était l’illustration d’une étude sociologique – j’adore cela.
Toujours dans Finistère, vous utilisez à de nombreuses reprises le mot « bifurquer ». Pouvez-vous en parler ?
Le thème de la bifurcation traverse en effet ce livre : comment, de génération en génération, les enfants ne vont pas accomplir le projet que les parents ont pour eux. Le mot « bifurcation » est important pour moi parce que ce n’est pas une rupture, ce n’est pas une confrontation ; encore une fois, il n’y a pas de violence. Bifurquer, c’est un peu différent : on prend un petit chemin de côté, il n’a l’air de rien et cependant il va finir par nous amener ailleurs. Mais sur le moment, cela se fait sans violence. Donc c’est encore une fois un sujet ténu, un sujet qui n’est pas dramatique.
Et cette bifurcation, j’y suis venue parce que lorsque j’ai demandé à mon père quels étaient les sujets dont il voulait que le livre parle, il m’a répondu : « Je veux que tu parles de mes recherches scientifiques. » Il travaillait sur ce que, en mécanique analytique, on appelle la « théorie des catastrophes ». Je me suis dit que cela n’allait pas être simple d’écrire un roman là-dessus… Et j’ai compris que ce titre magnifique, « théorie des catastrophes », ne reflétait pas vraiment la réalité de ce que cela incarnait, car « catastrophe » est un mot qui induit une violence et du drame, alors qu’en mécanique analytique on parle d’objets qui vont changer de trajectoire, qui vont bifurquer. Et là, il s’est imposé à moi qu’il y avait comme un parallèle entre l’objet de l’étude de mon père et un parcours familial où, de génération en génération, chacun changeait un peu sa trajectoire et le faisait sans confrontation, sans crise, sans disputes, sans portes qui claquent ni mots définitifs. Chacun faisait son chemin à sa façon, avec le chagrin que cela induisait pour les parents et pour les enfants, parce qu’il faut le reconnaître, et à un moment les enfants doivent le dire : « On a eu un rêve commun. Eh bien, je ne vais pas réaliser ce rêve commun. »
Le premier livre que j’ai lu de vous, c’est Sagan 1954, votre troisième roman. Vous y parlez de la manière dont lire Françoise Sagan vous donne une impulsion de vie. Quand vous écrivez sur votre famille, avez-vous l’impression de vous donner à vous-même une impulsion semblable ?
J’ai toujours l’impression que je vis avec les morts, qu’ils sont très vivants, que ce sont eux qui me demandent de faire les choses. Vous pouvez entendre cela comme une métaphore. Moi, j’y crois vraiment, c’est-à-dire que j’ai vraiment la sensation de la présence d’êtres qui me poussent à faire les choses ; et si je les délaisse, je sens qu’ils ne sont pas contents parce que je ne fais pas mon travail. Donc j’ai l’impression qu’ils sont sur mon épaule et que ce sont eux qui me demandent d’écrire.
Vous écrivez frontalement sur votre père après sa mort. Pourquoi les déclarations d’amour arrivent-elles toujours trop tard ?
Moi, je n’ai pas réussi à le faire avant. Et pendant qu’il était malade, je me disais sans cesse : « Maintenant, c’est le moment de se dire les choses. » Et je n’y arrivais pas, et lui non plus n’y arrivait pas, à cause de la pudeur, à cause de l’éducation, à cause de ce caractère breton granitique. Mon rêve – parce que je rêve toujours que mes livres provoquent des actions chez les gens –, c’est qu’il y ait des gens qui, en refermant ce livre, se disent : « Mais en fait, il faut que je dise à cette personne que je l’aime. » Pour moi, le cadeau de la littérature, c’est ce pouvoir que, peut-être, elle confère : le pouvoir de changer des choses chez les gens, dans leurs vies.