La victoire des rentiers
Par ailleurs il faut rétablir un minimum d’égalité entre les hommes. Et cela n’est pas possible sans mesure fiscale équitable. En refusant toute avancée structurelle en ce domaine on ne fait qu’accentuer la frustration. Le refus d’imposer même marginalement les gros patrimoines en matière de succession encourage l’avènement d’une société de rentiers. Ce que le vieillissement démographique ne peut qu’aggraver. Aujourd’hui le travail est taxé huit fois plus que l’héritage et deux fois plus que la rente. En France une réforme de la fiscalité sur les héritages, ciblant les très grandes fortunes et les niches d’optimisation, pourrait rapporter au moins 15 milliards d’euros par an (soit l’équivalent du déficit de la Sécurité Sociale), sans toucher les classes moyennes. Où sont les responsables politiques qui le reconnaissent ? Cela nécessiterait une volonté politique forte, un ciblage précis, et un encadrement rigoureux des stratégies d’évitement fiscal. Tout le monde connait les abus du « pacte Dutreil » et personne n’ose y toucher. Au moment où la dette du pays atteint un niveau insupportable personne n’ose briser les tabous. L’histoire pourtant devrait nous mettre en garde : les abus de la rente fut un des principaux moteurs du Tiers État en 1989. Qui relit Balzac et le discours de Vautrin, les écrits de Saint Simon, d’August Comte ou de Durkheim ? À cet égard la pensée de la gauche n’est pas indigente : elle n’existe pas. Comme le disait Warren Buffet : « la lutte des classes est terminée : les riches ont gagné ».
La vertu du débat actuel : nous faire comprendre combien il est impératif de concilier équité et efficacité comme l’avait compris Lord Beveridge dans les années 1940. De même, la France était exsangue au lendemain de la guerre quand elle a réussi à inventer la Sécurité sociale : c’est ce qui a ressoudé le tissu national, permis la modernisation du pays et débouché sur les Trente Glorieuses. Aucune société ne peut progresser de manière cohérente et stable avec un corps social éclaté entre une minorité de privilégiés et une masse de laissés-pour-compte.
Il ne s’agit évidemment pas de dévaloriser la valeur travail mais de l’adapter au monde tel qu’il va. Nos vies ont été construites autour de cette valeur et il en sera ainsi encore longtemps. Il ne s’agit pas non plus « d’encourager la paresse » : je me méfie des leçons de catéchisme que certains Français « d’en haut » voudraient infliger aux Français « d’en bas ». Il faut avoir une piètre opinion des hommes pour penser qu’en leur donnant un peu d’oxygène pour mieux vivre on les encourage à mal vivre. En revanche, il faut absolument redonner de la dignité à ceux que l’histoire bouscule et leur faciliter l’accès à des formes d’activités nouvelles, associatives, solidaires ou citoyennes. C’est l’honneur des hommes que de savoir, parfois, transformer une utopie en ambition.
L’écologie punitive
Il est étrange de voir l’évolution de l’opinion à l’égard de la crise climatique. Alors que tous les scientifiques – et disons tous les observateurs normalement informés – savent que faire face à la crise climatique est d’une urgence absolue l’opinion populaire s’est en grande partie retournée. Par quel étrange mécanisme la politique environnementale est-elle aujourd’hui perçue comme « punitive » ? On le sait depuis l’explosion des gilets jaunes : la maladresse des dirigeants est pour beaucoup dans cette évolution consternante.
Si l’écologie devient le bouc-émissaire de la colère populaire ce ne sont pas ces mesures qui sont punitives mais la façon dont on les met en œuvre.
La véritable punition, on la voit tous les jours : des villes dévastées par des inondations et des tempêtes, des villages ensevelis par l’écroulement de glaciers qui ne résistent pas à l’augmentation des températures, des récoltes dévastées, des morts en nombre croissant dus à la mauvaise qualité de l’air ou aux canicules à répétition, la perte continue des puits de carbone que sont les forêts et les océans. La liste s’allonge chaque jour.
Comme la sécurité routière, les mesures écologiques sont proposées pour le bien de tous, mieux, pour notre vie et surtout celle de nos enfants. Mieux vaudrait d’ailleurs parler de « mesures de survie » : d’abord parce que c’est la vérité, ensuite parce que c’est un sujet transpartisan alors que le mot « écologique » renvoie à la notion de « parti écologique » qui est devenu un repoussoir : les écologistes qui ont voulu faire une carrière politique se sont déconsidérés. L’écologie est une cause, pas un parti, encore moins un marchepied pour ambitions personnelles.
Le plus fou, c’est que ces catastrophes entraînent des dépenses pharaoniques d’assurances, de reconstruction et de dédommagement qui viennent augmenter notre PIB, participent à la croissance, nourrissant ainsi notre crédo productiviste. Plus de réchauffement, c’est plus de PIB. Absurde, non ?
Que faire ? Il faut développer un récit positif. Montrer ce qu’on y gagne plutôt que ce qu’on y perd, mettre en place de vastes campagnes d’information et de formation auprès du public, aider les entreprises à organiser leur décarbonation et, surtout, mettre les moyens en face de nos ambitions. La transition écologique, c’est une planification et de l’argent. Pour cela, il faudra bien un jour partager mieux les richesses.
On le sait : les courbes de revenus et d’émissions de GES coïncident. Pas d’autre issue, dès lors, que de demander aux plus émetteurs, c’est-à-dire aux plus riches, de contribuer à la hauteur de leurs revenus.
Le gouvernement travaille à un plan d’adaptation de la France à une température moyenne en hausse de 4°. Nous voilà rassurés ! Et libres de continuer à consommer et à émettre ! Sauf qu’à +4°, tous les experts le confirment, la vie est quasi impossible et l’humanité se fera une guerre sans merci pour survivre. A quoi bon s’adapter si l’on ne freine pas, un tant soit peu, la machine folle du réchauffement ?
Avouons que nous avons là un paradoxe difficile à avaler. Faire de la cause environnementale un épouvantail pour les classes populaires relève du grand art. Tous les lobbys économiques qui se sentent menacés dans leurs intérêts financiers par les tenants d’une écologie raisonnable se frottent les mains. Ils n’en espéraient pas tant.
Toute politique environnementale ou climatique doit désormais être pensée avec une conscience aiguë de ses effets sociaux. La transition écologique ne peut réussir que si elle est socialement juste. Cela signifie aussi prévoir des mesures de compensation ciblées : primes à la conversion, soutien à la mobilité alternative, investissements massifs dans les transports publics et aides à l’emploi. Les outils de la transition écologique ne peuvent pas ignorer la réalité quotidienne de millions de Français.
Affronter le réel
Le moment est crucial. Il impose à la gauche de cesser de fuir trois grands sujets que d’autres lui ont confisqués : la sécurité, l’immigration et le travail. Non pour les abandonner aux extrêmes, mais pour les réinvestir avec ses propres principes, en refusant les caricatures et les simplismes.
Pendant trop longtemps, une partie de la gauche a déserté les débats sur la sécurité. Par crainte d’être accusée de trahir ses idéaux humanistes ou de glisser vers des positions répressives, elle s’est tue. Ce silence a eu un prix : il a laissé à d’autres le soin de définir les termes du débat, d’imposer leurs mots, leurs peurs et leurs solutions. Dans cette abdication, la gauche a perdu un terrain politique central : celui du quotidien, du réel, de ce qui pèse dans la vie concrète des gens. Pourtant, rien n’est plus contraire à ses valeurs que cette évaporation. Car ce sont les plus vulnérables – les habitants des quartiers populaires, les femmes isolées, les enfants issus de milieux défavorisés – qui subissent le plus directement les effets de l’insécurité, qu’elle soit physique, économique ou sociale. Refuser d’en parler, c’est leur tourner le dos. Les discours lénifiants ou les slogans dogmatiques ne suffisent plus.
Il faut oser le dire : la sécurité n’est pas une obsession droitière, c’est une exigence de justice sociale. C’est un droit fondamental, au même titre que l’éducation ou la santé. Dans les quartiers populaires, ceux qui vivent l’insécurité au quotidien savent que l’absence d’intervention publique renforce la loi du plus fort. Là où l’État recule, ce ne sont pas les libertés qui progressent, mais les trafics, les dominations, les peurs. Réinvestir la question sécuritaire, c’est donc protéger les plus faibles contre les plus forts. C’est affirmer que l’ordre public peut – et doit – être un instrument de libération quand il est porté par une puissance publique démocratique, respectueuse des droits. Ce n’est pas faire preuve d’autoritarisme que de vouloir que l’école, la rue, les transports soient des lieux sûrs. C’est faire preuve de courage politique et de cohérence morale.
Sur l’immigration, le piège est le même. Le débat est souvent capté par ceux qui veulent réduire l’enjeu à une question de contrôle des frontières, de quotas, de flux. Cette approche technocratique ou fantasmatique oublie l’essentiel : la réussite ou l’échec de l’immigration se joue dans l’intégration. Or sur ce terrain, la gauche a une légitimité historique. Elle sait que l’intégration passe par le logement, l’école, l’apprentissage du français, l’égalité d’accès aux droits, la lutte contre les discriminations. C’est là que doit se situer son discours. Non dans l’angélisme, mais dans l’exigence républicaine. Oui, il y a des tensions, des défis. Mais la solution ne peut être une fermeture générale ni une surveillance généralisée. Elle réside dans une politique de l’accueil structurée, avec des moyens à la hauteur, et une parole claire : la France ne peut pas accueillir tout le monde, mais elle peut mieux accueillir ceux qu’elle choisit de faire entrer. Encore faut-il qu’elle s’en donne les moyens.
La gauche est à un tournant. Finie l’époque où les thèmes de la diversité, de la société inclusive ou des droits minoritaires suffisaient à mobiliser. La demande sociale revient en force. Elle impose une gauche capable d’affronter le réel sans renoncer à l’idéal. Reprendre la main sur la sécurité et l’immigration n’est pas un reniement. C’est une condition de la reconquête démocratique. C’est faire entendre une autre voix, loin des discours anxiogènes ou punitifs : une voix ferme mais juste, lucide mais fidèle aux principes de solidarité, d’émancipation et de justice. Une gauche qui protège, une gauche qui intègre, une gauche qui assume.
Enfin sur le travail un retour au réel s’impose. La gauche ne peut plus se contenter de respecter les dogmes anciens de la lutte des classes et des 35 heures ! Elle doit affronter les dures réalités : si la France avait le même taux d’emploi que l’Allemagne le pays n’aurait plus de déficit. Il faut repenser en ce sens le travail des jeunes, des femmes et des seniors. La gauche doit aussi affronter les mutations technologiques massives qui s’annoncent, ce qui veut dire anticiper par des plans de formation massifs. Enfin, il faut revendiquer le travail comme une activité humaine porteuse de sens, de bien social. Ce qui veut dire notamment remettre en question les hiérarchies de prestiges et de rémunération en faveur des métiers essentiels, les métiers d’éducation et de soins notamment. Bref, il faut repenser le travail sous le prisme de son utilité sociale et humaine ce qui ne va pas de soi quand on laisse libre court au marché pur et dur.
Un match sans arbitre
L’État, le pouvoir politique dans tout ça ? Il en perd sa boussole. Les entités nationales ne font plus le poids devant les géants du numérique, qui se jouent des frontières. Sa perte de base fiscale se double d’une perte de prestige, voire de légitimité. Bref, un terrain de jeu mouvant, sans arbitre, où le politique, hélas, perd sa prise sur les évènements. Il faudra beaucoup de sagesse et pas mal de volonté pour faire face à ce nouveau visage du capitalisme : la marchandisation généralisée. En sacralisant le marché, nous avons installé au pouvoir un tyran très difficile à détrôner.
Tout cela débouche sur une inquiétante solitude du citoyen salarié… Les algorithmes décident pour eux sans qu’ils puissent toujours comprendre leurs injonctions. Hier l’école, l’église, la commune, le café, permettaient de vaincre l’isolement. C’est fini : chacun vit le regard visé sur son téléphone mobile et l’art de la conversation est remplacé par l’écran. C’est aussi contre cela que nous devons lutter. Il est urgent de réintégrer le citoyen dans le jeu social et civique. A défaut on le retrouvera, à intervalles réguliers, brayant sur les ronds-points.
La pauvreté des réflexions de la gauche en ces domaines fait peine à voir. Les contributions proposées au dernier congrès du Parti Socialiste sont, de ce point de vue affligeantes. Comme si les tenant du marché à tout va avaient clos le débat. Les forces de gauche semblent résignées. Leur ambition n’est plus d’orienter la société vers le bien commun : elles se limitent à réguler les variations de la conjoncture dans une espèce de saint-simonisme dégradé, sans ambition organisatrice. A les entendre, l’État devrait se limiter à rester au bord du jeu, comme une espèce d’arbitre qui intervient le moins possible. Et si possible jamais. Un exemple récent : les chefs d’entreprise ont reçu un soutien considérable de l’État durant le Covid. Et c’était justifié. Mais la crise passée les mêmes hurlent contre l’intervention de la puissance publique dans l’économie. Et personne n’a relevé (le Cour des Comptes mise à part) que les aides publiques – entre 70 et 250 Md selon les sources – ont été accordées sans condition et sans suivi !
Contre-sens absolu : les Etats-Unis eux-mêmes ont montré qu’il n’y a pas d’innovation possible sans une forte implication de l’État. Chez nous les prérogatives régaliennes ont été très souvent octroyées à des autorités indépendantes – banque centrales et autres – pour que le marché puisse faire la loi.
Les acquis de la protection sociale sont alors décrits comme des vestiges obsolètes d’une autre époque, qu’un État devenu régulateur encadre à peine. Même pour les sociaux-démocrates l’État est souvent perçu comme le responsable de tous les maux. Il en fallait bien un. Seulement voilà : l’homme est ainsi fait qu’un match sans arbitre tourne généralement au pugilat. La planification est devenue un tabou et le long terme hors de portée. Avec pour conséquence – au niveau international comme au niveau national – le moins disant possible et les crises financières. Une nouvelle étape dans la financiarisation semble même aujourd’hui en gestation avec l’essor du Bitcoin et autres crypto-actifs. « Une société se juge à ce qu’elle considère monnayable » disait Péguy. Mme Tatcher lui a répondu « je ne connais pas de société, je ne connais que des individus ». Triste époque qui, aujourd’hui encore, applaudit la Dame de fer.
Coluche avait raison
Le phénomène n’est pas nouveau. Il est juste insupportable. La classe politique qui s’interroge sur sa perte de crédibilité ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Les promesses faites et vite oubliées génèrent le désenchantement. Mais la violation des principes brandis en période électorale fait des dégâts encore plus graves. Surtout quand il est clair que l’État a capitulé devant des lobbys. Prenons deux exemples récents, pas très loin de nous.
La décision soudaine du Président de la République visant à exonérer du devoir de vigilance les entreprises françaises (par abandon d’une directive européenne) marque un tournant inquiétant dans la politique de responsabilité sociale et environnementale de notre pays. La France avait initialement inspiré ce texte mais les temps changent, pas toujours en bien. Que penser d’une société qui fait de la défense de ses valeurs une nuisance bureaucratique ? Cette décision, concession au lobbying de grandes entreprises plus préoccupées de dividendes que d’éthique, constitue une régression historique inquiétante. Immédiatement imitée outre Rhin : pour une fois que le couple franco-allemand est en marche il se met en marche arrière !
La loi française sur le devoir de vigilance, adoptée en 2017, est née en réaction à une série de catastrophes humaines et environnementales impliquant des multinationales, souvent françaises ou européennes, opérant à l’étranger. Faut-il rappeler la catastrophe de Bhopal, en Inde (1984), le naufrage du pétrolier Erika (1999) l’explosion de l’usine AZF à Toulouse (2001) ; le scandale de Lafarge en Syrie (2013), ou l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh (2013)… Par ce revirement peu glorieux, la France tourne le dos à ses valeurs en matière de droits humains et de justice environnementale des entreprises, au moment où elle clame combien des enjeux sont importants.
Autre exemple : la réintroduction du néonicotinoïdes votée récemment par le Parlement. Une loi qui autorise la sur-pollution des sols déjà contaminés par chimiothérapie, qui met en danger la santé des Français, comme la protection de la faune et de la flore. Alors que notre pays est déjà parmi ceux qui autorisent le plus de pesticides dans l’UE, était-il nécessaire d’en autoriser de nouveaux, après une interdiction de six ans ? Il faut appeler un chat un chat : l’attrition de normes sanitaires c’est la mise en danger d’autrui. Avec le mensonge à la clé : le Gouvernement et la Commission européenne ont changé l’indicateur de pénétration des produits phytosanitaires en cours de route pour faire croire à une baisse alors que la réalité est tout autre : la consommation de ces produits a augmenté de 10% entre 2008 et 2022 ! Le lobby des grandes exploitations agricoles a encore frappé ! Face à cette évidente duplicité, allez dire aux Français que la défense de l’environnement exige leur mobilisation.
Ce ne sont que deux exemples. Mais récents et symptomatiques. Où la gauche française s’est encore ici distinguée par son silence ! Il fut un temps où elle pouvait faire la leçon. Hier, le pays de Cassin et de Dumont essayait de tenir son rang en matière de droits humains et d’écologie. Aujourd’hui, ce vernis craque. Et de recul en recul les politiques sont traités comme ils le méritent, en polichinelles. Coluche avait raison quand il disait : « je signale aux politiques qui me traitent de rigolo que ce n’est pas moi qui aie commencé ».






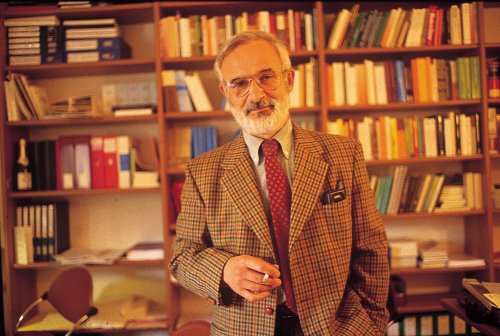

Lors de la crise des missiles de Cuba, les frères Kennedy inventèrent une nouvelle façon de faire parler les armes, le doigt sur la gâchette à la lisière de l’Apocalypse, alliant l’art du glissement de curseur à un sens du timing donnant de la crédibilité à la diplomatie officieuse, avec, en prime, le coup de maître imparable d’Adlai Stevenson au Conseil de sécurité, quand l’ambassadeur américain auprès des Nations unies confronta l’Hubris soviétique aux photographies aériennes des mêmes missiles nucléaires dont cette dernière était convaincue qu’elle allait pouvoir nier la présence pour mieux incriminer l’Ennemi relativement à l’action préventive qu’il s’apprêtait à lancer en vue de protéger l’intégrité de son territoire national et, accessoirement, la vie de quelque 179 millions de citoyens libres et égaux en droits.
Mais ça, c’était avant que le secrétaire d’État Powell n’assommât d’un coup de fiole ce pilote intrépide de l’USAF qui, quatre décades en arrière, se faisait cribler l’aile en rase-motte par la DCA rouge pour bombarder de photos les armes de destruction massive de Nikita Khrouchtchev ; avant qu’avec le concours non négligeable des pseudélites du spectacle socialopathe, les flagellants post9/11 ne prennent le leadership contre-néoconservateur et n’imaginent pouvoir résoudre le trouble bipolaire de l’après-guerre en posant les premières BRICS du Colisée multipolaire à l’international ou, en lieu et place de garanties pour la sécurité intérieure, celles d’un multiethnoculturalisme qui condamnerait Homo migrans au sabordage de toute communauté nationale ouverte à son intégration.
Nous parlons donc d’une époque (octobre 1962) antérieure à l’horrifiante dérive des Nations unies dont le penchant organiciste et démocratorial de la majorité des États membres, antisémites en diable, participerait notablement et notoirement d’attaques terroristes islamistes (octobre 2023) n’ayant rien à envier à ces pogroms européens que nos ancêtres implantèrent dans une mémoire ultratombale que l’on qualifierait volontiers de lieu hanté si l’esprit des lois qui la régissent n’était pas aussi vivace que vous et moi.
Vos états de conscience faillie gagneraient à reprendre pied face au colosse de Moscou. Ils vous exposent, leaders européens, à l’impuissance des mésalliances morales quand, au nom de la préservation d’une unité d’apparence, vous nous commettez avec les syncrétiseurs d’une guerre sainte islamique pan-nationale-socialiste dont vous redoutez par-dessus tout qu’elle ne se fasse vomir en se tournant vers l’Occident depuis les terrains de jeu périphériques de la guerre froide.
Le Transcendant Satrape comparait la vie à une dent, et, de fait, le Hamas ment comme un arracheur de dents, sauf peut-être à propos de 1) l’État islamique, hitlérien sur les bords, dont il se flatte de hâter l’avènement de l’événement planétaire, ou 2) l’extermination des Juifs qu’il se propose désormais de chasser de la Terre, fût-elle dépourvue de sainteté. À sa remorque, l’Union des révolutions & Associés légitime la volonté d’annihiler l’État juif en appelant acte de résistance l’action génocidaire du 7-Octobre avant de s’empresser de qualifier de génocide la riposte légitime d’Israël aux forces du Néo-Axe. Hélas pour elle, les Juifs ne se laissent plus aussi aisément culpabiliser depuis qu’ils ont repris les rênes de leurs propres destinées.
Entre, d’un côté, la progression régressive de la Dixième Croisade comme unique réponse au Jihâd et, de l’autre, Superdupont et Superdupond vont en bateau et nous y mènent, pardonnez-nous de ne pas vous laisser nous mettre le couteau sous la gorge. On ne traite pas davantage une superpuissance politique et militaire comme une organisation terroriste qu’on ne se laisse inviter à s’asseoir autour d’une table par al-Qaïda, Daech, Hamas ou Hezbollah. Toutefois, lorsqu’on est la première puissance mondiale, bouclier du monde libre, concepteur et promoteur d’un ordre libéral international œuvrant pour l’expansion des rapports humanistes en opérant la résorption des invasions barbares, on fait comprendre au Petit URSSon que s’il ne peut se résoudre à perdre la face, de notre côté, il ne sera jamais question de perdre ni la face ni sa place.