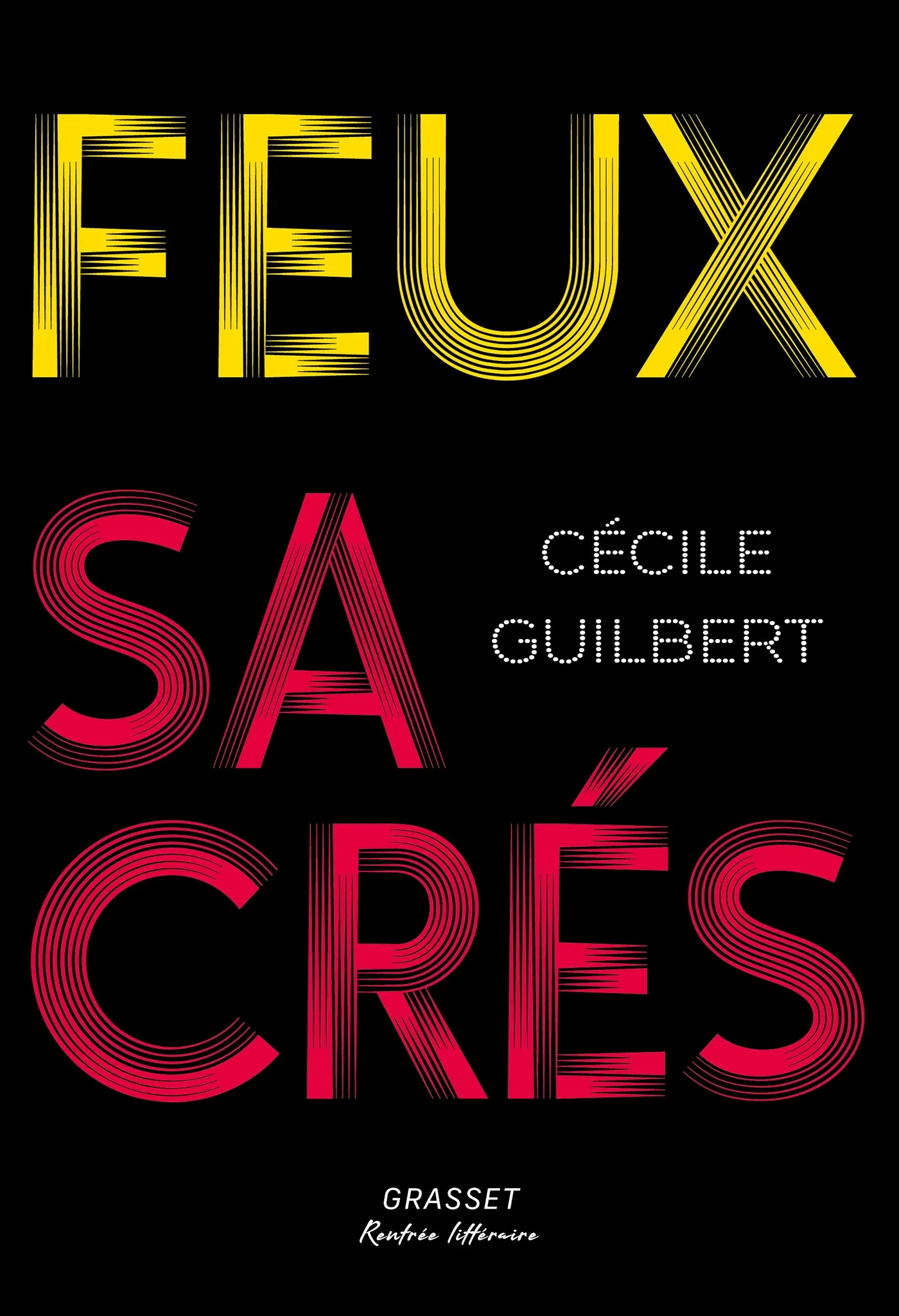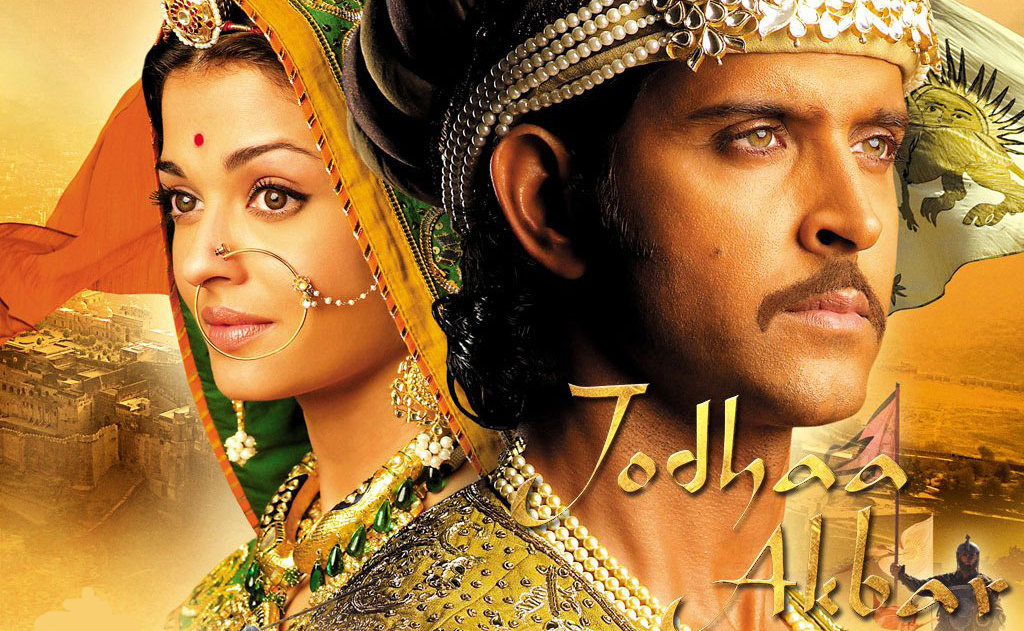« Aussi loin qu’il m’en souvienne, j’ai toujours entendu parler d’un continent surpeuplé, saturé de couleurs et d’épices, avec son double exotisme de mystique et de misère… »
Un livre comme un feu sacré pour « s’élucider soi-même », parcourir le labyrinthe du temps, remonter aux sources d’une passion, l’Inde, et saisir les mécanismes d’une renaissance : « Retrouver le trésor des feux sacrés qui ont activé l’énergie de la transformation à travers les peines et les joies dont chacun sait qu’elles brûlent et consument autant qu’elles éclairent et réchauffent. »
Cécile Guilbert signe là le roman d’une vie, un portrait diffracté – à l’image des identités multiples de Sollers qui la publia pour la première fois dans L’Infini : Rimbaud, Lautréamont, Debord, Warhol, Artaud, Nietzsche, la tauromachie et les drogues… avant de parvenir à l’Advaita vedanta, la vie apaisée, l’illumination du « libéré vivant » : « Souvent, j’imagine ce qu’il adviendrait de ce monde et de cette terre si le “dieu intérieur” des milliards d’individus qui les peuplent était activé. L’effet en serait tellement puissant, gigantesque, illimité, que seule l’image d’un Big Bang cosmique, l’équivalent de l’explosion de dizaines de bombes thermonucléaires, me vient à l’esprit. »
Que l’on soit sensible ou non aux illuminations indiennes, à la philosophie de la paix intérieure et aux figures ancestrales d’un pays incontestablement fascinant, on ne peut qu’être bouleversé par les pages de Feux sacrés sur la mort. Car le livre de Cécile Guilbert est avant tout un livre de deuils. « Ce sont ces flammes et ces cendres qui, je le crois, m’ont initiée et sauvée » – une initiation à « à cette œuvre parfois lente à venir qu’est la mort ». Deuil d’un cousin homosexuel suicidé au sortir de l’adolescence, d’une grand-mère qui fut avant tout une mère, d’un oncle « converti » et d’un frère dont les circonstances du décès restent terriblement énigmatiques. Les pages dédiées à l’agonie de la grand-mère – Guilbert, rétive aux euphémismes, insiste sur cette « agonie » –, accompagnée dans ses derniers instants par l’autrice, sont les plus bouleversantes du texte : « Elle m’a offert son agonie et je l’ai saisie. » Les microévénements à son chevet, la légère oscillation d’un doigt, d’une paupière, la joie des souvenirs, d’un baiser, d’une gorgée d’eau et des adieux muets : « Pas d’autre existence possible hors de l’enclos de sa chambre ; c’est auprès d’elle que la vie est plus intense. » La paix, déjà.
Mais ce portrait en creux est avant tout le récit d’une hésitation, ou plutôt d’un ajournement. Guilbert, dont l’oncle et la tante ont longtemps été nourris de bouddhisme, de yoga et d’Inde – dont, en bonne rationaliste, elle est d’abord restée à distance –, devra connaître les deuils à répétition, les affres de l’hiver – la saison des morts, « hivers du calendrier et de l’âme » –, effectuer d’innombrables voyages, notamment au sein d’un ashram, afin de parvenir enfin à ce qui était en germe, c’est-à-dire à l’initiation, l’évidence : « Ce peuple aux bustes minces, ambrés, aux yeux noirs de velours, jamais vulgaire. Ses immenses détresses jamais plaintives. Son esprit d’enfance inassouvi. Ses rires et sa gravité. L’amour aussi de ses lassitudes monotones comme des steppes. » Ce sont ainsi encore, quand le livre se fait récit de voyage, de très belles pages pleines de tendresse et de révérence pour l’Inde.
Puis, le regard d’un gourou (maître spirituel indien) et l’enseignement yogique : le yoga comme une (re)découverte de soi – Carrère l’a écrit –, la voie de la vita nova, réincarnée vivante. Et si cette réappropriation du corps est si renversante, c’est parce qu’elle vient s’enraciner là où s’inscrivaient auparavant les expériences limites ; le yoga, comme un lien, rassemble alors les fils pour tracer le point d’orgue d’une existence. Si ces pages sont si belles, c’est parce qu’elles mêlent la pensée orientale à la culture littéraire et philosophique de l’autrice, le rationalisme et la spiritualité hindoue, faisant de ce livre un passionnant palimpseste.
« Aucune perte n’allant jamais sans gain, je souhaite évoquer les ressorts acquis dans la souffrance et l’épreuve, invoquer les puissances transformatrices qui s’intercalent entre douleurs et faveurs, en l’occurrence la grande sapience de l’Inde. » À l’issue du voyage – voyage qui, pour nous autres encore empêtrés dans l’ego et l’ignorance, résolument non apaisés, fait l’effet d’un rêve –, être la même et une autre. Alors, comme au terme de toute littérature : « N’y a-t-il pas là de quoi se guérir à jamais de la peur de la mort ? »