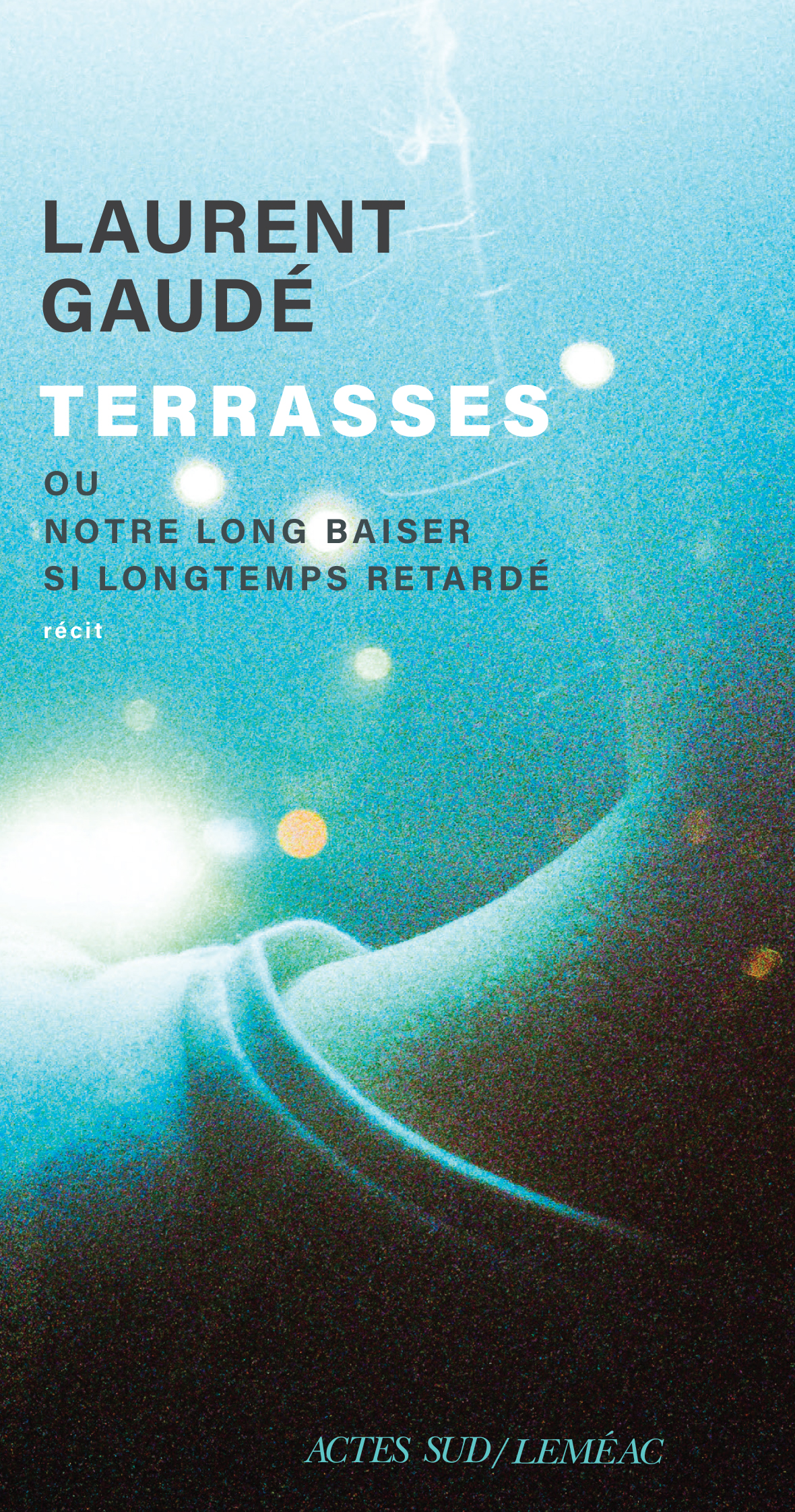« Je m’aperçois soudain que je ne puis me rappeler en réalité aucun détail particulier de votre visage. Seulement votre silhouette, vos vêtements, au moment où vous êtes partie entre les tables du café : cela, oui, je me souviens… »
Franz KAFKA, Lettre à Milena Jesenska.
Terrasse. N. fém. : Espace en plein air (partie de trottoir ou de place) situé devant un café ou un restaurant, où sont disposées des tables et des chaises pour les consommateurs.
Terrasser. Verbe trans. : Abattre physiquement, ôter toute force, toute résistance physique et, parfois, par conséquence, priver de sensation, de sentiment. Faire mourir. Réduire quelqu’un à l’impuissance, rendre incapable de réagir, de répondre.
C’est dans l’ambiguïté lexicale sonore, entre terrasse et terrasser, que Laurent Gaudé a placé son dernier livre, Terrasses, ou Notre long baiser si longtemps retardé (Actes Sud). Un texte puissant dédié à « toutes celles et ceux qui se sont sentis parisiens ce soir-là ».
Vous avez compris ?
…Mais si, vous avez compris.
« Ce soir-là », c’est le vendredi 13 novembre 2015.
Ne partez pas, restez. Je sais que vous avez probablement voulu oublier. Ne plus y penser était sans doute un moyen de ne pas céder devant l’effroi et, ainsi, de continuer à vivre. Faire comme si de rien était pour pouvoir faire comme avant. Se rappeler, n’est-ce pas prendre le risque de réactiver une terreur partagée et ses conséquences : repli sur soi, hypervigilance, tout un cortège d’angoisses ? Je vous promets que non. Cette promesse je sais pouvoir la tenir, parce que Laurent Gaudé se place, ici, du côté de la vie. De ce qu’il reste de vie quand la mort est là. De ce qui survit et lutte.
Comment raconter l’impensable ? Comment faire le récit des étapes de ce calvaire ? Le 13 Novembre est un trou béant qui se situe par-delà le langage. L’œil d’un cyclone où la peur prend racine et se répand. C’est un jour où la mort ne se donne pas, mais où les vies sont volées, arrachées à elles-mêmes. Autour de ce chaos un peuple en ronde, main dans la main, a tendu fièrement une corde d’humanité. On s’en souvient. J’étais, comme vous, un maillon de cette chaîne qui, le lendemain, sonnée mais déterminée, faisait corps contre la mort, pour la vie. Terrasses ressemble à ce moment-là, c’est un livre de mémoire et de transmission.
Il raconte comment l’on passe d’une dernière soirée de douceur avant l’entrée dans l’hiver – il faisait beau ce matin-là –, à la dernière soirée tout court. Le 13 Novembre devait être une journée semblable aux autres, vouée à disparaître dans le flot innombrable de ces heures que l’on vit et auxquelles on ne repense plus. Le passage de l’oubliable à l’inoubliable est au cœur de ce texte. Bien sûr, l’auteur a dû trouver un moyen de faire le récit des attaques terroristes, le carnage des terrasses, celui du Bataclan. Ce sera fait, mais avec une infinie pudeur. En attendant, parmi les pages les plus bouleversantes, les plus vertigineuses, les premières sont de celles qui vous hantent.
Pourquoi les morts sont morts ? Pourquoi eux ? Quand est-ce que cela s’est décidé ? Y-a-t-il un pressentiment qui, avant que l’horreur advienne, vous y prépare ? Face à l’imprévisible, le poids rétrospectif de l’arbitraire est terrifiant. Et si le métro avait été retardé ? Pourquoi dans ce café et pas dans un autre ? N’aurais-je pas dû dissiper cette dispute sur laquelle nous nous sommes quittés ce matin-là ? On ne devrait jamais partir fâchés. Jamais rien retarder. Terrasses est porté par la densité du Hasard, qui « dévie nos chemins avec une joie féroce et donne à l’horreur le nom de destin ». Semblable à une ombre omnisciente qui, peu à peu, se rapproche des uns et des autres, serre la gorge de plus en plus fort au gré d’une loterie infernale, un tirage au mauvais sort, le Hasard sait tout avec la même force que nous l’ignorons. C’est qu’il y avait autant de raisons d’être dans la trajectoire des balles que de ne pas y être. Les mots de Laurent Gaudé disent l’interruption de la vie, et l’éruption de la mort. Dans ce même mouvement, on perçoit l’arborescence d’innombrables possibilités manquées qui se dessinent : tout un enchaînement de décisions qui aurait pu faire que l’histoire de chacun soit différente.
Laurent Gaudé donne de la voix à des portraits faits de tant de visages mêlés. Plus qu’une voix, un souffle. Ne cherchez pas de noms, de personnages. Vous n’en trouverez pas. Ces femmes, ces hommes, ces frères et sœurs, ces parents, ces enfants, ces amis et ces amants, ça aurait pu être « vous », ça aurait pu être « moi ». Ils portent en eux la part d’humanité qui nous rassemble, et nous différencie de ceux qui, ce jour-là, forçaient la mort à surgir là où elle n’aurait jamais dû être.
Combien de témoignages l’auteur a-t-il lu, écouté ? N’allez pas croire qu’il y a là quelque chose d’utilitaire. Laurent Gaudé ne parle à la place de personne, ne s’approprie aucune douleur. Il compose un récit-choral, crée un chant polyphonique, qui fait face au claquement sourd des balles qui ont, pour ceux qui sont morts, et ceux qui restent, le son de la perpétuité. Les paroles se relaient au fil des pages, un fil comme une longue ligne de la main, la ligne de vie.
J’ai l’impression de vous parler de cet Événement. Mais c’est bien du livre dont je parle. Parce qu’il est comme ça, sans spectaculaire, plus proche des sensations que du sensationnel. Terrasses éclaire et dit l’intimité du temps qui s’achève, d’un baiser retardé, d’une caresse suspendue, d’un rire que rien n’aurait dû arrêter, d’une danse qui devait durer jusqu’au matin. C’est la banalité d’un jour de plus qui n’aura pas lieu. Le lecteur perçoit la lumineuse platitude de ces heures, parce qu’elles étaient vouées à la noyade, dans l’écoulement des jours successifs ; l’écoulement, soudain, a été brisé. Oui, la banalité n’est perceptible que dans son interruption sidérante. Ce choc, Laurent Gaudé l’exprime à l’économie, mettant en place une écriture flottante, pourtant d’une grande clarté. Tout cela prend forme et voix au travers d’une poétique des derniers instants, du basculement aussi. Le livre est vaporeux, frémissant. Il raconte une chute au ralenti quand l’abîme est tout près. Le compte à rebours est là : il y a une folle urgence de s’aimer, c’est-à-dire de vivre. C’est la leçon du récit. Chaque mot dessine les contours d’une antichambre du pire, quand la vie suit encore son cours, avant que, sans crier gare, à la liste des dernières fois s’ajoute celle, tout aussi longue, des jamais plus.
Oui, si Laurent Gaudé donne à voir, à ressentir, au détour de chaque phrase – des phrases qui sont comme des coins de rues, des espaces prévus, à l’origine, pour la gaieté et l’amour –, il donne aussi à vivre. Ce qu’il y a d’ardent dans l’existence envahit sa littérature pour ne laisser aucun vide ; la haine n’a pas sa place ici, l’idéologie non plus.
Vous savez, nous savons : les silhouettes que l’auteur trace ici n’ont pu boire la coupe de l’allégresse d’un vendredi soir jusqu’à la lie.
Un jour la vie ne sera rien d’autre que ce qu’elle a été. Par-delà l’évocation des attentats du 13, c’est cela que raconte Laurent Gaudé. Plus qu’un memento mori, son livre est un cri qui dit : n’oubliez pas de vivre, d’aimer, parce qu’il y a dans la mort quelque chose d’inacceptable, et que l’homme ne peut pas s’offrir le luxe de vivre à retardement. Un jour arrive, et il est trop tard.
En attendant, l’auteur passe les faits à l’épreuve de l’émotion. Tout sonne juste ! Tout sonne vrai ! Terrasses nous concerne tous. Je remarque que le « je » en est absent, partout il est question de « nous ». Un « nous » fragile et fort, humain, trop humain, qui porte en lui la mémoire des disparus. C’est de cette mémoire que jaillit, à chaque page, une éblouissante vitalité, un courage, un appétit d’exister plus vite, plus fort.