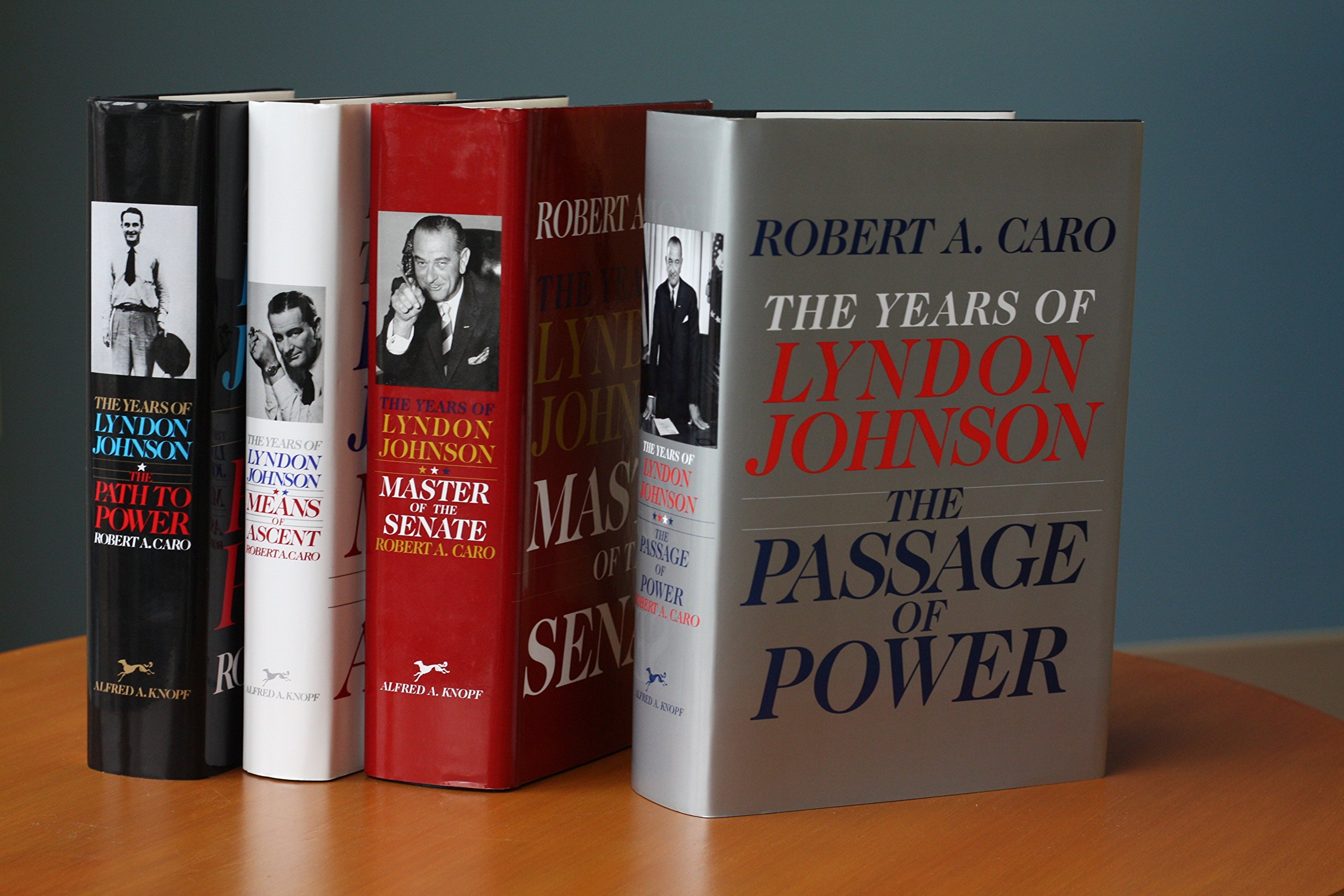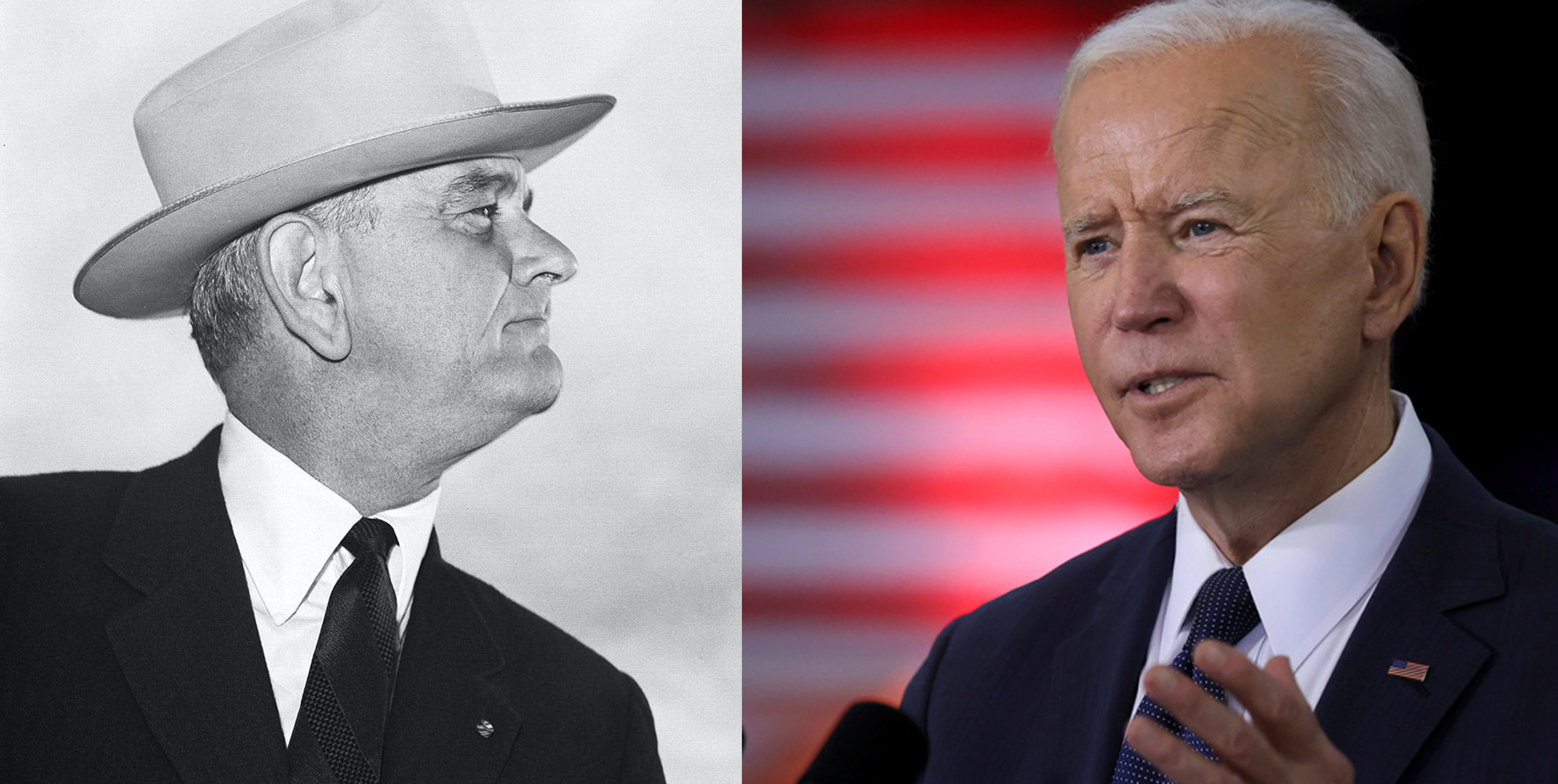Le 22 novembre 1963, dans les rues de Dallas, le cortège de voitures parade. En tête, dans une décapotable, un président au sommet de son charme, de sa popularité, de son éclat : John Fitzgerald Kennedy. Quelques véhicules plus loin, un autre homme politique éprouve, lui, la scène avec une violente déprime. Lyndon Baines Johnson, le vice-président des États-Unis, 55 ans, dont presque 35 dans la vie publique, le pressent en cet instant même : sa carrière est terminée. De toute part, il est cerné. Quelques jours plus tôt, il a d’abord appris que Bobby Baker, son homme lige, chargé de ses basses œuvres quand Johnson était majority leader au Sénat, est sous le coup d’une enquête criminelle pour corruption. Au moment où le cortège présidentiel vrombit dans Dallas, le même Bobby Baker est auditionné, au Sénat, par une commission indépendante bien décidée à faire tomber le vice-président. Les vilaines rumeurs qui entourent depuis toujours la carrière de Johnson, et en particulier ses liens privilégiés avec les magnats du pétrole texans, commencent à intéresser les journalistes. « Newsweek » a chargé une dizaine d’enquêteurs de constituer un dossier, qui doit paraître de manière imminente à la une d’un hebdomadaire, qui, quinze ans plus tôt, consacrait Johnson comme le grand espoir du Parti Démocrate. C’était la belle époque où Washington découvrait cet escogriffe, un Mozart de la politique, un enfant du plus pauvre des comtés du Texas qui savait instinctivement flatter les puissants, s’installer dans leur orbe, faire parler de lui, s’élever vers la dernière marche de son ascension : la présidence.
Mais il y a pire. En novembre 1963, nous sommes à un an de la prochaine élection présidentielle, dont Kennedy est le scintillant favori. Le jeune homme bien né a choisi Johnson sur son ticket, trois ans plus tôt, à la surprise générale. C’était l’armistice d’un duel sanglant entre les deux hommes pendant la primaire démocrate : « LBJ », le Sudiste, devait apporter les voix du Texas et ses 24 grands électeurs, à Kennedy, le patricien de la côte est, ce qu’il fit efficacement. Johnson avait consenti à se contenter de ce rôle subalterne, depuis lequel, croyait-il, il pourrait fomenter l’étape d’après. Mais depuis deux ans, LBJ est un vice-président humilié. L’entourage de Kennedy le déteste : le vice-Président, pour eux, est un Président du vice. Il est le symbole vivant de la démagogie sinueuse, de l’opportunisme des apparatchiks, l’incarnation, au Sénat, d’un Parti Démocrate, qui, dans les 13 anciens États confédérés, défend encore la ségrégation. Titulaire d’une fonction qui ne sert à rien, dans l’ombre de l’astre le plus étincelant de la politique américaine, dépourvu de tout moyen de peser ou d’influer, LBJ est humilié par tous les membres de l’administration – plus diplômés, plus élégants, plus chics, plus cool que lui – et en particulier par Bobby Kennedy, le frère du Président et ministre de la Justice, son ennemi juré. Les brillants mondains de Georgetown le ridiculisent dans son dos, et parfois, à visage découvert – contrefaisant ce plouc texan à la voix théâtrale, avec ses habits grotesques, sa propension irrépressible à fanfaronner, ses mensonges. Johnson, qui, toute sa vie, a démontré un talent, pour ne pas dire un génie, pour savoir amasser, exercer, inventer même, le pouvoir, n’en a plus, du pouvoir, que les oripeaux. La situation avait déjà de quoi déprimer Johnson, et surtout l’inquiéter : pourquoi John Kennedy s’embarrasserait-il, lors de la prochaine campagne, d’un co-listier aussi irrémédiablement dépassé, déloyal, compromettant ? L’assurance-vie politique de l’ancien sénateur du Texas, c’était, précisément, son État, la promesse de l’apporter, une nouvelle fois, dans la corbeille présidentielle. Passé le mépris de JFK, ce dernier savait encore compter : le Texas, voilà la monnaie d’échange qui ferait perdurer le pacte. Mais en ce mois de novembre 1963, Johnson s’aperçoit que les fondements de son alliance s’effacent, et que sa place tout près du pouvoir s’éloigne. En voyage au Texas avec Kennedy – un voyage qui aurait dû être la mise en scène convaincante de son aura dans le Lone Star State – Johnson se rend compte que son roc électoral est devenu du sable. Un sénateur local refuse de monter dans sa voiture. Suprême humiliation : John Connally, le gouverneur du Texas, son ancien assistant parlementaire est assis, lui, dans la décapotable de JFK. C’est lui, Connally, que les télévisions filment, lui, le nouveau jeune prodige de la politique texane. Kennedy ne perd pas une miette de ce spectacle : Johnson, humilié à Washington, n’a plus aucune influence à Austin, Dallas, ou San Antonio. D’embarrassant, il a acquis la pire qualité pour un homme politique cherchant le pouvoir : il est devenu inutile.
Ce 22 novembre 1963 représente sans doute le tréfonds de l’humeur et le ressac le plus total de la carrière de Lyndon Johnson. Dans quelques mois, ni vice-Président, ni plus sénateur, il sera exactement ce qu’il redoutait d’être depuis toutes ces années ; depuis qu’il a vu son propre père, un petit représentant au Congrès de l’État du Texas, un idéaliste et naïf philosophe, perdre les élections, se ruiner, et mourir, comme tous les membres mâles de la famille Johnson, à soixante ans. De cette blessure d’orgueil, le fils aîné s’est résolu à faire le moteur de son ambition. Seulement, à cinquante-cinq ans, Lyndon Baines Johnson va redevenir un anonyme, un homme sans pouvoir, et pour lui, autant dire : un homme déjà mort.
Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas, à quelques mètres de Lyndon Johnson, chez lui, dans cette ville de Dallas dont il a courtisé patiemment les seigneurs pour devenir sénateur. L’Amérique a connu bien des tragédies : mais Pearl Harbor n’était pas diffusé en direct à la télévision. Là, tout un peuple tombe dans la sidération, le chagrin, le désespoir, comme si le pays entier n’était plus qu’un seul petit salon éclairé par la lucarne du poste, où des mots insensés s’égrènent les uns après les autres : « Le Président est mort à Dallas… ». Par extraordinaire, ce jour-là, à peu près aucun membre du gouvernement n’est à Washington. Les rumeurs de coup d’État vont bon train. Les Américains attendent un sauveur. Un homme qui démontrera que la République continue ; que la force des institutions surpasse celle des séditieux. Ils veulent un héros : et ils n’ont qu’un vice-président qu’ils connaissent depuis trente ans, un personnage exaspérant, odieux avec les faibles, flagorneur avec les puissants, allié aux pires réactionnaires du sud profond, un homme qui a érigé le mensonge dans sa vie privée et publique comme principe de gouvernement. Lyndon Baines Johnson prête serment, dans l’avion qui le ramène dans la capitale, à quelques centimètres du cercueil de Kennedy.
Et aussitôt, la plus incroyable des métamorphoses de l’histoire politique américaine s’accomplit. Elle s’accomplit dans une atmosphère de terreur, chacun minutant le début d’un cataclysme, une guerre avec Cuba, un mouvement de troupes soviétique à Berlin ou, tout simplement, l’effondrement de la plus grande démocratie du monde. LBJ a tenu à cette prestation de serment précipitée, pour démontrer aux yeux de la planète qu’il n’y avait pas de vacance du pouvoir. Le voilà dans le siège qu’il rêve depuis son enfance d’occuper. Il s’est préparé depuis des décennies – tous ses défauts et ses qualités, son intarissable énergie qui épuise ses collaborateurs, son pragmatisme d’airain, sa courtisanerie et parfois son courage : trente ans de vie politique se cristallisent en cet instant. L’ambition démesurée de Lyndon Johnson lui a conféré une ruse sans pareille, un art de « lire les hommes », une assurance illimitée pour exercer les positions de puissance. Et c’est exactement ce dont l’Amérique, dans cet instant, a besoin.
Arrivé à Washington, Johnson s’entretient avec l’entourage de Kennedy et ses ministres, qui, la veille encore, se faisaient un malin plaisir de ne pas tenir au courant le vice-président de réunions importantes. Johnson les charme un à un, avec sa diabolique plasticité, sa phénoménale perspicacité, avec son coup d’œil omniscient, mélange de cynisme et de psychologie, pour découvrir le point faible d’un interlocuteur. Au chef de cabinet de Kennedy, il fait vibrer la corde patriotique et joue l’humilité ; chez tel autre, il appuie la vanité ; chez des ministres loyaux, il en appelle à leur penchant pour la servitude, et se montre intransigeant. Il soude son gouvernement en quelques heures ; neutralise son ennemi, Bobby Kennedy, en un tournemain ; quelques jours plus tard, quand LBJ apparaît devant les chefs d’État étrangers pour la première fois, les diplomates de l’équipe Kennedy ont des sueurs froides. Comment va se passer la rencontre entre un personnage extravagant, gaffeur, insupportable de narcissisme, et la crème de la crème des puissants de ce monde, venus assister aux obsèques de son prédécesseur ? Eh bien Johnson est étourdissant. Dur avec le potentat soviétique. Cajoleur avec le Britannique. Altier et flatteur avec de Gaulle, à qui il arrache des rires, et une poignée de main chaleureuse.
Et pendant ce temps, Johnson ne s’arrête pas. Les deux grands projets de Kennedy, une loi sur les droits civiques pour mettre fin à la ségrégation, et une réforme fiscale pour les plus défavorisés, étaient bloquées au Sénat depuis quelques semaines ? Aucun des conseillers de la Maison-Blanche, ni Kennedy lui-même, n’avaient encore d’espoir de les sauver, face à un Congrès qui, certes démocrate, était aux mains du bloc du sud, raciste ? En quelques heures, Johnson dresse, devant son cabinet ébahi, un plan de bataille d’une suprême adresse. À ces intellectuels sortis des meilleures écoles, Harvard ou Princeton, lui qui n’a fréquenté que les bancs d’un lycée pour culs-terreux du Texas explique les lois de fer du débat parlementaire : il faut savoir compter les suffrages. Mais Johnson n’est pas seulement cynique. Il exhorte avec lyrisme tel ou tel gouverneur, prend à témoin l’opinion, soulève, même chez les plus idéalistes des conseillers qui le tenaient pour un opportuniste, une admiration incrédule. Il faut convaincre ? Johnson est né pour ça. Le « meilleur VRP de la politique américaine » se met au service d’une cause plus grande que lui. En quelques mois, les deux lois seront votées. Trois jours après la mort de Kennedy, enfin, Johnson s’avance à la tribune du Congrès. Lui, le génie de la politique qui s’est toujours révélé un piètre orateur, prononce un sermon bouleversant. Lui qui rêvait depuis son jeune âge d’occuper le Bureau Ovale, qui a passé des heures à courtiser sans aucune dignité Roosevelt ou Truman, qui a trahi, comploté, corrompu, séduit des hommes qu’il méprisait pour obtenir ce poste, formule d’une voix blanche une phrase qui chavire l’Amérique : « J’aurais tout donné pour ne pas être là aujourd’hui ». Puis il reprend, en évoquant le discours inaugural de JFK, qui avait exhorté l’Amérique à combattre le racisme et la misère : « Le Président Kennedy, le 20 janvier 1961 avait expliqué à ses compatriotes que la tâche historique de cette nation ne serait pas achevée ni les cent premiers jours de son mandat, ni pendant la durée de son gouvernement, ni même peut-être de son vivant. Mais avait-il dit : « Il nous faut commencer ». Aujourd’hui, mes chers compatriotes, dans ce moment, avec détermination, je vous le dis à présent : « Il nous faut continuer » ». Et Johnson, en effet, va continuer. L’enfant du Texas, le sénateur qui pendant dix ans a bloqué, davantage par calcul politique que par conviction, toute avancée vers la fin de la ségrégation, va donner, pendant son mandat, de 1963 à 1968, les droits civiques aux Afro-Américains, les rendre pleinement citoyens, leur ouvrir l’espace public, les cafés, les bus – il va venger les esclaves, délivrer Rosa Parks, favoriser, aussi l’intégration des Mexicains, de toutes les personnes de couleur. Johnson va devenir tout simplement le Président le plus important pour les Noirs américains depuis Abraham Lincoln, l’homme qui a aboli l’esclavage. Et il va lancer une « guerre contre la pauvreté » dont les résultats seront Medicare et Medicaid, la sécurité sociale américaine – l’avancée la plus ambitieuse dans l’État providence depuis Roosevelt, et jusqu’à Obama. Un ancien vice-président dont on n’attendait rien, et qui, une fois au pouvoir, bouleverse le cours de l’Histoire ? Et si Joe Biden était le nouveau Lyndon Johnson ?
À suivre…