J’ai rencontré Yann Moix le 31 octobre 1993.
Il m’avait adressé l’une de ces lettres que les jeunes gens, du temps qu’il y avait des lettres, envoyaient aux écrivains, mais auxquelles, pour ma part, je ne répondais presque jamais.
La sienne était-elle particulièrement bien tournée ?
Avais-je pressenti le personnage hors normes qui se cachait derrière cette écriture trop appliquée ?
Est-ce la loterie de la vie ?
Toujours est-il que je lui avais donné rendez-vous ce matin-là, 8 heures, Café de Flore, petite table au fond.
Et je vois arriver un jeune homme au physique de boxeur qui, pour parler comme la regrettée Françoise Verny, n’a pas précisément une gueule d’écrivain et à qui je demande, pour le tester, d’écrire pour La Règle du jeu, d’ici la fin de la semaine, un texte sur un film de Claude Berri, un autre sur Berlusconi et une nécrologie de Fellini dont on vient d’annoncer le décès.
Deux heures plus tard, j’ai les trois articles, stupéfiants de virtuosité.
Le mois suivant, je reçois les premières pages de son premier manuscrit, Jubilations vers le ciel, que publiera bientôt Grasset.
Et ainsi se noua, sous les doubles auspices de ma maison d’édition et de ma revue, un compagnonnage littéraire qui dure jusqu’aujourd’hui.
J’ai vite pris la mesure, naturellement, de la nature orageuse de Yann Moix, de ses embardées, de ses coups de sang.
Et j’ai également été informé, par des amis qui lui voulaient du bien, de l’existence de ces fameuses BD où j’apparaissais sous des traits infâmes et qui étaient l’œuvre, quoi qu’il en dise, non d’un «paumé», ou d’un «petit con», mais d’un antisémite.
Je n’ai jamais voulu rencontrer ces dénonciateurs, trop pressants pour être honnêtes.
Mais j’ai eu des explications musclées avec l’intéressé qui me confirma la réalité de cette part d’ombre ; qui trouva des mots qui me parurent sincères pour dire la honte que, désormais, ces insanités lui inspiraient ; et que je vis, d’abord avec circonspection, puis, petit à petit, avec respect, s’engager dans une âpre, rude et longue aventure intérieure dont l’enjeu devait être de traiter le mal par le bien et de l’arracher, une bonne fois, à ses anciens penchants criminels.
Car ce n’est pas une mince affaire que de tordre le cou, même quand on est très jeune, au vieil homme antisémite en soi.
Il ne suffit pas de dire «j’ai changé».
Ni de s’autoproclamer «meilleur ami des Juifs».
Et l’histoire – à commencer par celle des Juifs – ne connaît que trop ces retournements trop commodes dont le paradigme reste celui de Baalam, le mauvais sorcier, requis par le roi de Moab pour maudire le peuple d’Israël et à qui l’Éternel dit, au moment où il s’apprête à retourner ses malédictions en bénédictions : «Pas besoin de ta bénédiction, ils sont déjà bénis !».
Non.
Il y faut du caractère, une force d’âme, ainsi que des boussoles intérieures dont le futur auteur de Mort et vie d’Edith Stein était visiblement démuni et dont il eut à s’équiper.
Il y faut une rupture franche avec une société des amis du crime qui ne lâche pas aisément ses proies et dont j’ai compris, bien plus tard, qu’elle le faisait vivre sous la menace d’une sorte de chantage, goguenard et permanent, auquel il n’a pas toujours eu le cran, hélas, de résister.
Et puis il y faut un changement profond de l’âme, une conversion intellectuelle – et ce mouvement-là, ce creusement, cette plongée silencieuse dans les ténèbres de soi ainsi que dans la lumière des textes qu’il avait haïs de manière si vile, je suis mieux placé que beaucoup pour savoir, en revanche, avec quelle opiniâtreté il s’y est engagé.
Il y a eu la lecture du «Testament de Dieu».
Puis le choc Benny Lévy, dont la trajectoire le fascinait.
Puis l’œuvre de Levinas dont la découverte allait le transformer.
Et puis, à partir de là, un vrai cheminement de pensée qui l’a mené de la fange qui servit de théâtre à ses débuts à l’apprentissage de l’hébreu, à l’entrée dans le Talmud et à la découverte émerveillée de l’être-juif.
La question, dès lors, est : un homme qui a, jadis, commis pareilles bassesses peut-il réellement changer ? La réponse est oui. Pour peu – et je sais que c’est son cas – que ce changement soit le fruit d’un authentique travail sur soi, d’un effort de pensée et de connaissance honnête.
La question est : l’écrivain qu’il est devenu et qui avoue n’avoir longtemps pas eu le courage, par peur des représailles, de couper le contact avec ses anciens acolytes de la fachosphère reste-t-il comptable de ses errements passés ? La réponse est également oui. Et je soupçonne d’ailleurs le romancier d’Orléans d’avoir, presque à dessein, ouvert la boîte de Pandore d’où allaient inévitablement sortir les diables qu’il n’aurait peut-être pas eu le cœur, sans cela, d’exposer au grand jour et d’affronter.
Et puis la question est de savoir, enfin, si les autres, tous les autres, ceux qu’il a blessés ou déçus, peuvent, en conscience, lui pardonner. Et la réponse est encore oui. À une condition. Que ce pardon ne soit pas seulement donné, mais demandé. C’est ce qui se produisit, avec l’auteur de ces lignes, il y a bien des années. Et, pour les autres, vivants et morts, pour tous ceux qu’il a offensés, traînés dans la boue, salis, ce pardon fut solennellement demandé, hier soir, chez Ruquier.
Je crois au repentir.
Je crois à la réparation.
Et quand un homme, tout homme et donc, aussi, un écrivain donne les preuves de sa volonté de rédemption, quand il s’engage, avec probité, dans le corps à corps avec ses démons, je pense qu’il est juste de lui en donner acte, de lui tendre loyalement la main et, si on le peut, de l’accompagner.




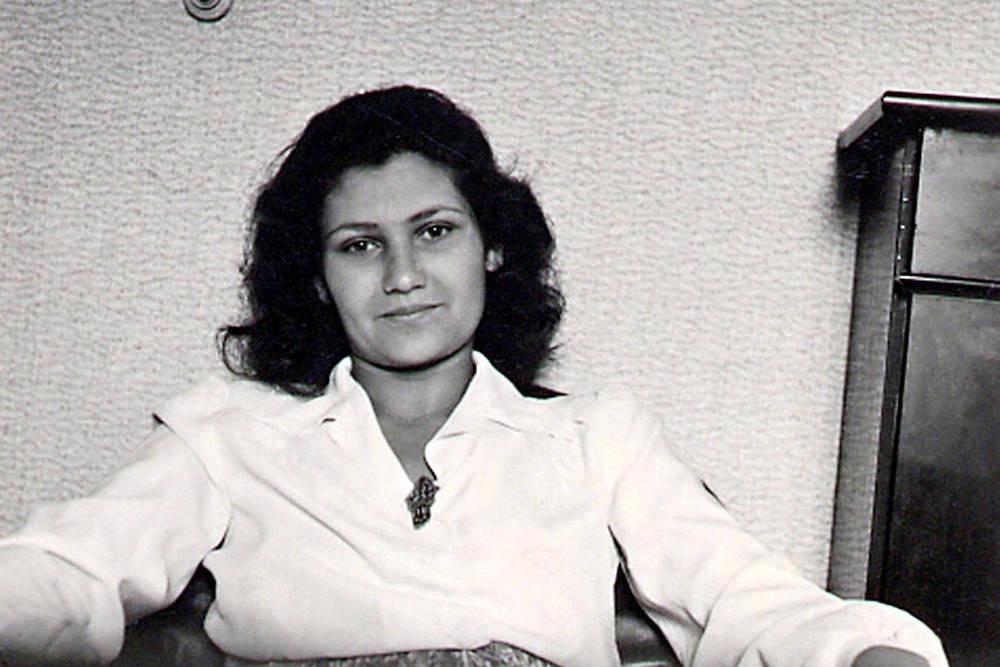



Pardonner et accompagner, absolument
Haut-le-cœur : Je vous avais pourtant prévenu que mon verbe agissait telle une main fouisseuse capable de soulever les questions les mieux refoulées. Les clarifications sont des obscurcissements pour le béjaune exorbité à la pensée qu’un resserrement de focale pourrait le projeter dans une zone de dripping dont il s’est persuadé qu’elle ne l’aspirerait pas dans son assourdissant entrelacs d’existats aussi longtemps qu’il l’ignorerait. Je préfère pour ma part m’en saisir à bras le corps, quitte à perdre un combat que ce dernier aurait d’emblée remporté si j’avais déclaré forfait. Mais puisque l’on me presse une nouvelle fois de m’essayer aux redondances de la simplification, je dirais donc que, selon moi, l’affaire Moix ne nous autorise que deux formes d’action défensive : 1) reprocher à Bernard-Henri Lévy d’avoir trahi notre confiance par le pacte diabolique qu’il aurait contracté avec l’auteur d’un crime imprescriptible dont il allait faciliter la dissimulation des traces ; 2) ne pas reprocher à Yann Moix de nous avoir caché une période effrayante de sa vie dès lors que l’homme éminemment éthique dont il avait obtenu le pardon lui conseillait de ne faire aucune révélation qui eût pu entraver le processus de rédemption qu’il avait amorcé. Est-il besoin de préciser de quel côté mon cœur balance ?
Celui qui décida d’assassiner une seconde fois les millions de martyrs de la Shoah n’a ni le parcours ni le profil d’un gladiateur ayant abandonné dans sa jeunesse l’étude de la Torah — il n’existe pas de réalité qui puisse en compenser une autre — pour nourrir une famille sombrant dans la précarité. Il serait par ailleurs obscène d’insinuer une équivalence entre l’ascension littéraire et cinématographique jalonnée de succès populaires de Yann Moix et la persévérance dans l’âpre voie de l’expiation d’un Amora du IIIe siècle. Ayant tordu le cou à ce parallélisme infâme, rien ne nous autorise à effacer de nos mémoires les modalités du virage de conscience à 180 degrés définies par le futur beau-frère du futur ex-brigand consacré en Baba Metsia, une courte échelle de Ia‘acob que les deux érudits se feront à tour de rôle et dont les derniers barreaux refermeront le Talmud de Jérusalem. Pour rappel, Resh Lakish ne se verrait pas infliger d’autre condamnation pour expier son fourvoiement passé qu’une promesse de repentance et de consécration à l’étude de la Loi. Je ne doute pas que cet Expositeur dont la force spirituelle s’avérerait égaler la puissance corporelle, réserverait à son sauveteur en Terre une place à part dans son palpitant. Il lui faudrait comprendre que, si l’ancien disciple de Rabbi Iehouda haNassi n’avait jamais possédé la faculté de lui délivrer un billet de Char céleste dont il ne ferait que lui indiquer la Voie et l’heure de départ, la main qu’il lui tendrait ne s’attellerait pas davantage à réchauffer son cœur en particulier mais, plus correctement, à empêcher que ce dernier n’abîmât son imago dans la mégalomanie d’anthropomorphoser la violence inhérente à l’entrechoquement des éléments inanimés. Cet homme, parce qu’indubitablement providentiel, n’allait pas se transformer en substitut de substitution chutant, ciel après ciel, à la manière d’un personnage que Tex Avery eût fait atterrir sur un autre en l’écrasant comme une carpette, et pour cause. La main secourable, tandis qu’elle se rapprocherait de ses faces au ralenti, n’aurait aucune intention d’exaucer son vœu le plus cher. Elle ne viserait jamais à empoigner la sienne en prélude à un enlacement caducéen, mais bien à projeter toute sa masse herculéenne hors du Moi pétrifié, de manière qu’il cessât d’attendre que le Mashia’h descendît vers lui seul, comprenant que c’était à lui d’aller, non pas vers les autres car, dans les autres, il y a aussi le mal, mais vers quelque événement proportionnel au désastre qu’il aurait évité, dont les retombées seraient bénéfiques à chacun de ceux qui en auraient uchroniquement réchappé. Les débuts de Jacques Vergès dans la Résistance n’auguraient pas l’immonde destin qu’il se forgea en devenant l’avocat des pires crapules de la planète. Ceux du jeune Josef Ratzinger ne présageaient a contrario rien de bon. Ne comptez pas sur moi pour accorder mon pardon à l’un des artisans de ce IIe concile œcuménique Vatican II qui demeure l’un des moments les plus christiques de l’histoire de l’Église ; encore une fois, les pouvoirs de l’être humain son bornés ; aussi me contenterai-je de suivre les voies impénétrables selon lesquelles le biberonnage au lait empoisonné de la Hitlerjungend ne disqualifie pas un homme dans le cadre d’une mission de rédemption d’envergure mondiale dont la nature, singulièrement universelle, n’en est encore qu’à ses balbutiements. L’affaire Moix nous chamboule. L’affaire Moix nous divise. D’aucuns déversent sur lui un torrent de soutiens, d’autres s’y refusent catégoriquement, viscéralement, mémoriellement, s’estimant victimes d’une trahison personnelle en deçà de la haute trahison. Je leur demande de prendre leur courage à deux mains et de mener le procès criminel à son terme sans mettre sous le boisseau la moindre circonstance atténuante, ou aggravante selon le point de vue duquel on se place. De fait, si Yann Moix nous a trahis en nous dissimulant un crime inexpiable, il y a de fortes chances qu’un traître en ait caché un autre, et quel autre ! quand le même directeur de conscience qui s’était octroyé le droit d’accorder son pardon à un écrivain négationniste sans juger utile de briefer ses frères d’armes sur la qualité de bois dans laquelle l’un des leurs s’était sculpté, allait pousser le vice en érigeant ce dernier des derniers en arbitre des élégances. À l’inverse, si l’attitude que le Sage d’Israël adopta envers Resh Lakish vaut pour tout autre criminel, nous ne pouvons pas reprocher au bienfaiteur du malfaiteur d’avoir tourné la page. À la limite pourrions-nous lui tenir grief de nous avoir fait lire un livre dont il avait escamoté un passage des plus cruciaux, nous privant de notre droit le plus strict de nous percevoir comme une belle petite bande de vauriens impliquée dans la protection d’un personnage indéfendable. Nous le pourrions, sauf à ce que notre chef de réseau ait préféré nous soulager du poids du secret en portant seul ce lourd fardeau, sachant pertinemment que la plupart de ses lecteurs n’étaient pas encore prêts à digérer une page de cette teneur. En l’état, ce grand machiavélien auquel nous avons reconnu une certaine aptitude à jouer un jeu dont il se sut toujours écarté du pouvoir d’en fixer la Règle, aurait eu de bonnes raison d’ensevelir un pilon de vérité qui, depuis quelques jours, nous broie les os de la tête. Comment voudrions-nous alors qu’il nous laisse accuser le principal bénéficiaire de son occultation de ne pas nous avoir mis sous le nez cette page dévastatrice de sa propre histoire, dès lors qu’en consentant à ce qu’elle fût arrachée en sorte qu’il pût construire sur d’autres bases sa légende personnelle, il ne faisait qu’observer avec rigueur notre règle commune ? Tout est encore affaire, eh bien soit. Qu’on se démène !
M. Bernard Henry Lévy,
Je ne connais de vous que vos apparitions à « Apostrophes » quand j’avais 14, 15 ans. La récente émission de france culture avec adèle van Reeth me donne le goût de vous entendre et maintenant de vous lire dans ce texte évoquant Yann Moix. Vous écrivez bien et c’est heureux de vous lire. Votre pensée fait du bien et je vous considère comme un médiateur. Si vous pouviez avoir cette fonction d’ouverture intellectuelle pour moi le temps de vous lire à travers des articles sur ce media que je reçois, je serais comblée. Les écrivains sont et seront toujours pour moi des boussoles car ils ne disent pas de bêtises. Ce qui est votre cas (je veux dire que j’aime ce que vous avez écrit à propos de yann Moix. La fin comme le début de l’article).
En ce moment, je suis plongée dans l’oeuvre de Chateaubriand qui,déjà à l’adolescence, m’a donné le goût de l’imaginaire…Et pour vous, est-ce une source que vous créditez ?
Un grand remerciement d’être si intelligent, prudent, en vie et d’aimer vos alliés les nécessaires hommes et femmes (écrivains, journalistes, bibliothécaires, conservateurs de musée, acteurs du patrimoine…que sais-je?)pour qui l’écrit est une boussole quand il sert le royaume de la belle pensée.
Cordialement, Brigitte M. aide-documentaliste et bibliothécaire (et éditorialiste à « Jeux d’Épreuves » revue de poésie et philosophie).