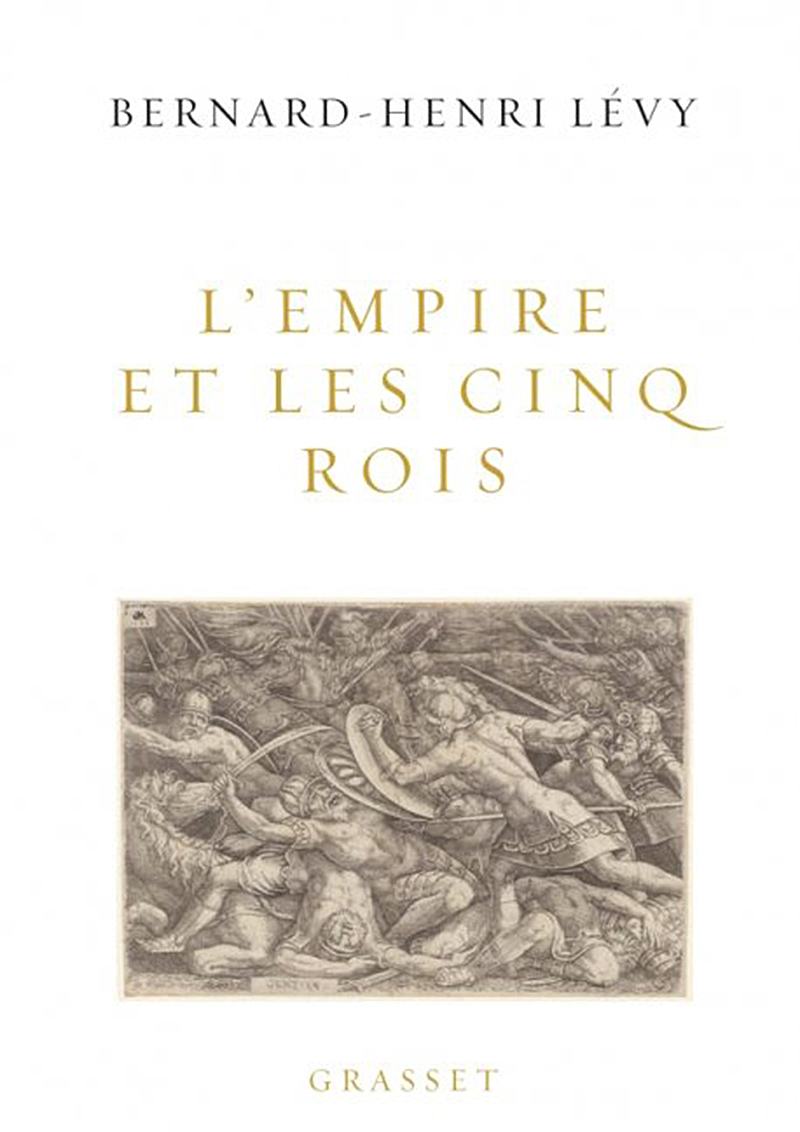Certains écrivains sont à leur meilleur à bord d’un aéronef, fixant tout droit l’horizon ; d’autres, sur un fil à plomb, ont le regard tourné vers le passé et retour au présent. Bernard-Henri Lévy – je m’autorise de notre amitié pour ne pas l’appeler «BHL» ; un esprit comme le sien mérite mieux que d’être siglé telle une marque –, considérant son énergie de journaliste et d’écrivain-voyageur, relève sans conteste de la verticalité du fil à plomb. Aussi bon témoin qu’il soit, il est à son meilleur par la mise à jour de connexions inexpliquées, de causes demeurées dans l’obscurité, de rapports surprenants.
Sur le mode journalistique où il excelle, ce nouvel ouvrage s’ouvre sur la tragédie de l’abandon dont ont été victimes les Kurdes et dont il fut le témoin privilégié. Mais très vite le livre prend une autre direction, et l’on entre dans la chaîne complexe des causes philosophiques et des connexions historiques qui ont amené à cet épitomé critique. Son travail est autant d’en montrer la cristallisation que de porter témoignage des batailles qui eurent lieu.
Sa thèse est que l’Empire américain, dans cette phase non pas géopolitique mais – belle trouvaille – géopoétique, est fini et que cinq puissances ressortent du passé pour s’en disputer la succession. La version américaine du capitalisme consumériste et son efflorescence dans des formes artistiques populaires irrésistibles, ont sculpté sans qu’ils en soient conscients jusqu’à ceux qui leur résistaient. Même au pic de la Guerre froide, il n’y avait aucun doute sur la direction dans laquelle soufflaient les vents.
Soudain, nous assistons à sa fin. Internet est à la fois l’apothéose de l’Empire et sa négation burlesque, l’expression la plus extrême de l’aventure américaine sans frontière, «océanique», une aventure en même temps complètement libertaire (le savoir jusque-là interdit y est entièrement à disposition) et concrètement totalitaire (abolissant tout caractère privé et offrant à la police chaque pouce de nos existences intérieures). C’est bel et bien l’épitomé de la décadence de l’Empire : son triomphe nous transforme nous-mêmes en esclaves de nous-mêmes. Créant son propre nouveau monde, l’Empire rend négligeable l’ordre politique américain et ses ambitions politiques.
L’hypocrisie planait sur le devenir possiblement tyrannique de ces applications aimables, ludiques et sans malice. En envisageant à haute voix que les deux logiques, commerciale et policière, puissent se conjoindre ou soient même, déjà, joyeusement liées, Lévy décrit, nomme et dénonce le visage apparemment souriant mais en réalité sinistre de ce dernier avatar de l’Empire.
Avec l’autodissolution de l’Empire américain, prend place une sorte de front «révisionniste» ou «revanchiste», composé de cinq pays bien décidés à redessiner à leur avantage la carte mondiale et des puissances.
Ces Cinq sont la Russie, la Chine, l’Iran, la Turquie et l’Arabie saoudite, ou, plus exactement, parce qu’ils signent le réveil d’anciens empires, les Ottomans, les Chinois, les Arabes, les Russes et les Perses. Tous sont des réalistes endurcis sur un mode que l’empire américain n’est, lui, plus du tout, et chacun affiche ses exigences sur la scène mondiale. Certains, la Turquie, l’Arabie saoudite resteront des puissances locales. D’autres, les Perses et les Chinois, mus par une idéologie impérieuse, semblent véritablement vouloir redessiner les cent prochaines années, ainsi que le firent les Américains au siècle passé.
Un essayiste américain se montrera légèrement envieux de la facilité avec laquelle Lévy crédite ses lecteurs de la faculté de saisir jusqu’à des allusions obscures et des références savantes. Dans une adresse publique, en Amérique, renvoyer à quelque chose qui date d’avant 1967 est considéré comme une posture intellectuellement prétentieuse, et, à cet égard, la liberté que s’octroie Lévy en décrivant le socle virgilien de la République américaine est aussi enviable que convaincante.
Ses références ne sont jamais des ornements rhétoriques ou tape-à-l’œil. Elles construisent une argumentation. Qu’il analyse l’idée de Dante d’une positivité du pouvoir impérial, qu’il établisse le lien entre Jeremy Bentham et Internet, Lévy est toujours percutant, un Américain parlerait ici de «fraîcheur», voulant signifier l’urgence et la surprise ressenties à la lecture. Le bien-fondé d’une allusion n’est pas ici son obscurité mais sa nécessité. Page après page, le lecteur se sent éclairé par l’ampleur des identifications. Lévy, en héritier, là, de Hegel, procède selon cette hypothèse totalement assumée que rien ne peut être compris sans remonter au cours général de l’Histoire au sens large. Et là, une note de courage moral irradie ses phrases ; rien de timide, de couard ou écrit selon une approche convenue. Son chapitre en faveur de l’empire est iconoclaste et courageux. Son passage sur la démence, au départ justifiée mais qui s’est criminellement généralisée, de la chasse aux sorcières contre tout homme qui, à un moment quelconque de son existence, se serait méconduit sexuellement est parmi ce qui a été écrit de mieux à ce jour sur ce sujet.
La thèse est brutale. Le déclin américain, sous la face souriante d’Obama, repoussante de Trump, est inéluctable. Les cinq Rois qui se disputent la place n’ont pas la moindre compréhension des valeurs démocratiques. Retour à l’ère des massacres et du pouvoir pur. Un libéral égaré, au sens américain du mot, peut-il avoir quelque espoir à offrir face à ce tableau d’un déclin et d’une chute irrémédiables ?
Le déclin de l’Amérique – au sens que lui prête Lévy d’un échec de la mission de l’Amérique à devenir une nouvelle Rome ou une nouvelle Jérusalem – est une évidence. Il nous faut accepter, le cœur serré, cette vérité qu’Internet est le triomphe tragique de l’imperium américain. On pourrait presque qualifier le monde de la Toile de Byzance américaine : poser à la nouvelle Rome nourrit, en fait, un empire bien plus autoritaire et hiérarchisé, qui a fort peu à voir avec les vertus intemporelles du modèle ancien de République. Nous sommes devenus soudain un peu plus qu’une autre Constantinople, un Etat absolutiste avec une industrie des loisirs florissante.
Le seul demi-espoir que nous puissions avoir tourne autour de la question de l’habilité à connaître l’histoire. Lévy demeure au fond de lui-même un hégélien, en ceci qu’il pense que nous pouvons préparer l’avenir si nous connaissons l’histoire dans ses profondeurs : c’est seulement en reconnaissant les vérités que l’histoire nous enseigne à ce moment précis de son cours, que nous pourrons agir avec discernement. Les libéraux américains, dans leur ensemble, ont tendance à être nominalistes et anti-hégéliens. Ils pensent que, certes, il y a beaucoup à apprendre des leçons de l’histoire que nous ignorions, qu’il est fou d’abandonner l’Europe de l’Est à une idée du Capital qui date du dix-neuvième siècle, tout aussi fou d’abandonner la Syrie à la cruauté de ses gouvernants. Telles sont les opportunités historiques que nous avons manquées.
Mais nous savons qu’en son absence, quelqu’autre Diable verra son jour arriver. L’Histoire est comme le vent qui souffle sur le monde : elle change sans cesse, dans une indifférence parfaite au bien-être des hommes. L’Histoire ne peut être connue ni prédite. Il est ô combien signifiant que les Japonais qui semblaient en pleine ascension il y a encore vingt ans, sont devenus largement invisibles et ne font pas partie ici des cinq Rois. Les directions et les voies empruntées dans l’histoire au présent changent à une vitesse ahurissante. Obama, quelque tort qu’il ait eu à propos de la Syrie, et qui contribua à la désastreuse trahison vis-à-vis des Kurdes, n’avait pas tort de se montrer extrêmement prudent quant aux ambitions messianiques de l’Amérique à l’étranger.
Le sophisme hégélien, tel que les libéraux américains peuvent le ressentir, est de penser qu’il nous revient de démêler l’histoire, de reconnaître le moment historique présent et la tâche qui va avec. Sauf qu’au vrai, l’histoire est inconnaissable, au point qu’en un sens elle n’existe même pas comme objet réel. Notre seule certitude est que l’histoire n’ira pas dans la bonne direction. L’unique vérité en histoire est que l’histoire prendra toujours un tour horrible. L’Histoire est l’histoire de ses tours horribles. Tout ce que nous pouvons espérer de faire est de construire et de soutenir les institutions qui détournent et empêchent ces tours d’entraîner des dommages maximaux. En ce sens, les présentes catastrophes n’ont pas lieu d’être l’objet d’explications à l’infini, même si l’analyse qui en serait faite soit fascinante. Les marées d’irraison qui balaient le globe sont la vie-même toujours recommencée du monde.
Le Diable arrive non pas parce que nous échouons à arrêter le cours de l’histoire ou à le modifier. Nous sommes impuissants à faire cela. L’Etat libéral n’est en rien du côté de l’Histoire. L’Etat libéral est la digue et le barrage qui nous protègent des méfaits de l’histoire et des marées permanentes d’irraison et de haine qui sont le vrai terreau de l’histoire. L’histoire-irraison. La démocratie ne l’emporte jamais. La question fondamentale n’est pas de savoir si l’histoire prendra le chemin de la démocratie libérale, mais si ce qui reste des institutions libérales sera suffisamment solide pour protéger l’Amérique et le reste de nous des méfaits de l’Histoire.