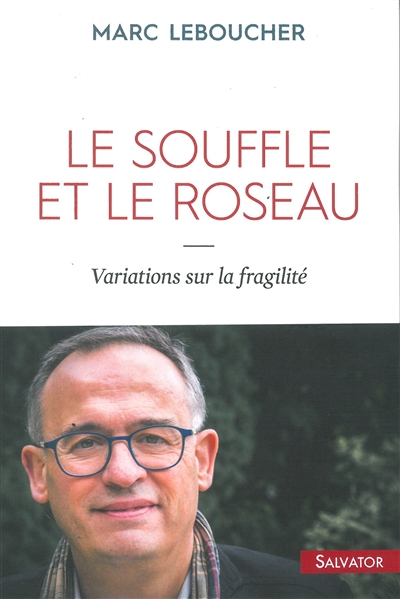Adorno et Jankélévitch sont assurément les deux philosophes importants du dernier siècle à avoir fait une place prépondérante à la musique dans leurs œuvres. Outre leurs livres sur la musique, beaucoup de leurs pages éparses ont pu constituer une heureuse suite à leur œuvre philosophique et musicologique. La musique plus métaphysique que la métaphysique au propre sens du mot : qui vient après la physique. Imagine-t-on, par exemple, Kant ou Hegel nous laissant un livre sur Bach ?
Ainsi, Albin Michel publie un recueil de textes peu connus, inédits ou depuis longtemps inaccessibles de Vladimir Jankélévitch, paru sous le titre L’Enchantement musical. Et, au même moment, un éditeur et essayiste, Marc Leboucher, a l’heureuse idée de publier Le Souffle et le roseau, où parmi tant de sujets théologiques, littéraires, moraux, la musique surplombe. Marc Leboucher est l’auteur d’un magnifique Folio biographies consacré au cantor de Leipzig, Johann-Sebastian Bach.
L’Enchantement musical de Vladimir Jankélévitch
Dans un important chapitre sur Liszt, Jankélévitch écrit à propos du «Chorus mysticus» : «Il y a des choses que seule la voix de l’homme peut exprimer.» Sur Schubert, et plus précisément à propos du «divin andante» de la 4e Symphonie, le philosophe soutient qu’il s’agit de «l’un des sommets de l’œuvre du compositeur». Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Jankélévitch ne voulait plus parler de ce qui était germanique, néanmoins et fort heureusement il écrivit et parla au moins de Liszt et Schubert – à défaut de Bach, Beethoven ou Mozart. Dans son texte «Franz Liszt et l’Europe», il analyse l’idée européenne du compositeur «dans la libre diversité des nations», développant ainsi le concept de pèlerinage, le rôle des Tsiganes, la question de l’exil. Inutile de dire combien ces questions sont actuelles. Jankélévitch y aborde la question capitale, pour lui, de l’opprimé. Pour Liszt, dans l’Europe du 19e siècle, un seul peuple mérite sa compassion, sa musique : les Tziganes dont la tradition musicale passe dans tant de ses œuvres. Qui sait encore que le compositeur écrivit un livre intitulé Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie ? Mais notre philosophe s’agace du fait que le génial Liszt soit «assez malveillant sur les Juifs», à une époque où les pogroms se multipliaient à l’Est, ne reconnaissant de valeur qu’au peuple tzigane, «ce peuple sans racine est aussi un peuple dépossédé, un peuple de prolétaires. Non seulement il n’est lié à rien, mais encore, il ne possède rien» (p.128-129). Jankélévitch ajoute «Ce qu’ils chantent, ils le gaspillent à tous les vents.» Il y a là comme une rupture entre le philosophe et le compositeur, mais suivent des pages somptueuses sur le pathos d’exil (p.132 sq).
La IIIe partie de L’Enchantement musical est consacrée aux musiques russes et françaises des 19e et 20e siècle, sur lesquelles le philosophe écrit des pages dont la profondeur s’allie à la beauté de la langue, sur Rimski-Korsakov, Ravel, Debussy et Fauré. Son hommage à Fauré, prononcé à Toulouse, à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort en novembre 1944, nous étreint et ses réflexions sur le Requiem épousent la sublimation de ses portées. La philosophie morale de Jankélévitch comme celle que symbolise son chef-d’œuvre intitulé Le je-ne-sais-quoi ou le presque-rien, sont une aventure philosophique unique en son siècle. Comment en effet philosopher sur un anti-concept, un je-ne-sais-quoi ou un presque-rien, qui sont par essence l’antithèse de toute pensée conceptuelle ? Est-ce dans la musique que Jankélévitch a conquis cette force fragile qui le rendit capable d’analyser les plus hautes questions philosophiques sur un air de je-ne-sais-quoi ?
Le souffle et le roseau de Marc Leboucher
Je voudrais aborder maintenant le dernier livre de Marc Leboucher, Le souffle et le roseau, car la musique le traverse de part en part. L’auteur est essayiste et un éditeur connu pour avoir longtemps été directeur littéraire chez DDB avant de rejoindre Salvator.
Dans ce petit livre si fragile et si profond par sa fragilité intrinsèque, Marc Leboucher raconte ses rencontres pour la vie avec la littérature, la poésie, le théâtre et la musique, grâce à certains êtres qui furent, pour lui, des passeurs. Marc Leboucher est habité par la fragilité des êtres, la fragilité du monde et celle de l’art. Avec Mauriac, voici l’irruption de Mozart mais voici surtout ce chapitre intitulé «Bach ou le marbre fissuré». Le marbre se fissure en effet quand Leboucher écrit sur la musique comme lorsque Jankélévitch le faisait. C’est à la chanteuse et compositrice Mireille que le jeune Marc doit sa «première émotion musicale» avec le disque Colargol. Puis c’est par un vieux disque tout grésillant qu’il entendit pour la première fois le «Choral du Veilleur», la Badinerie et le choral «Jesus bleibet meine Freude – que ma joie demeure» de l’immortel JS Bach. Si Bach peut, au premier abord, paraître marmoréen, immuable, Leboucher nous fait découvrir «la fragilité qui nous le fait si proche» (p. 131). Il nous rappelle aussi que Walter Carlos – devenu Wendy Carlos lorsqu’il change de sexe dans les années 1970 –, interpréta au synthétiseur les Inventions à deux et trois voix du père de la musique moderne. Bach, sur la pochette du disque, «se découvrait pop star […] avec un casque sur les oreilles» (p.135-136). Dans sa fragilité, le cantor de Leipzig nous touche plus encore. Ses dernières années ne furent pas épargnées.
«La douloureuse fuite d’un fils et sa disparition au loin et l’incompréhension artistique des générations nouvelles, qui ne jurent que par les mélodies trop simples et la galanterie. Mais toujours Bach se refuse à la mode. Inflexiblement.» (p.140)
Le chapitre se clôt sur l’évocation d’Adolf Busch «opposant farouche au nazisme», qui interprétait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale «la gigantesque Chacone de Bach. La fragilité ose alors l’impossible emploi, où personne ne le vaudra : la force. Ainsi l’innocence ose donner l’exemple» écrit l’éminent musicologue André Tubeuf dans son Adolf Busch, le premier des Justes (Acte Sud, 2015).
Dans sa conclusion, Leboucher use d’une anaphore qui ponctue chaque fin de partie :
«Je crois au Dieu de la tempête apaisée. Je crois au Dieu des larmes. Je crois au Dieu des sens. Je crois au Dieu de la rencontre. Je crois au Dieu de l’histoire, Dieu des fragiles, Dieu des roseaux.»
Leboucher connaît à n’en pas douter la sublime parole du swami Vivekananda (1862-1902), que Romain Rolland rendit célèbre en France dans les années 1930 par sa biographie :
«Le seul Dieu qui existe, la Somme totale de toutes les âmes, et par-dessus tout, mon Dieu les méchants, mon Dieu les misérables, mon Dieu les pauvres de toutes les races.»
La musique est si fragile qu’il faut la protéger contre ceux qui voudraient l’interdire dans quelques contrées du monde. Il faut la protéger aussi contre ces criminels qui viennent verser le sang et la désolation dans certains concerts de rock ou de pop…
À sa dernière page, il évoque L’homme qui marche de Giacometti, dans sa fragilité, dans sa volonté, dans sa grâce aussi.
La fragilité et la révolte de la musique
À quelques décennies de distance, Jankélévitch et Leboucher nous invitent à faire un voyage saisissant dans le fragile, dans la grâce de la musique, parfois dans la révolte bien sûr, mais toujours à la rencontre de la fragilité éternelle de l’art, de la musique qui fait pleurer, qui fait exulter, qui «donne une âme à nos cœurs, des ailes à la pensée», comme disait Platon voici quelques millénaires. «La musique seule peut parler de la mort» a écrit Malraux.
Leboucher et Jankélévitch nous le rappellent de la façon la plus inspirée.