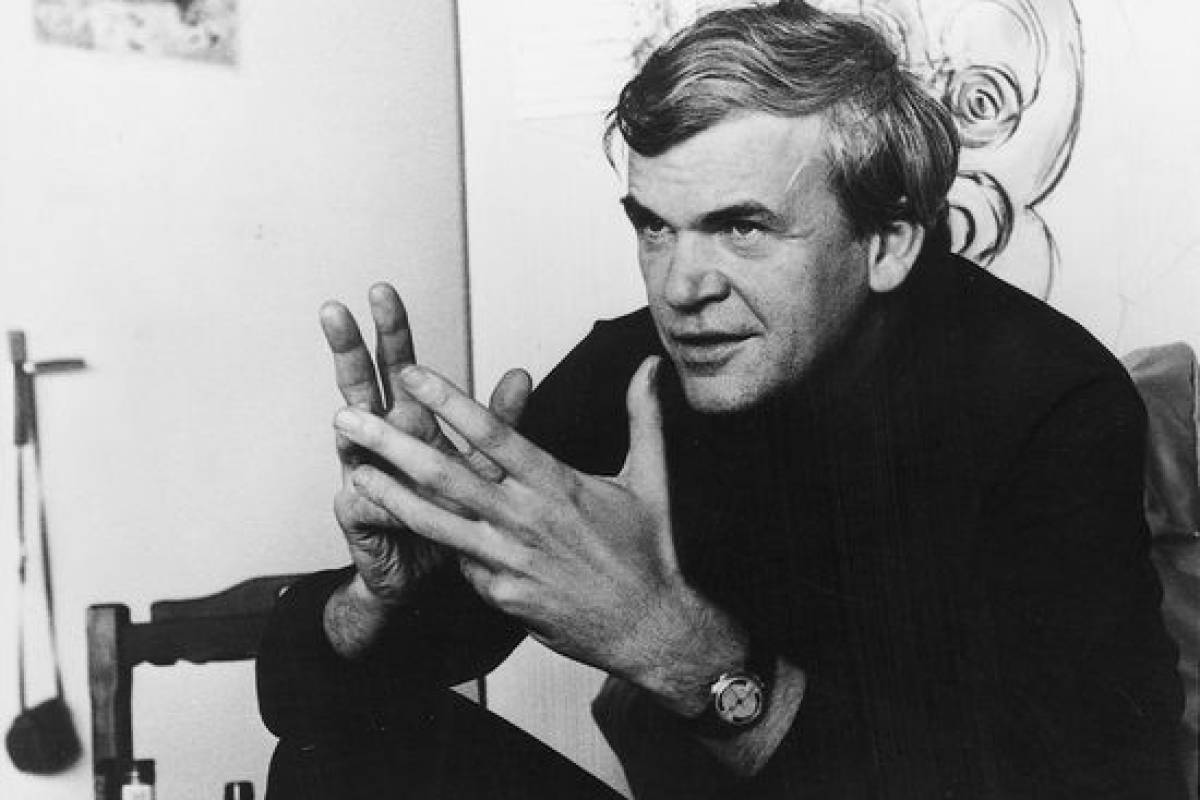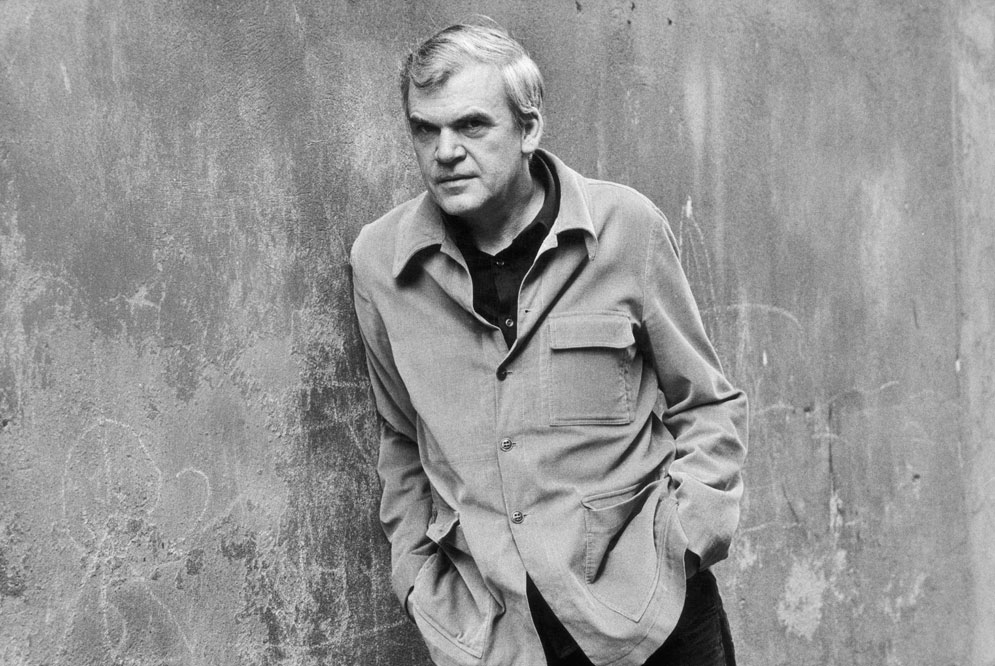Guy Scarpetta : Tu évoques dans L’Art du roman, à propos de Tristram Shandy de Sterne et de Jacques le fataliste de Diderot, « deux sommets de la légèreté jamais atteints ni avant ni après ». Qu’est-ce qui, selon toi, fait du XVIIIe siècle, en ce qui concerne le roman, une période d’exception ?
Milan Kundera : Pas une période d’exception. Mais pourtant, un très grand siècle du roman. Qui a connu une plus grande liberté formelle que le siècle suivant, et qui a moins été dominé par l’esprit de sérieux.
G. S. : En quoi te considères-tu, dans ta propre écriture romanesque, comme un héritier du XVIIIe siècle ?
M. K. : Surtout en la présence constante de la pensée, de la réflexion, dans le roman. Ce n’est pas seulement une question de capacité intellectuelle de la part du romancier. C’est aussi une question de forme. Il faut un type de composition où la pensée trouve sa place. Il y a deux formes romanesques dominantes au XVIIIe siècle : primo, celle provenant du vieux roman picaresque ; pendant l’évolution de cette forme, le narrateur s’est approprié une très grande liberté, le « droit de faire des digressions quand il lui plaisait », comme disait Fielding. Cette forme a atteint une virtuosité ludique chez Sterne et Diderot, pour qui l’histoire joue un rôle infime en comparaison avec les digressions et leurs feux d’artifice. Ensuite, l’autre forme, née au milieu du XVIIIe siècle : le roman par lettres. Cette composition elle aussi offre une très grande liberté formelle, car une lettre, tout à fait naturellement, peut tout contenir : des réflexions, des confessions, des souvenirs, des analyses politiques, littéraires, etc. Hélas, cette forme magnifique n’a pas trouvé des romanciers aussi magnifiques qu’elle. Voilà une des occasions perdues dans l’histoire de l’art. Le seul roman par lettres qui est vraiment un grand roman est celui de Laclos.
Ajoutons encore un autre avantage de cette forme : le roman par lettres est nécessairement raconté par plusieurs personnages ; l’histoire (story) est donc vue sous plusieurs angles ; on arrive (ou plutôt : on aurait pu arriver, s’il y avait eu de grands auteurs de romans par lettres) à une extraordinaire relativisation de la réalité (cette relativisation de la réalité qui, selon moi, est la base ontologique de l’art du roman). J’ai toujours été frappé par la parenté formelle qui lie Les Liaisons dangereuses et Tandis que j’agonise de Faulkner.
Extraordinaire changement de forme au commencement du XIXe siècle : le roman se concentre radicalement autour d’une seule intrigue, sa composition est dramatisée, débarrassée de tout ce qui n’est pas nécessaire pour l’histoire (story). Dès cette époque, la réflexion apparaît comme un élément étranger au roman, et les critiques s’acharnent sur les romanciers qui osent penser dans leurs romans : « Ce n’est pas du roman ! » ; ou : « Il est trop intelligent pour être un vrai romancier ! » etc. Tu connais la chanson.
Pour revenir à ta question : le retour aux formes du roman du XVIIIe siècle est, bien sûr, impossible (ou il aurait le caractère un peu désagréable d’un pastiche) ; si un romancier contemporain sent le besoin de donner à son roman une grande dimension réflexive, il ne peut le faire sans inventer des formes nouvelles, inédites.
G. S. : Tu désignes, (toujours dans L’Art du roman), un texte de Vivant Denon comme « une des plus belles proses françaises ». Peux-tu nous en dire un peu plus sur cette admiration ?
M. K. : Le grand sujet du XVIIIe siècle : le plaisir. L’hédonisme. La valeur du plaisir. Mais aussi la difficulté, voire l’impossibilité de l’hédonisme. Laclos : l’érotisme en tant que jeu. Mais le jeu devient vite compétition et la compétition devient lutte pour le pouvoir. Et où est le plaisir quand on lutte ? Rien de plus fugitif, insaisissable, que le plaisir. Seuls les moralisateurs voient l’hédonisme partout. En réalité, il n’est nulle part. Chez les romantiques, il se perdra sous l’avalanche de la sentimentalité. À notre époque, le culte de l’indiscrétion et de l’impudeur n’a rien à voir avec l’hédonisme, au contraire, au contraire. La nouvelle de Vivant Denon Point de lendemain est la plus belle leçon d’hédonisme que je connaisse. Le personnage de Madame de T… est, en quelque sorte, une anti-Merteuil. Elle vit avec le jeune protagoniste une nuit d’amour qui se referme derrière leur plaisir comme si rien ne s’était jamais passé. Le matin, le jeune homme est obligé de voir le mari et l’amant de Madame de T…, mais il ne triomphe pas. L’amant est persuadé de s’être servi du jeune homme pour détourner l’attention du mari, et n’a, à son égard, pas le moindre soupçon. Au contraire, à ses yeux, le jeune homme a joué un rôle plutôt ridicule. Le plaisir et la vanité sont ici absolument séparés. Plus que séparés. Incompatibles. Opposés. C’est là, la sagesse de cette nouvelle. Point de lendemain : un conte sur le plaisir pur.
G. S. : On peut repérer, aussi bien dans tes essais que dans tes romans, une série d’oppositions. D’un côté, le paradigme du jeu, du libertinage, de l’humour, de l’élégance. De l’autre, le paradigme de l’authenticité, de l’amour-passion, (ou du romantisme), de la bien-pensance, du kitsch. Autrement dit : le XVIIIe siècle contre le XIXe. Sommes-nous condamnés à rejouer sans fin cet affrontement ?
M. K. : Je n’opposerai pas aussi strictement un siècle à l’autre. Le XIXe siècle n’est pas seulement le siècle de la bien-pensance, mais aussi celui du plus grand critique de la bien-pensance qu’était Flaubert. Et le XVIIIe, ce n’est pas seulement le libertinage, mais aussi le sentimentalisme qui commence alors. Pourtant, nous sommes par notre éducation les enfants du XIXe siècle, et beaucoup moins enfants de Flaubert qu’enfants du romantisme et du kitsch. Comprendre le XVIIIe (surtout son côté libertin) nous pose donc des difficultés. Exemple : la version cinématographique des Liaisons dangereuses réalisée par Stephen Frears, que nous avons eu l’occasion de voir récemment au cinéma. Le cinéaste a ressenti le besoin de donner une explication à la méchanceté de Madame de Merteuil : il a donc fait sous-entendre qu’elle avait aimé Valmont d’un amour malheureux. Car seule une blessure sentimentale est en mesure de rendre la méchanceté supportable pour les enfants du Kitsch. Presque la justifier. Mais cela, bien sûr, n’a rien à voir avec la Merteuil de Laclos. Valmont, à la fin du film, en agonie, déclare son amour pour la Présidente. C’est grotesque. C’est Laclos vu à travers les lunettes du romantisme. Corrigé par le romantisme. Laclos escamoté. Dérobé. Devenu un autre. (Confirmation de ma vieille expérience : les adaptateurs trahissent l’oeuvre adaptée non pas dans des détails, mais toujours dans son essence. Car curieusement, dans le ton, dans une certaine froideur de la mise en scène, le film est presque – n’exagérons pas : j’ai bien dit « presque » – laclosien.
G. S. : Tu as évoqué, une fois, la façon dont la musique précédant le classicisme avait été, d’une certaine façon, ressuscitée par la modernité. Peut-on dire la même chose, par exemple, à propos de la littérature ?
M. K. : Tu fais allusion au petit texte que j’ai publié, en 1989, dans le numéro de l’Infini consacré à Voltaire. Dans le dernier numéro de la même revue je publie Improvisation en hommage à Stravinski, un long essai où je reviens largement sur toutes ces idées. Ce qui me tient à cœur est ceci : toute une grande histoire du roman antérieure au XIXe siècle, de Rabelais à Laclos, de Cervantès à Sterne, est restée négligée, mi-oubliée, derrière l’esthétique romanesque du XIXe siècle. Le modernisme universitaire des années soixante, en contestant le soi-disant roman traditionnel, n’a visé en fait que l’esthétique d’une seule courte phase du roman qu’il a hypostasiée : celle du commencement du XIXe siècle. Ainsi n’a-t-il fait que confirmer et corroborer le plus grand tort du roman du XIXe siècle : l’oubli des siècles précédents, et ce qui a résulté de cet oubli : la réduction de la notion même du roman. Les grands modernistes du roman (Joyce, Kafka, Musil, Gombrowicz, Fuentes, etc.) se sont toujours opposés (programmatiquement ou spontanément) à cette réduction.
Tu m’interroges sur le XVIIIe siècle, mais quand je parle du roman qui a précédé l’esthétique de Balzac je pense également, sinon encore plus, aux siècles d’avant le XVIIIe. À Rabelais avant tout. Je suis toujours surpris par le peu d’influence que Rabelais a pour la littérature française. Diderot, bien sûr. Céline. Mais en dehors de cela ? Gide, en réponse à une enquête en 1913, désigne comme les plus grands romans français : La Princesse de Clèves ; Les Liaisons dangereuses ; Dominique ; Madame Bovary ; Germinal. Étrange, l’absence de Rabelais dans ce palmarès. Ou bien Rabelais est pour Gide un romancier moins important que Fromentin, ou bien, ce qui est plus probable, Rabelais, pour lui, n’est pas romancier du tout : voilà ce que j’appelle la réduction de la notion même du roman.