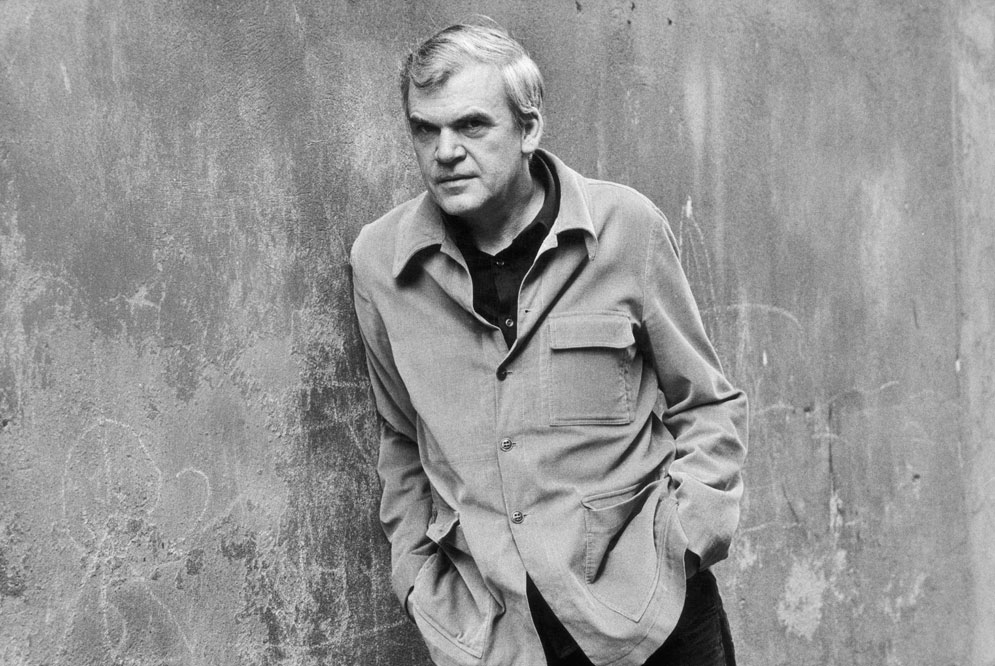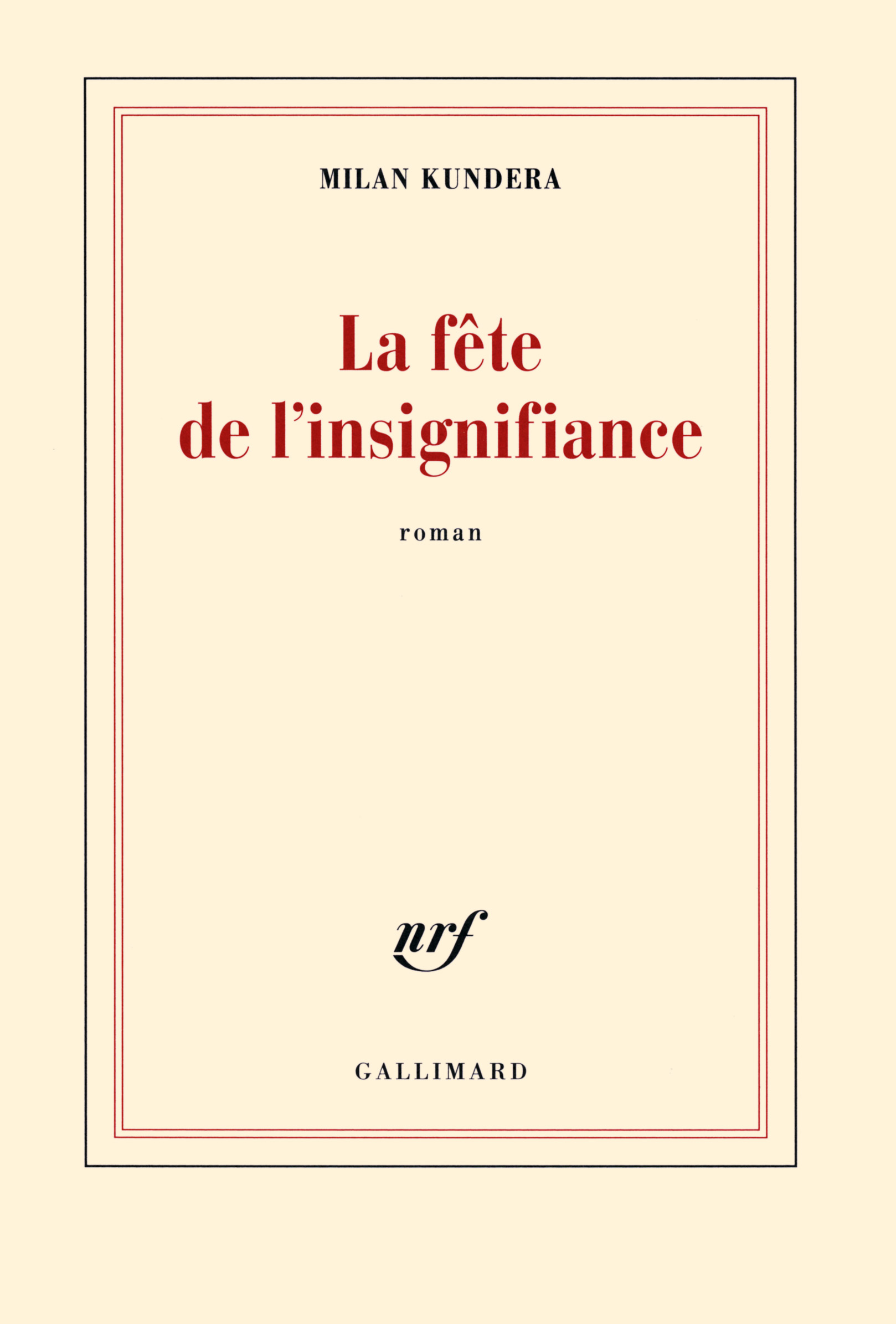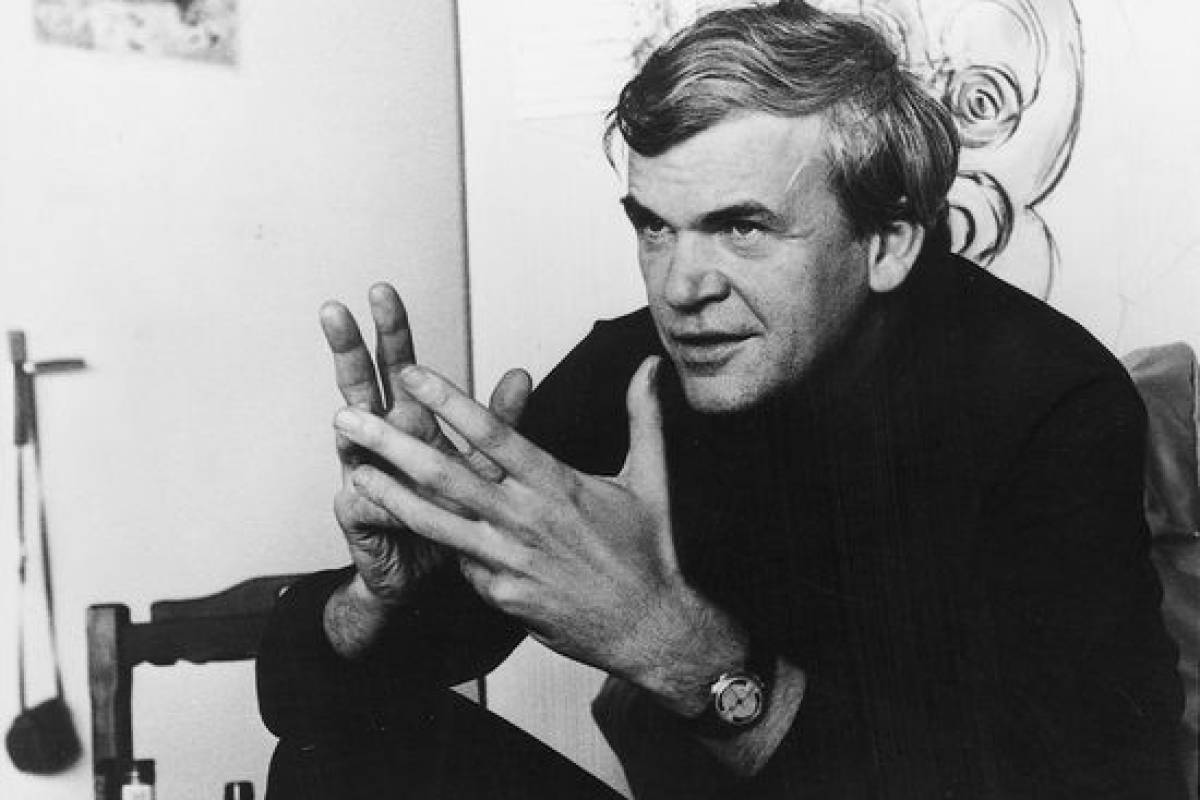Dans le numéro 16 de La Règle du Jeu, publié en 1995, la revue s’entretient avec Milan Kundera autour de son roman La Lenteur, paru la même année. Avec La Lenteur (Editions Gallimard, janvier 1995), Milan Kundera a écrit son roman sans doute, le plus léger (d’une légèreté qui n’a rien d’insoutenable, et qui, comme le disait Debussy, s’oppose à la lourdeur, non à la profondeur). Cette œuvre a pu donner lieu, ça et là, à des commentaires pour le moins hasardeux. Kundera s’explique, ici même, sur la « bonne humeur » qui présidait à l’entreprise, et à côté de laquelle bon nombre de comptes rendus semblent être passés. Il en a profité pour réitérer sa condamnation de toute forme de « romans à clés », et s’étonne qu’on ait pu le lire dans cette perspective.
Guy Scarpetta : Cher Milan, au sujet de ta Lenteur je voudrais te poser quelques questions, par écrit, comme tu le souhaites et comme cela est déjà devenu notre habitude dans La Règle du Jeu. Voilà ton premier roman écrit en français. Peux-tu évoquer ce qui t’a poussé à franchir le pas ? Ce changement implique-t-il aussi une transformation subjective ? En plus, la forme aussi a changé : non seulement la disparition de la fameuse composition en sept parties, qui ordonnait tes romans antérieurs – mais surtout un ton plus libre, plus désinvolte, qui fait parfois penser à une improvisation. Les règles de composition dont tu parlais dans L’Art du roman sont-elles abandonnées ? Ou sont-elles simplement devenues moins explicites, plus dissimulées ?
Milan Kundera : Cher Guy, c’est avec plaisir que je lis tes questions et que je te réponds. Avec L’immortalité j’ai épuisé toutes les possibilités d’une forme qui avait été jusqu’alors la mienne et que j’avais variée et développée depuis mon premier roman. Subtilement, cela fut clair : ou bien j’étais arrivé, comme romancier, au bout de mon chemin, ou bien j’allais découvrir encore un chemin, tout à fait autre. D’où aussi, peut-être, ce désir invincible d’écrire en français. De se retrouver tout à fait d’ailleurs. Sur une route insoupçonnée. Le changement de la forme fut aussi radical que celui de la langue. La composition ? Non, elle n’est pas devenue moins importante. Elle est seulement très différente.
G. S : Dans L’Art du roman, tu évoquais les conditions pour que des pensées « arbitraires » soient justifiées dans un roman : qu’elles soient ludiques, hypocrites (c’est-à-dire qu’elles ne relèvent pas de la vérité absolue ou de la conviction). On a un peu l’impression, dans la première partie du roman, que le narrateur élargit ses droits en ce domaine – avant que la comédie ne prenne le dessus. Est-ce une impression trompeuse ?
M. K. : Je crois qu’elle est trompeuse. Le caractère « ludique » des réflexions me paraît dans La Lenteur encore plus évident qu’ailleurs. Le discours ludique, cela ne veut pas dire que l’auteur a le visage crispé par le rictus d’une plaisanterie perpétuelle mais plutôt que, d’une façon inaperçue, il passe d’une blague à une observation sérieuse, d’une remarque exacte à une énormité, etc. Cette oscillation entre le sérieux et le non-sérieux laisse le lecteur dans une constante incertitude et donne à l’ensemble ce ton de jeu. A propos, Thomas Mann se sentait toujours incompris, tu sais pourquoi ? Ses lecteurs ne trouvaient pas l’humour derrière le ton apparemment professoral de ses romans. Il se sentait déprécié en tant qu’humoriste. J’ai une tentation de proclamer en hommage à lui : l’humour le plus sublime est celui qui avance masqué et passe complètement inaperçu. (Voilà en même temps l’exemple d’une phrase ludique : est-elle une blague ou est-elle sérieuse ?)
G. S. : Dans Les Testaments trahis, tu opères une distinction radicale entre le roman (dont la valeur réside « dans la révélation de possibilités jusqu’alors occultées de l’existence en tant que telle ») et les Mémoires, les chroniques, les autobiographies (dont la valeur réside « dans la nouveauté et l’exactitude des faits réels révélés »). Ce qui te permet, dans la foulée de condamner le roman à clés comme un « faux roman, chose esthétiquement équivoque, moralement malpropre ». Or, il se trouve que certains ont cru repérer des « clés » dans La Lenteur, et notamment en ce qui concerne les personnages de Pontevin et de Berck. Est-ce une erreur de lecture ? Ou est-ce toi qui a assoupli ta position ?
M. K. : Non, aucun assouplissement de ma position à l’égard des romans à clés avec leurs allusions perfides ad hominem ; je les abhorre. Les danseurs de mon roman ? Pontevin ? Berck ? Le savant tchèque ? Oui, j’ai entendu moi aussi de curieuses conjectures. La dernière en date ; Jacques-Alain Berck — Léon Schwartzenberg ! Tu as remarqué ? Les deux noms riment ! N’est-ce pas la preuve irréfutable ? Dis-moi, Guy, pourquoi les gens ne savent pas lire les romans ? Pourquoi ont-ils besoin d’y chercher de stupides dénonciations mondaines ? Etre danseur, c’est une possibilité humaine ouverte à chacun de nous. C’est son universalité qui m’intéresse et ce depuis le temps où, il y a trente ans, encore à Prague, j’ai observé et étudié, avec fascination, les premiers danseurs de ma vie.
G. S. : Dans Les Testaments trahis, toujours, tu écris ceci : « il n’y a pas de place pour la haine dans l’univers de la relativité romanesque : le romancier qui écrit un roman pour régler ses comptes (que ce soient des comptes personnels ou idéologiques) est voué à un naufrage esthétique total et assuré. » Au-delà des contre-exemples qu’on pourrait t’objecter (n’y a-t-il pas une large part de « règlements des comptes » chez Céline, ou chez Thomas Bernhard ?), est-ce qu’il n’y a pas aussi des règlements de comptes (envers la modernité, l’idéalisation, le spectacle) sensibles dans La Lenteur, dès lors qu’une veine satirique peut s’y déceler (cette veine satirique qui me semble d’ailleurs contredire le refus de la satire que tu proclames dans Les Testaments) ?
M. K. : Lisons les phrases dans leur contexte. Celle que tu cites se trouve dans le passage où je parle de Salman Rushdie dont le roman a été à son époque unanimement interprété comme un règlement de comptes avec l’Islam. C’est contre cette fausse interprétation, fatale pour Rushdie et pour son roman, que j’ai réagi en disant « il n’y a pas de place pour la haine dans l’univers de la relativité romanesque ». C’est d’ailleurs dans cette absence de haine que se trouve la distance infinie qui sépare Salman Rushdie de Taslima Nasreen dont le roman, précisément, n’est rien d’autre qu’un règlement de comptes avec les musulmans et, partant, « un naufrage esthétique total et assuré ». Mais je ne pourfends pas la haine tel un curé prêchant l’amour. La haine a sa place dans l’art, elle a inspiré de grandes poésies lyriques ! Je ne parle que du roman et je n’en parle que tel que je le comprends : l’art basé sur les personnages imaginaires qui habitent le monde des Temps modernes abandonné par la « vérité unique ». Or, la cause au nom de laquelle le romancier règle les comptes se transformera automatiquement en une fausse vérité unique qui gouvernera le roman. Et la haine risquera d’aveugler l’auteur qui ne verra de ses personnages que des silhouettes. Mais remarque bien que dans la phrase que tu cites, je parle textuellement des règlements de comptes personnels, politiques, « métaphysiques ». Avec Dieu, avec la création, par exemple. Mais dans ces cas-là le mot « règlement de comptes » serait inapproprié car tu ne peux rien régler avec ce qui te dépasse. Parlons plutôt des désaccords métaphysiques : désaccords célinien avec l’humanité, flaubertien avec la bêtise, rabelaisien avec l’esprit du sérieux (l’esprit des agelastes), désaccord avec l’Histoire, avec une époque, avec soi-même, avec la réduction idéologique du monde, etc. Si tu trouves une sorte de tels désaccords dans mes romans, tu m’as bien lu.
Encore à propos de la satire. En effet, je ne l’aime pas. Je sais, humour, satire, ironie, comique, ces termes sont flous et on peut les comprendre de diverses manières. Pour que je me fasse entendre, puis-je ouvrir mon exemplaire usé de L’Esthétique de Hegel ? Laisse-moi franciser ce qui est dit de la satire : « Ne pouvant réaliser son idéal dans le monde de vice et de déraison, la conscience vertueuse d’un esprit noble, plein d’indignation passionnée ou d’amertume glacée, s’insurge contre l’état qui l’entoure, s’emporte contre ce qui contredit son idéal abstrait de vertu et de vérité, et raille le monde. » Je souligne : le sine qua non de la satire c’est une conscience vertueuse indignée. La satire est un exercice moralisateur ! Elle n’a rien à voir avec un « désaccord métaphysique » ! Au contraire, elle a devant elle des cibles par trop « physiques » et, derrière, un « idéal abstrait » qui, tel un délateur, les lui désigne. Hegel n’a eu que méfiance envers la valeur esthétique de la satire : « Le sujet qui, avec dégoût, se fixe sur la disharmonie qui existe entre les principes abstraits de sa propre subjectivité et la réalité empirique, ce sujet n’est capable ni éprouver ni irradier aucun plaisir et, partant, de créer aucune poésie authentique, aucune œuvre d’art vraie. » J’applaudis ! Et je vais te citer encore ce que Hegel dit sur la poésie du comique qu’il oppose à la satire : « Ce qui fait partie du comique c’est l’infiniment bonne humeur et la conscience d’être élevé au-dessus de nos contradictions intérieures, de sorte que celles-ci ne nous rendent ni amers ni malheureux ; notre subjectivité est à tel point joyeuse et sûre d’elle qu’elle peut supporter l’échec de ses desseins et l’impossibilité de leur réalisation. » Le fondement de l’humour, c’est donc, pour l’esthétique classique, la bonne humeur. Mais dans notre époque, qui n’est toujours pas sortie du romantisme, les gens sont méfiants envers la bonne humeur. C’est la souffrance qui, selon eux, est l’inspiratrice du grand art, tandis que la bonne humeur n’est bonne que pour la digestion. Je demande souvent aux lecteurs de La Lenteur : « Avez-vous ri ? » Ils me répondent comme si je leur tendais un piège : « Oui, mais votre rire est jaune ! » Oh non, oh non, mon rire n’est pas jaune, je vous assure, c’est le rire de la bonne humeur. Et il n’est pas du tout incompatible avec ce que nous venons d’appeler désaccord métaphysique ! Tu peux être en désaccord le plus total avec le monde et en même temps te réjouir de tes inventions, de ta fantaisie, et, comme dit Hegel, irradier le plaisir.
Je te concède que telle ou telle page peut donner une impression satirique comme par exemple celle où Pontevin se moque de Berk mais, en art, il faut juger toujours le tout, l’ensemble, la signification globale d’une œuvre. Car continue à lire : Pontevin, ce fustigeur des danseurs est lui-même un incorrigible danseur quand il voit s’approcher une femme. Et Vincent qui veut railler l’exhibition de Berck finit par s’exhiber lui-même devant le public (qui d’ailleurs n’est même pas arrivé) en simulant le coït avec une fille qui, à cause de cette exhibition, lui échappera à jamais. Non, aucune conscience vertueuse n’a voulu fouetter les vicieux. Une conscience vicieuse (la mienne) a voulu découvrir et saisir le phénomène existentiel des danseurs. Mettre en scène (pour notre bonne humeur !) une comédie des danseurs.