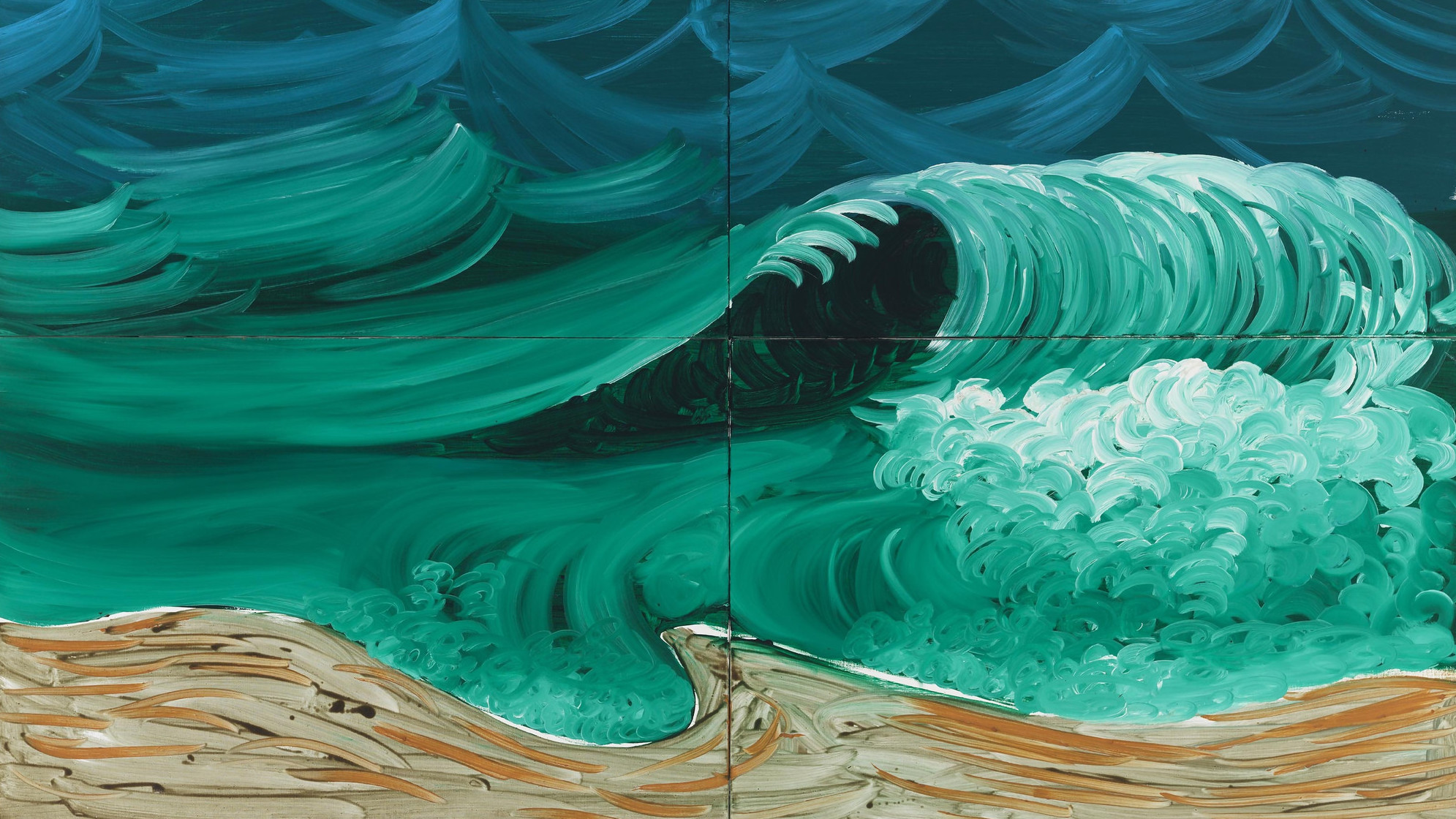On ne croirait pas que ça peut exister, mais ça existe. Je vous explique, c’est assez simple, vous allez tout de suite comprendre. Pas de quoi en faire un plat, penserez-vous même peut-être.
Voilà : je vois la vie beaucoup au-dessus de ce dont je suis capable, depuis toujours.
C’est à cause de ma mère. Comment vous dire ? Depuis tout petit, je ne l’aime plus. Et je me demande aujourd’hui si je l’ai même seulement connue. D’ailleurs, la connaît-on jamais, sa mère ? Elle m’a mis au monde, c’est incontestable, elle me l’a d’ailleurs souvent répété, comme si j’aurais pu l’oublier. Elle l’a même revendiqué, ce qui m’a toujours paru étrange. Et inquiétant. Comme si elle réclamait un droit d’auteur. À telle enseigne que je me suis souvent demandé ce qui lui faisait tant redouter qu’on en doutât, à supposer que ce fut ça, qu’on tentât de la voler, qu’on se méprît à ce sujet – à mon sujet, donc –, qu’on s’attribuât sa production originale. Comment cela eût-il été possible ? Aurait-on pu m’exproprier, m’aliéner ? Je suis né avec ça, ce genre de questions. Avouez que c’était mal parti. Comment aurions-nous pu dans de telles conditions avoir un usage normal l’un de l’autre, je vous le demande. Bref, j’ai fait comme j’ai pu, et comme vous allez pouvoir le constater, ça n’a pas été brillant.
Très tôt, j’ai eu très peur. Il n’y a qu’à voir les photos de moi à deux, trois ans, c’est déjà tout à fait évident. Il y a sur mon visage quelque chose d’indécidable, entre l’effarement, l’incompréhension et la terreur. Je ne savais pas ce qu’elle me voulait. Elle me voulait quelque chose, ça, ça ne faisait aucun doute, mais quoi au juste, je ne le savais pas. Pas encore. Je ne l’ai compris que plus tard. Il y a d’abord eu des années d’ambivalence pendant lesquelles les promesses étaient des menaces, les marques d’amour des pièges, les cadeaux empoisonnés. Les chiens, par exemple. C’est avec eux que tout a commencé. Il y en avait un déjà avant ma naissance, une chienne plutôt. Ma naissance lui a coûté la vie. Pensez donc, s’occuper tout à la fois d’un nouveau-né et d’une chienne, c’était bien sûr beaucoup trop pour une seule femme. Quant à son mari, mon père, c’est très simple : il n’aurait voulu ni d’une chienne, ni d’un enfant. Mais une histoire à la fois, c’est déjà assez compliqué comme ça.
Donc je nais – et la chienne est tuée. Car lui trouver un autre foyer était impensable, l’excuse étant qu’on ne pouvait être sûr que ses nouveaux maîtres l’aimeraient autant que nous. Valait donc mieux la tuer, ça tombe sous le sens. Elle avait un an. Et, bien entendu, cette décision avait été terriblement douloureuse, ma mère avait pleuré toutes les larmes de son corps, mon père s’en voulait affreusement, etc. C’est ce qu’on m’a dit.
Cinq années passent. Nous déménageons dans une maison plus grande, avec jardin. Et voilà qu’un soir mon père rentre du travail avec une petite chienne de la même race, c’était pour moi. Nous sommes à la cuisine. Je prends la chienne dans mes bras, fou de joie, m’assieds par terre avec elle pour jouer. Ma mère : « Comment veux-tu l’appeler ? » Un peu craintif mais sans comprendre pourquoi, je lui réponds aussitôt : Lola. Comme la première tuée. Ils sont un peu gênés, mais va pour Lola. Je suis heureux, je n’ai pas de souvenir d’un plus grand bonheur, nous serons inséparables, je le sais.
Trois mois passent. Un après-midi pluvieux, impossible de jouer au jardin avec Lola, je vais chez Mark, un ami voisin. J’y passe quelques heures, nous jouons, sa mère nous prépare un goûter, tout va bien, mais Lola me manque, je rentre. Lola a disparu. Je demande à ma mère où elle est. Je ne comprends pas sa réponse : elle a demandé à mon père de profiter de mon absence pour venir la chercher et la conduire chez le vétérinaire pour la faire « endormir ». Comment ça, endormir, que je lui demande. Silence. Je suis effondré, terrifié, affolé. Ma mère me regarde avec, dans le regard, l’aveu qu’elle avait dans le cœur autre chose que de la bienveillance, que de la bonté, que de l’amour. Comprenant que je la voyais, que je voyais cela, elle a regardé ailleurs. Et ne m’a plus jamais regardé comme une mère sait regarder son enfant quand elle ne souhaite pas des choses troubles. Et j’ai vu cet après-midi-là, pour la première fois, le double masque de l’amour qu’elle portait à même la peau. Vous y êtes ? Ma vie, ce jour-là, fut gagée sur ce double masque.
Et elle en fit d’autres du même tonneau, quatre fois. Quatre fois avant mes douze ans, à son initiative, elle et son mari m’offrirent un chiot qu’ils firent tuer dans les six mois. Alors j’ai observé ça, j’ai vécu avec ça, cette folie de cette femme et de cet homme qui n’étaient pourtant pas fous, à attendre mon heure, prenant congé d’eux aussi souvent que je le pouvais, avec le sentiment de n’exister vraiment pour personne et remettant la jouissance de cette vie à plus tard.
Mais il y a plus, et pire, et peu avouable.
C’est un matin de milieu de semaine. J’ai six ans et je n’ai plus Lola, je viens de me lever et elle n’est plus là, je vis dans une espèce de solitude que je ne sais pas nommer et que je ne veux pas qu’on voie. Il pleut. Enfin, je crois qu’il pleut, c’est ainsi que je m’en souviens, dans mon souvenir il pleut, comme souvent d’ailleurs, alors mettons, va pour la pluie, il pleut. Mon père vient de quitter la maison pour se rendre au travail, ma mère et moi sommes seuls. Nous sommes dans leur chambre, qu’elle termine de ranger. Je suis assis au sol, à jouer avec des petites voitures de marque Dinky Toys. Je me souviens d’une Jeep militaire et d’un camion de pompiers. La chambre une fois rangée, ma mère passe à la salle de bains, me dit qu’elle n’en a pas pour longtemps. Je continue de jouer en l’attendant mais je ne sais pas ce que j’attends. Et, surtout, je ne sais pas ce qui m’attend, ce qui est sur le point de m’arriver et qui va tout changer pour moi, le monde, ma façon de le voir, de me relier à lui.
Donc j’attends.
Ma mère revient. Elle s’est douchée, elle achève de se sécher à l’aide d’un drap de bain blanc. Sa nudité me surprend et me fascine. Elle se tient debout face à une coiffeuse-perruquière surmontée d’un miroir en psyché. Je suis derrière elle, je ne joue plus, je la regarde. Elle sèche ses cheveux en s’observant dans le miroir. Le meuble est très beau, de style Restauration, en placage d’érable moucheté avec incrustation d’amarante dessinant un feuillage stylisé. Le miroir est ovale, à col de cygne, posé sur un plateau de marbre blanc sous lequel se trouve un large tiroir en ceinture. Les deux pieds en console reposent sur un socle échancré posé sur des roulettes. Je n’ai rien oublié, du moins il me semble, ni les meubles, ni les Dinky Toys, ni la lumière, ni l’odeur, ni elle, ni moi, rien.
Sans me regarder, elle me demande si je m’amuse bien, are you having fun, sweetheart? mais n’attend pas ma réponse. Elle se penche vers le miroir en décollant un talon du sol. Je vois son sexe, légèrement ouvert, les lèvres hypertrophiées qui dépassent des poils coupés courts. Je ne comprends pas ce que je vois et que je ne peux pas quitter des yeux. Je lui demande ce que c’est. Elle me regarde par-dessus son épaule.
– « Quoi? »
Je lui montre du doigt.
– « Ça. Là. »
Elle se retourne et me fait face, plie légèrement les genoux en les ouvrant, de ses doigts écarte les poils, expose tout à fait les lèvres et dit :
– « Ça ? Rien. Ça n’est rien, mon chéri. »
*
J’ai commencé ce jour-là à perdre l’usage du monde, vous comprenez ? À perdre l’usage du lien, si vous préférez, ce fil de rien qui devrait tenir deux vies ensemble mais qui toujours se défait comme une couture trop vieille. Ça ne se perd pas d’un coup, dans le fracas dont on aurait pu faire récit, mais grain par grain, poussière après poussière, comme si les mots, jadis pleins d’un sang clair, s’étaient vidés sous nos yeux. Alors le lien se fait ombre, ou plutôt brouillard : il enveloppe, mais ne tient pas. Et pourtant, on persiste à marcher dans ce brouillard, cherchant dans les gestes les plus frêles – un regard posé trop vite, un sourire mal assuré – la preuve que tout n’est pas perdu. On s’accroche à ces riens comme à des cailloux de rivière polis par des siècles, car ils portent encore la mémoire des grandes eaux, des jours où l’on croyait que rien ne pouvait faiblir. Mais les cailloux mentent, eux aussi : ils se taisent sur l’érosion, sur la patience du temps qui use tout, même les serments, même les élans. Et vient ce moment où l’on comprend, sans que personne ne dise quoi que ce soit, que le lien ne tiendra plus. Ce n’est pas la rupture, ce mot trop net : c’est la disparition, douce et terrible, du commun. On regarde l’autre comme on regarderait une maison d’enfance dont il ne reste que deux murs debout, traversés de vent ; on sait qu’on n’y vivra plus, mais on tarde à s’en détourner, espérant qu’une main invisible remettra les pierres en place. Alors on se tient là, entre ce qui fut et ce qui ne peut plus être, et on découvre que la difficulté du lien, sa plus âpre vérité, tient à cela : il demande plus d’humilité que de force, plus de ferveur que de promesse ; il exige qu’on sache perdre autant qu’on sait donner. Et ceux qui l’ignorent, ceux qui s’en croient quittes, finissent par apprendre que rien ne se noue sans cette part de fragilité qui nous dépasse, et qui, parfois, nous sauve. J’attends toujours d’être sauvé.