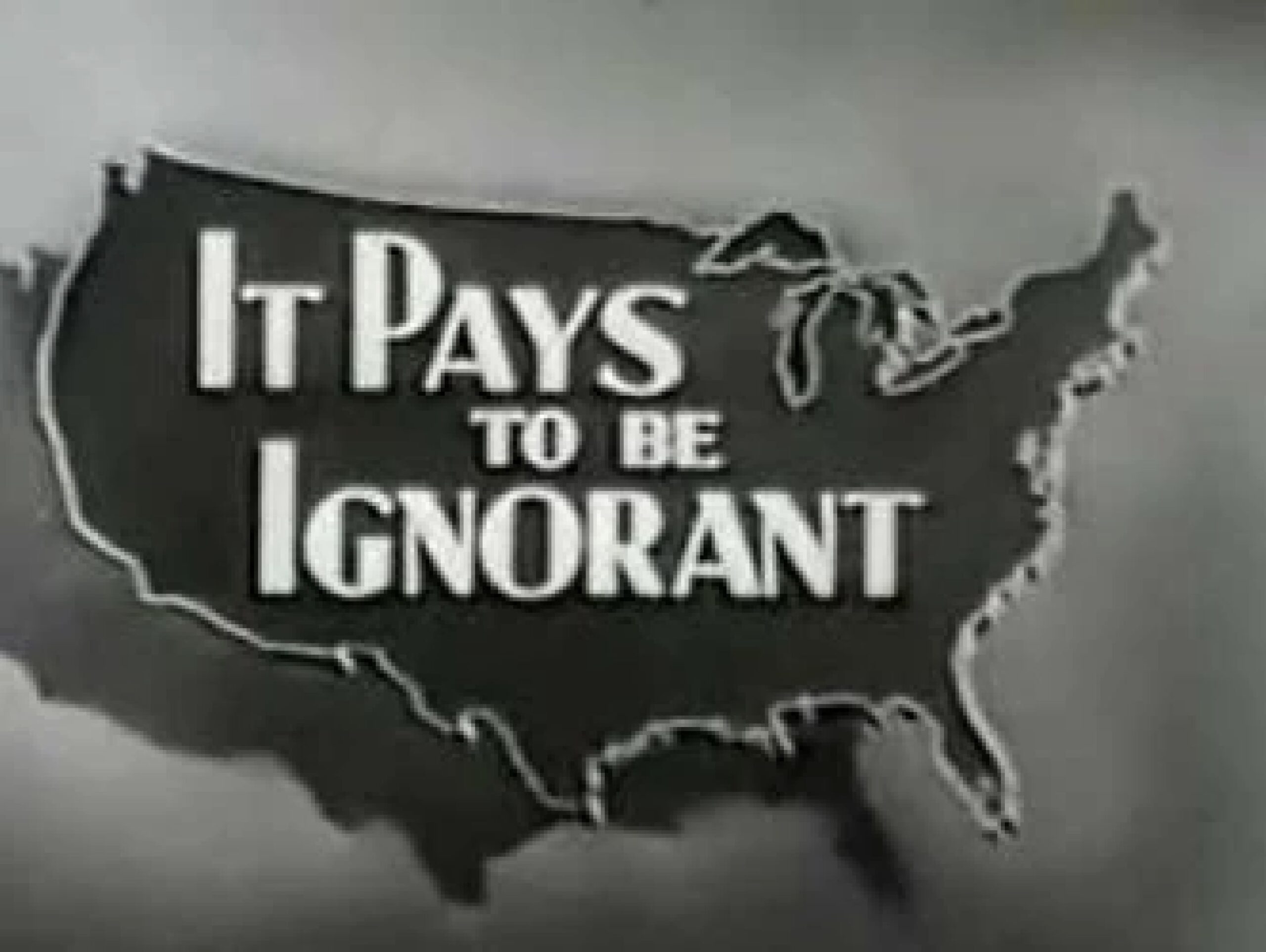Gregor Minsky était énervant. Il exagérait tout le temps. Par exemple, il affirmait avoir cessé de vivre à dix-sept ans. Vous pensez bien que « cessé de vivre », c’était beaucoup dire. Mais bon, puisque c’est comme ça qu’il disait, eh bien, j’avais pensé : acceptons de le suivre, essayons de comprendre ce qu’il entend par là. Parce que de toute façon, il n’aurait servi à rien de le contredire. Il ne faut jamais contredire les gens qui ont des certitudes et qui veulent vous les imposer, qui revendiquent une sorte d’autorité eu égard à la vérité, je veux dire à ce qu’ils tiennent pour être la vérité. Surtout lorsqu’il s’agit d’eux-mêmes. Mais, soit dit entre nous, c’est le genre de plainte, excessive, hyperbolique et, j’ose le dire, tout à fait hystérique, que j’ai le plus grand mal à écouter. Bref, dix-sept ans, c’était pour lui la fin de la jeunesse, de la jeunesse « étourdie », comme il disait, sans lumières dignes de ce nom ni vues ni débouché ; c’est l’âge où brutalement il serait devenu un autre, I became someone else.
– Un autre ? Comment ça ? On peut devenir un autre, one can become someone else? Expliquez-moi ça.
Il me dit avoir eu le sentiment, un matin, de se lever à la lèvre du gouffre. Et que chaque jour serait désormais une coupe de poison, que ça ne pouvait plus continuer. Mais ça continuerait pourtant, il le savait, c’était comme si c’était écrit, comme si les dés avaient été jetés. Et puis il évoqua encore son père, « ce sale con », à qui il n’était jamais venu à l’esprit qu’on puisse ne pas trouver à son goût ses exigences tyranniques, insensées, sa discutable personne, qui souvent le brocardait, ex abrupto, sans raison.
– Parlez-moi de lui. Il était comment, exactement, votre père ?
– He was a fucking bastard, voilà ce qu’il était.
Il me parla d’un homme lâche, faible, qui n’avait jamais été capable d’assurer seul son existence, qui sa vie durant avait dépendu en totalité de sa femme, exerçant évidemment par là une tyrannie absolue, continuée, les enfermant dans une vie insupportable, épuisante, sans espoir. Et puis il était laid. Le front étroit, en pain de sucre, le bas du visage large et lourd, couperosé, le cou enflé. Une épaisse face d’imbécile, rongée d’inquiétude, de pensées mauvaises, de remords, bref de toutes ces choses qui toujours finissent par vous rendre laid.
– Vous ne l’avez donc jamais aimé ?
– Je ne crois pas. J’ai oublié les années d’enfance. Mes seuls souvenirs sont de dépit, de douleur, de rage et de honte. Je ne sais pas de quoi la vie l’avait privé and I don’t give a damn. Je ne sais de toute façon rien de son histoire, il n’en a jamais rien dit. Je suppose que j’ai dû vouloir l’aimer, tout petit, que j’ai voulu l’admirer, comme tous les enfants, l’admirer pour quelque chose, n’importe quoi, mais je n’ai jamais pu. Nous avons passé un peu plus de trente ans ensemble et jamais, de tout ce temps, nous ne nous serons vraiment parlé. Toujours quelque chose nous a séparés, qui ne fut jamais dit. Des sentiments contrariés, meurtris, ravalés. Vous comprenez ? Il m’a provoqué dans une lutte à mort, il n’a cessé d’attiser des sentiments hostiles, du ressentiment, de la haine. Vous voulez que je vous dise ? Je pense qu’il n’a jamais voulu que je vive. Et je suis convaincu aussi qu’il a voulu me faire payer ses échecs.
– Quels échecs ?
– Des échecs de tous ordres : professionnel, personnel, intime, sexuel même.
– Sexuel ? Comment savez-vous ça ?
– Je me souviens d’un repas, à la maison, un dimanche d’été. Je devais avoir quinze ou seize ans. Il y avait deux de mes tantes, les sœurs de ma mère, avec leurs maris, et la fille de l’une d’elles, Nancy, du même âge que moi. Je ne sais plus ce qui l’avait amenée à faire ça, mais toujours est-il que ma mère s’était à un moment donné mise à l’humilier en se plaignant de ses troubles d’éjaculation précoce. Vous vous rendez compte ? Vous imaginez la scène ? La tête que nous faisions, tous ? On ne savait plus où se mettre. J’ai dit à ma mère d’arrêter, je l’ai même engueulée, mais non, rien à faire, elle a continué, nous prenant à témoin, nous demandant si nous pouvions imaginer ce que ça pouvait être que de devoir s’arrêter avant même que ça n’ait commencé, it was over before it had even started. Alors j’ai quitté la table, je me suis enfui, je ne voulais pas écouter ça. Goddamn bitch!
Et puis Gregor s’était tu, couvrant son visage de ses mains, se frottant le front en appuyant de toutes ses forces, puis s’agrippa les cheveux comme pour se les arracher. J’ai cru qu’il allait se mettre à hurler, mais non, rien, pas un son. Il était resté là, assis, les coudes sur les genoux, se tenant toujours la tête, regardant le sol, figé. Je l’avais encouragé à poursuivre son récit, en vain. Il avait fini par relever la tête, m’avait regardé, l’air épuisé. Il pleurait, doucement.
– Laissez-moi tranquille. Je ne veux plus parler.
Et il s’en était allé. On ne croirait pas que ça peut exister mais ça existe. C’est assez simple : on voit la vie beaucoup au-dessus de ce dont on est capable, depuis toujours. Et pourtant, chaque pas, chaque souffle finit par nous y conduire, sans qu’on s’en rende compte. On s’imagine fait pour moins, et on découvre, tard, qu’on a toujours porté davantage. C’est un apprentissage silencieux, une sorte d’accord secret entre le courage et la fatigue. Il y a des jours où tout semble trop vaste, trop lointain, et d’autres où l’on touche presque au but. Alors on continue, un peu par foi, un peu par habitude. Ça n’est pas de l’héroïsme, seulement une fidélité à ce que l’on pressent. Le monde regarde ailleurs, mais au fond de soi quelque chose avance. On se surprend à sourire sans raison, comme si l’avenir nous frôlait. Peut-être que la vraie grandeur, c’est de ne pas renoncer quand plus rien ne répond. Les rêves, eux, ne disparaissent pas ; ils se taisent, patientent, se refont une place dans le silence. Et un matin, sans prévenir, ils se lèvent avec nous. On se dit : « C’était donc ça, depuis toujours. » La peur, elle, n’a pas changé. Les limites reculent quand on cesse de les nommer. Alors on recommence, encore, comme si c’était la première fois. Parce que ce qui existe vraiment ne s’explique pas : ça se traverse. Et à la fin, on comprend que le plus haut n’était jamais ailleurs que dans le pas suivant. Tout était déjà là, simplement caché dans le courage d’essayer encore. Il n’a pas pu ; je n’ai pas su l’y aider.