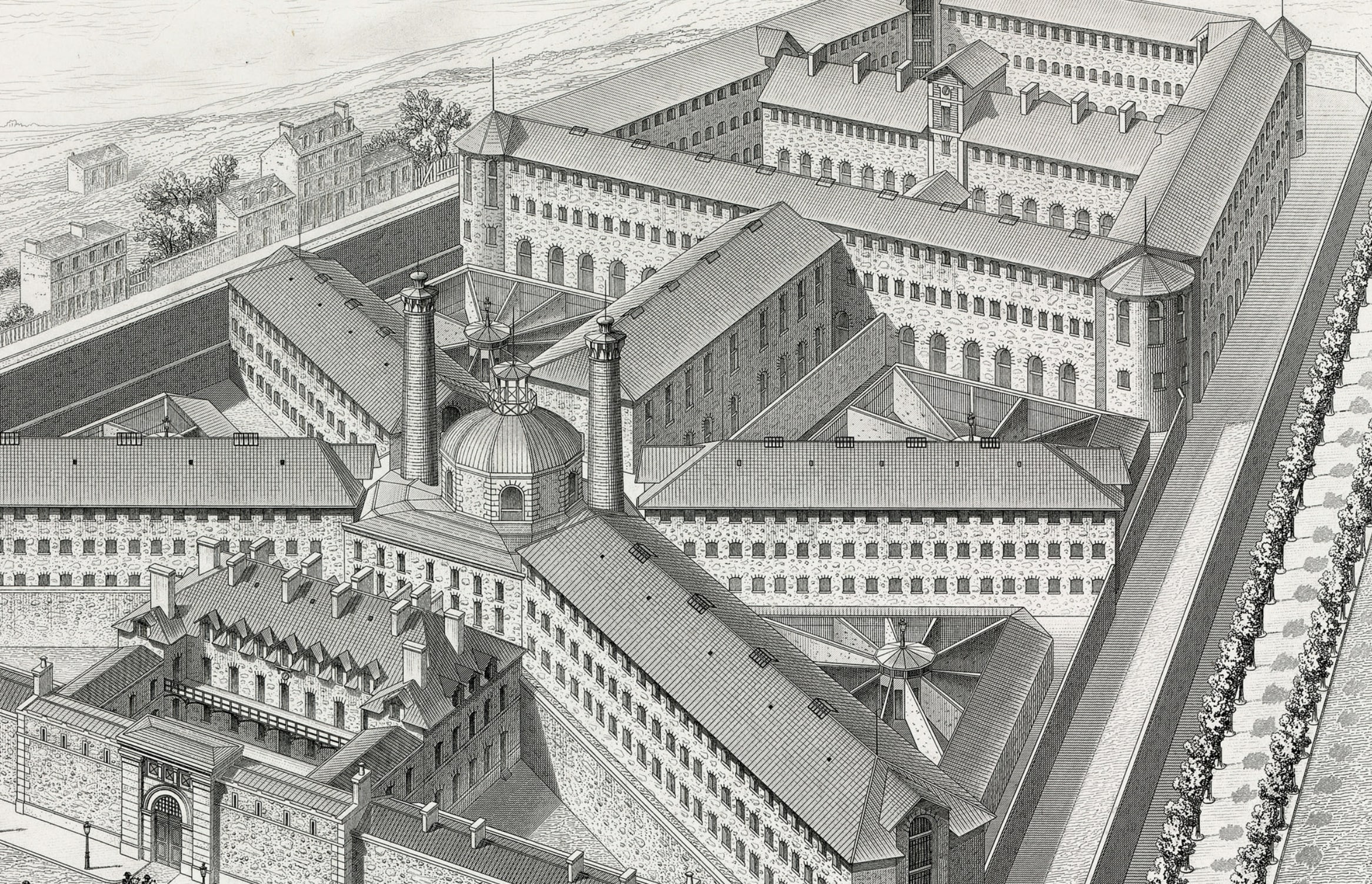Depuis son incarcération à la prison de la Santé, le 22 octobre, Nicolas Sarkozy est devenu le premier ancien président de la Ve République placé sous écrou.
Un événement inédit qui, au-delà du fait divers politique, bouleverse les repères d’une République jugeant ses anciens chefs.
Face à cette incarnation hors norme, de la longue histoire de la confrontation des destins à la justice, j’ai imaginé ce qu’en aurait pensé le philosophe de l’absurde et de la justice : Albert Camus.
***
Des cris qui sont devenus le même son.
Les questions qui reviennent, en attendant les néons blafards du réveil automatique de 6h30.
Alors, les mêmes gestes : toilette à l’eau froide dans un petit lavabo, remettre ce pantalon, cette chemise, l’écharpe d’un mètre, pas plus.
Tous les matins sont les mêmes longs matins, sans influence possible sur l’environnement.
Les lumières s’allument et s’éteignent sans consentement.
Voilà, depuis ce mercredi 22 octobre, le quotidien de l’ex-premier magistrat de France.
Président condamné, magistrat sous verrou : bref, une vie en oxymores.
C’est à peu près au moment où les autres détenus vont en promenade que mon père m’appelle. Et, comme souvent lorsqu’il y a une question liée à l’homme, à la justice ou au sens de toutes choses – ce qui fait beaucoup – il me dit :
« Qu’en aurait pensé Camus ? »
J’utilise souvent l’auteur de La Chute pour résoudre les grands dilemmes, mais jamais sa voix, qui manque tant, ne m’a semblé plus pertinente pour se positionner sur ce cas, bien moins éloigné de l’absurde que de la justice.
Prison, coupable, jugement… En pensant à lui, c’est tout naturellement que je convoque L’Étranger.
Meursault et Sarko : qui aurait pu imaginer deux êtres plus différents ?
Fiction et non-fiction.
Être sans chair, sang qui bouillonne.
Homme sans temps, joggeur rivé au chrono.
Celui dont chaque acte n’a ni cause ni conséquence, et celui dont le moindre pas est un but.
D’un côté, un homme séparé du sens, agissant dans l’instant ; de l’autre, un stratège avec une ambition plus grande que la vie.
La mémoire sans oubli et l’écriture d’un roman national.
J’ouvre L’Étranger à la première page :
« Aujourd’hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. »
Meursault a l’honnêteté de l’amnésique.
Nicolas Sarkozy, lui, connaît par cœur toutes les dates importantes de sa vie et les noms de ceux qui l’ont touché : la mémoire des grands fauves politiques.
Bien que si différents, tous deux, dans la fragmentation du réel que crée sur une vie la main de la justice, nous aident à penser le rapport au projet de société – et donc, ce qui est peut-être la même chose – à l’absurde.
Le procès de Meursault fonctionne en fait comme une mise en scène du mensonge collectif.
L’avocat chante la bonté, le procureur tonne la morale chrétienne, le jury, quant à lui, dans cette religion absolutiste, attend la repentance.
Mais l’accusé refuse de « tricher » : il ne demande pas pardon, ne feint pas l’émotion, ne prétend rien – et là est son plus grand crime.
Sa sincérité, qui est la forme la plus pure de sa liberté, le condamne.
Force de la littérature : cette sincérité, cette volonté de l’instant, resteront comme des alternatives possibles d’une vie digne et sereine.
La justice de L’Étranger est une justice pour la norme et non pour l’homme.
Le monde de la loi, créé pour resserrer l’écart entre le trou noir de l’absurde et une justice métaphysique qui n’existe pas ici-bas, est finalement devenu lui-même une déclinaison de l’absurdie, ajoutant du malheur au monde qu’il prétendait réparer.
Dans l’affaire Sarkozy, nous sommes peut-être dans une nouvelle étape de la postmodernité : ce n’est même plus le simulacre de justice pour faire triompher la norme, mais la justice pour changer le réel.
C’est Camus qui rencontre Philip K. Dick, l’agent de police, d’ailleurs anonyme, qui aurait sous la main precrime, le système de Minority Report.
Au moins Meursault, lui, avait une chance : il suffisait qu’il suive la chorale du mensonge.
Sarkozy, étant un obstacle à la réalité décidée, ne pouvait être lavé.
Là, il n’y a plus de danse, mais une mécanique froide : un Léviathan triste et gris.
Dans le roman, le policier, le juge d’instruction, l’avocat, le procureur, tous anonymes, se confondent pour former la même société abstraite éloignée du besoin véritable des hommes.
Après un long travail de juges tristes, l’État de droit s’est imposé dans la conscience collective comme l’opposition à l’arbitraire ; autrement dit, le contester reviendrait à célébrer le règne des plus forts. Nous avons la paresse d’oublier qu’en garantissant les droits fondamentaux, il constitue le cadre qui assure la légitimité, la stabilité et la justice du projet politique – il n’est pas le projet politique.
Certainement, les mots d’Albert Camus auraient ces jours-ci percé le givre gris de la violence et de l’hypocrisie. Ses paroles, comme souvent, auraient cherché la nuance ou la beauté.
Pour cela, il aurait commencé à abattre à la hache les totems, et les premiers d’entre eux, celui de l’état de droit, et son catéchisme corolaire qui consiste à répéter que l’on ne peut critiquer une décision de justice.
C’est le tâtonnement aveugle face à l’absurde qui procure tant de souffrance à l’homme, cet animal tragique doublement condamné par sa conscience du champ des possibles.
Il hurle dans un infini sans écho, et Meursault a répondu, dans le plus grand noir, par l’acceptation lucide ; Sarkozy, jusqu’à présent, par l’action et la révolte.
Chacun sa boussole – bien que j’aie appris qu’elle soit étrangement interdite par l’administration pénitentiaire – pour avancer au sud de l’absurde.
Dans la répétition de ses tâches, cette vie si éloignée de la sienne, Nicolas Sarkozy – entre Jésus-Christ et Monte-Cristo[1] – pensera sûrement à un autre livre de Camus, Le mythe de Sisyphe, écrit la même année que L’Étranger et agissant comme un diptyque.
Quel sens trouver dans l’habitude, la répétition sans fin et sans finalité ?
Sisyphe doit apprendre à aimer son destin, nous dit Camus : avancer en poussant sa pierre sur une ligne de crête entre acceptation du sort et révolte.
En tout cas, l’image et les mots d’une filiation soudée et aimante, qui ont pénétré nos écrans et nos radios, sont sans doute la plus grande force – et la plus belle marque – d’une vie réussie.
[1] Dans un entretien accordé au Figaro publié le 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy confiait à Charles Jaigu au sujet de son emprisonnement : « J’emporte Le Comte de Monte-Cristo en deux volumes et la biographie de Jésus par Jean-Christian Petitfils ».