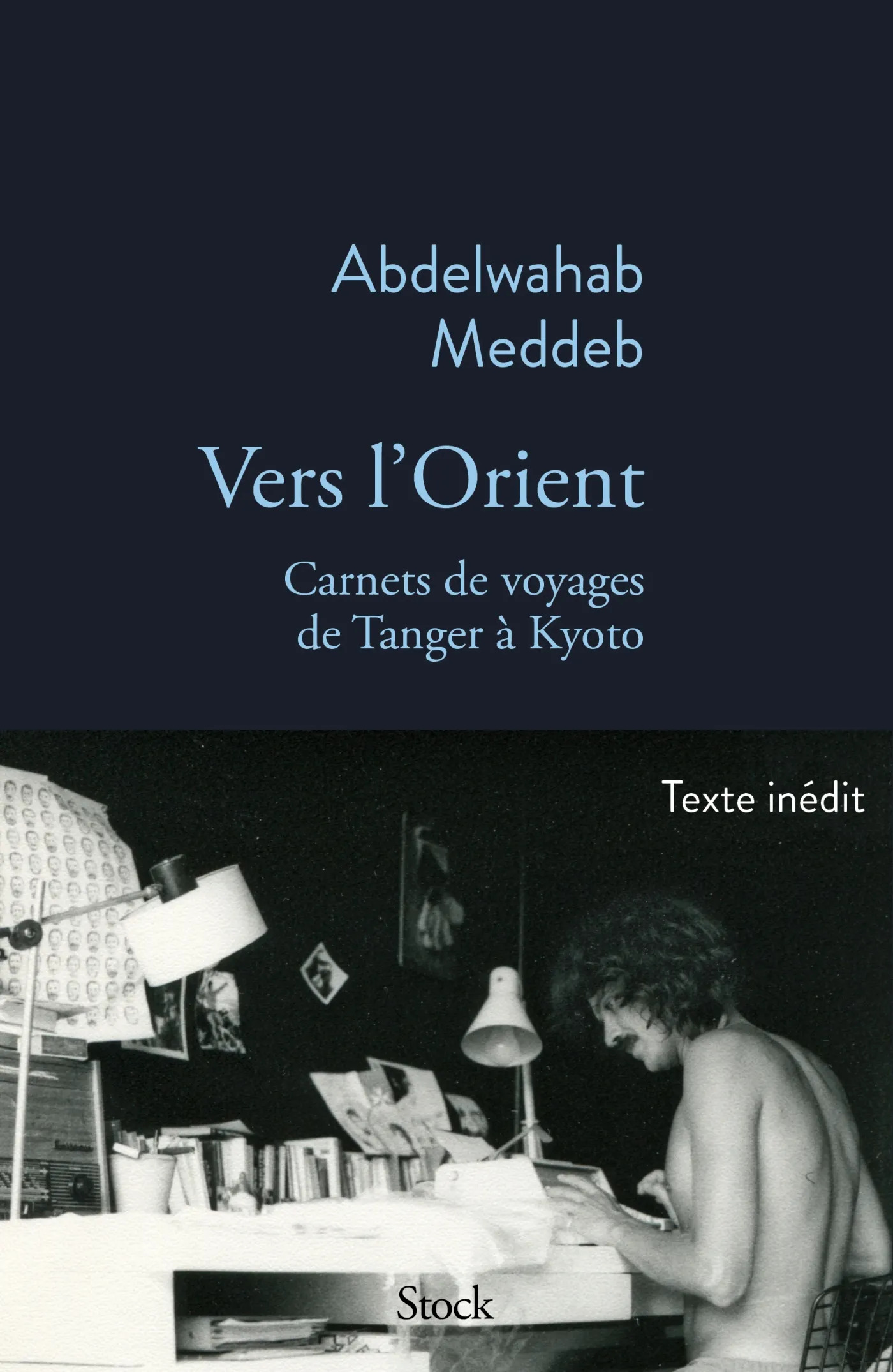« Me voici donc seul sur la terre, n’ayant plus de frère, de prochain, d’ami, de société que moi-même. » Ainsi débutent Les rêveries du promeneur solitaire, de Jean-Jacques Rousseau, misanthrope obsessionnel qui se veut partout rejeté, partout victimisé, et qui, presque deux siècles avant Kafka, tient qu’écrire ses rêveries pour lui-même, c’est sauter hors du cercle des meurtriers.
Promeneur, Abdelwahab Meddeb, philosophe franco-arabe mort en 2014, en aura été un à son tour, et dans un bien plus vaste univers. Ses proches ont publié cette année ses carnets de voyage, sous le titre Vers l’Orient, pour le bonheur des citoyens du monde et des amis du genre humain, qui se reconnaîtront en celui qui fut un parfait antirousseauiste.
De Tanger et de Fès à Kyoto, via Séville, Grenade, Venise, Sarajevo, Jérusalem et Le Caire, Abdelwahab Meddeb a parcouru en poète le monde et ses splendeurs humaines, passé et présent enlacés. Curieux de ses contemporains sous toutes les latitudes, urbanophile et historien des civilisations arabo-musulmanes, arpenteur cosmopolite des langues et des cultures, admirateur de la mystique soufie et ses sublimes énigmes entre visible et invisible divins, il désespérait de voir la lèpre du modernisme sans âme gagner inexorablement partout. Meddeb, le « mendieur d’azur perdu dans nos chemins » (Mallarmé), était un conservatoire d’humanité vivante aux mille altérités, aux mille atomes d’universel.
Je me bornerai à suivre les pas du virtuose de la langue française déambulant dans les ruelles de Fès, carnet de notes en main.
Fès. Ce sont ici, tapis à l’ombre du mausolée d’un marabout, trois hommes à la noblesse hermétique, visages figés, dont la présence muette s’enracine dans le site multiséculaire, qui interpellent l’étranger dans une langue autre que celle des mots. C’est là, dans le labyrinthe de la ville, entre ruines et tas d’ordures, entre mosquées aux superbes mosaïques et palais hispano-mauresques cachés dans la médina comme on cache « la jouissance lumineuse de l’intime », que bat le poumon de la ville sainte. Fès, l’ex-cité andalouse aux trois monothéismes, où « l’ouvrage est arc-bouté à l’espace sacré, la prière au savoir, Cité qui donne la certitude d’être à jamais fidèle à sa croyance ».
Envoûté par le spectacle de Fès, oscillant entre l’extase matérielle et le malaise irréductible d’être celui qui vient d’ailleurs, subjugué par la mosaïque des couleurs des teinturiers, passant des senteurs pestilentielles des tanneurs de peau et des montagnes de tripes sous un soleil radieux aux vendeurs de musc, aux parfums des alambics de fleurs mêlés aux exhalaisons des fumeurs de kif à ciel ouvert, assourdi par le concert des marteaux des dinandiers et la frappe des ciseleurs de cuivre, Meddeb, comme Dante au sortir de l’enfer, irradie de joie à écouter un vieux soufi en lunettes noires psalmodier quelques versets du Livre Saint puis chanter des poèmes anciens « ne parlant que de passion, de vin et d’ivresse ». Le mariage, partout, du profane et du sacré lui fait parler « d’immunité sainte ».
Pétrie d’enchantement. Telle est Fès la mystique pour ce pèlerin métaphysique empli de liesse de l’âme et de contentement du corps. Nourri des meilleurs savoirs occidentaux tout en demeurant fidèle au souffle divin de l’islam, Abdelwahab Meddeb, ce moderne Ulysse, nous fait voyager en poètes à ses côtés dans les désordres du monde et à la recherche de beautés anciennes au bord de disparaître – des beautés qu’il nous revient à tous de préserver et de chérir.