La tragédie des horizons
Les défis que nos sociétés développées vont devoir affronter sont gigantesques : défis écologiques, défis militaires, défis technologiques, défis éducatifs… tout indique que des investissements majeurs sont à envisager pour préparer le long terme. Or nos institutions et nos reflexes sont uniquement mobilisés sur le court terme. Ce qu’un grand banquier central – aujourd’hui Premier Ministre du Canada – avait appelé « la tragédie des horizons ». Regardons les choses en face : la loi du marché pousse les responsables politiques – et économiques – à traiter l’urgent plutôt que l’important. Nos sociétés ont de plus en plus de peine à projeter sur l’avenir un plan de la Cité idéale. Des sommes d’argent considérables sont le plus souvent dépensées sans réflexion réelle sur les besoins à long terme. Là encore les marchés portent une responsabilité majeure dans notre difficulté à dépasser l’instant. Sur l’horloge les opérateurs ont le regard fixé sur l’aiguille des secondes alors que la plus importante est celle qui indique l’heure. La dictature de la transparence trimestrielle, et même les règles comptables privilégient l’instantané. Comme le disait l’humoriste, « l’avenir c’est encore ce qu’on a inventé de mieux pour gâcher le présent ».
Avec le prétexte de lutter contre la bureaucratie, les forces ultralibérales tendent à désarmer le seul garant de l’intérêt général : l’État. Résultat : la planification a été rangée au magasin des accessoires et les investissements à long terme (notamment en matière d’aménagement du territoire) oubliés, au bénéfice du très court terme. Terrible constat au moment où les nouvelles technologies du numérique exigeraient une réflexion stratégique et un effort de formation massif sur plusieurs générations. Une croissance équilibrée ne pourra advenir qu’après une réflexion approfondie sur un horizon long. Cette réflexion est absente des propositions politiques du moment. A droite cela peut se comprendre. A gauche c’est impardonnable.
De quoi Trump est-il le nom ?
Personne n’a la boule de cristal permettant d’entrevoir notre avenir. On peut néanmoins regarder outre atlantique, pour avoir une idée. L’évolution de la société américaine a souvent servi de modèle. Seulement voilà : c’est aujourd’hui un contre-modèle. En 2025, les États-Unis ressemblent à une féodalité néolibérale : d’un côté, les milliardaires, les fonds spéculatifs, les stars du numérique, Wall Street ; de l’autre, une population précarisée et la peur du déclassement. L’Amérique ne redistribue plus : elle siphonne. Le salaire minimum fédéral n’a pas bougé depuis seize ans, tandis que le coût des études, des soins ou du logement a explosé. Le « rêve américain » a été vendu en actions.
La démocratie américaine ne tient plus que par habitude – ou par inertie. Deux camps se font face et n’ont plus rien à se dire. La moitié des électeurs républicains croient que l’élection de 2020 a été volée. L’autre moitié pense que les démocrates sont des corrompus qui méprisent le peuple. La Cour suprême, devenue l’arme du conservatisme, impose sa vision d’un autre siècle. Les élections sont polluées par l’argent. Le Congrès est paralysé, la justice bafouée, le débat public empoisonné par les réseaux sociaux, et les électeurs désabusés. L’Amérique est devenue un champ de bataille institutionnel.
Être noir ou latino en Amérique, c’est toujours vivre avec une espérance de vie plus courte, une police plus violente, un logement plus précaire, une école moins bonne. À peine cinq ans après le meurtre de Georges Floyd des voix s’élèvent pour gracier ses assassins ! Les États-Unis sont en guerre contre eux-mêmes. Sur les campus, dans les entreprises, dans les manuels scolaires, le pays s’étripe autour de ce qu’il est, de ce qu’il a été, de ce qu’il doit devenir. Les conservateurs accusent les progressistes de détruire l’Amérique avec leurs obsessions identitaires. Les progressistes dénoncent la haine réactionnaire, le racisme latent, et l’hypocrisie évangéliste. Ce n’est plus un débat : c’est une guerre de religions.
Les « boomers » ont raflé la mise, et les jeunes paient la note. Les vieux ont hérité du plein emploi, du logement accessible, de retraites généreuses. Ils laissent derrière eux une jeunesse surendettée (1700 milliards de dettes étudiantes !), dont l’avenir dépend de la fortune familiale (il faut 400 000 dollars pour des études supérieures décentes). Quant à la dette abyssale du pays, les nouvelles générations paieront la note pendant des décennies.
Entre la Californie et le Texas, entre New York et l’Alabama, ce ne sont pas seulement des kilomètres qui séparent les citoyens : ce sont des valeurs fondamentales. Le droit à l’avortement, l’accès aux soins, l’enseignement, les armes, la peine de mort – chaque État fait bande à part. Ce pays qui se rêvait « united » n’est plus qu’une addition de tribus juridiques. Le risque n’est pas seulement d’un éclatement politique : c’est d’un éclatement culturel, mental. Demain anthropologique avec l’IA réservée aux privilégiés du système. La guerre de Sécession n’est pas finie. Elle a juste changé de forme.
Avec plus de 400 millions d’armes en circulation, les États-Unis ne connaissent plus la paix civile : ce sont les Balkans sous stéroïdes. Chaque trouble psychique devient un bain de sang. Et pendant que les enfants meurent à l’école, les sénateurs encaissent leurs chèques de la NRA. La peur est devenue un mode de vie, et la violence, une langue commune, aggravée par le fentanyl.
J’écris ces lignes avec tristesse. Comment oublier le sang versé sur les plages normandes, l’immensité de Wyoming, les envoutements du Blues et la beauté d’Ava Gardner ? Tristesse, en effet, devant l’enlaidissement et la vulgarité d’un continent qui portait naguère tant d’espoirs. Bien sûr, les États-Unis restent la première puissance du monde. Mais cette puissance est fissurée. Ce n’est pas la Chine qui menace l’Amérique : le pays est rongé de l’intérieur, ayant sacrifié le commun au profit de l’individu-roi, le compromis au profit du clash, et la vérité au profit du faire valoir médiatique.
Il faut relire les discours d’Harvard de Soljenitsyne. Il posait la seule question qui vaille : une nation peut-elle survivre si elle ne partage plus rien, ni récit commun, ni idéal d’avenir ? Cette question nous ne tarderons pas à nous la poser, de ce côté-ci de l’Atlantique…
Les hommes sans droits
Imaginer que le spectacle de la cacophonie internationale ne pèse pas sur la psychologie collective est une vue de l’esprit. Observer le monde aujourd’hui c’est avoir honte : la Chine et ses camps de rééducation, la Russie et ses assassins, la Turquie et ses purges massives, le Moyen Orient et ses guerres sans fin, l’Afrique et ses guerres génocidaires, l’Amérique et ses couloirs de la mort, l’Europe et son rejet des immigrants… Sans parler des pays arabes qui ne récusent pas franchement la Charia, loin de là. Ce contexte barbare ne peut qu’amplifier l’anxiété collective.
Où que l’on tourne le regard les droits humains sont bafoués. Partout de nouvelles nuits et d’épais brouillards. Il en a toujours été ainsi, peut-être. Mais aujourd’hui personne ne peut barricader son égoïsme derrière son ignorance. Hier, face à l’atrocité des camps nazis, certains ont pu plaider l’ignorance. Aujourd’hui tout le monde sait tout, tout le temps.
Quand le droit international s’effondre la peur monte. Bien sûr il faut se méfier de tout angélisme : le retour de la force s’avère parfois inéluctable comme le montrent les derniers événements au Proche Orient. Les Etats-Unis et Israël ont attaqué l’Iran sans aucune « base juridique » pour le faire. Mais l’Iran, depuis un demi-siècle, menace de rayer l’État hébreux de la carte du monde et finance le terrorisme en Occident : fallait-il lui laisser disposer de l’arme nucléaire ? Qui a raison et qui a tort ? Camus disait : « la vérité a toujours un pied dans le camp d’en face ».
Après la Seconde Guerre mondiale, la création des Nations Unies, les Conventions de Genève, la Déclaration universelle des droits de l’homme, il était légitime d’espérer l’avènement d’un ordre mondial régi par des règles communes. Aujourd’hui ces normes sont piétinées avec une désinvolture croissante. La scène internationale ressemble à ce que décrivait déjà Shakespeare : une histoire de fous racontée par des idiots.
Les États-Unis, depuis Trump, ne cachent plus leur désengagement du multilatéralisme : retrait de l’accord de Paris, suspension de leur contribution à l’OMS, mépris affiché pour la Cour internationale de justice. La Chine, tout en se réclamant du droit international, pratique un expansionnisme maritime unilatéral en mer de Chine méridionale, contraire aux décisions de la Cour permanente d’arbitrage (affaire Philippines c. Chine, 2016). Quant à Israël, son conflit armé à Gaza soulève à nouveau, de façon urgente la question du respect des droits humains. La guerre aujourd’hui se fait… sans déclaration de guerre ! Et en matière commerciale même débandade : l’Organisation du commerce, roulée dans la farine par la Chine, n’était déjà plus que l’ombre d’elle-même quand le Président Trump lui a donné le coup de grâce.
Les principes du jus in bello – distinction entre civils et combattants, interdiction des armes aveugles, respect des prisonniers – sont outrageusement bafoués. L’invasion de l’Ukraine, commencée en 2014 et intensifiée en 2022, constitue une violation manifeste de l’article 2§4 de la Charte des Nations Unies, qui interdit « le recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État ».
Le droit des réfugiés et des migrants illustre en même temps l’érosion silencieuse d’un pilier humaniste. Là encore, les principes fondateurs du droit international – notamment la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés – sont régulièrement oubliés. Partout on assiste aux pratiques de « pushbacks » illégaux aux frontières (Grèce, Pologne, Croatie), on criminalise les ONG qui sauvent des migrants en mer (Italie), et on signe des accords douteux avec des pays tiers pour externaliser la gestion de ses frontières (Libye, Tunisie, Rwanda et même Australie !).
Ces drames ne sont pas nouveaux. Mais aujourd’hui on les vit, en direct, au quotidien, devant tous les écrans du monde…






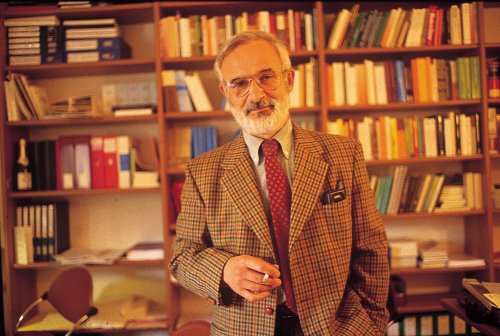

La bataille du long terme versus court terme.
Les farouches adeptes du court-termisme, de la dictature du résultat trimestriel, des règles financières privilégiant les gains à l’instantané, n’ont aucun doute : l’avenir c’est encore ce qu’on a inventé de mieux pour gâcher le présent.
Les marchés mondialisés portent une responsabilité majeure dans le modèle économique centré sur l’immédiateté, une des principales causes de la fragilisation de la planète. Les opérateurs ont le regard braqué sur les variations des cours et des stocks à la seconde près, sans se rendre compte des variations du temps d’épuisement, dramatiques, des ressources naturelles disponibles.
Dans les années 70, le jour du dépassement était le 24 décembre, en 2016, il s’est réduit au 8 août. Ce sont les dates limites d’épuisement de l’ensemble des ressources que la planète peut produire en un an. L’humanité consomme donc une planète et demie par an.
À ce rythme, il faudra trois planètes en 2050. Les conséquences sont connues : réchauffement climatique, destruction de la biodiversité, pollution des sols, de l’air et des nappes phréatiques, la sécheresse… Mais au bout il y a un choc encore plus grand : la guerre de tous contre tous, alimentée par le populisme, le conspirationnisme, le racisme et le terrorisme, dans laquelle la société libérale risque de plonger par pénurie des ressources vitales.
Le modèle de développement responsable de cette situation a été baptisé économie linéaire. Il se résume en ces mots : extraire, produire, consommer, jeter. Les adversaires du libéralisme s’inspirent du planisme et des doctrines marxistes pour modifier la société en profondeur et rejeter ainsi les effets pervers du laissez-faire du marché. Une remise à nouveau qui efface la responsabilité morale, l’universalisme, le libre arbitre, au profit d’une socialisation d’État, qui, dans sa connotation marxiste, supprime la propriété, la liberté individuelle et la remplace par la dictature du prolétariat et du parti. Cette idéologie perverse a montré et montre encore de nos jours avec la Chine les limites du productivisme et de la planification d’État, contributeurs majeurs de la destruction de la planète et de ses ressources.
Entre ces deux pôles, un libertaire et résistant à toute forme d’autorité centrale (USA), et l’autre gouverné par la dictature du parti, qui s’agrège de la composante capitaliste pour s’enrichir (Chine), il se joue la bataille du long terme versus court terme, le combat pour la survie de notre planète.
Une réorientation de l’économie est donc indispensable. Il s’agit de passer à une économie de la ressource : moins extraire, moins gaspiller, augmenter l’efficacité de la matière à tous les stades de la vie des produits et enfin transformer en nouvelles ressources la masse de déchets du cycle. C’est ce qu’on appelle le développement durable.
Le dilemme court terme/long terme est surtout un enjeu citoyen, celui des consommateurs, sans lesquels rien ne changera. C’est de leur choix que dépendra la prise en compte des impacts dans les destructions environnementales, par exemple en achetant des produits pour une durée d’utilisation allongée. La non-réparabilité des produits, jugée à un coût trop élevé et rendue difficile par les producteurs, trouve une réponse dans une économie de la fonctionnalité. Le producteur ne vend plus un produit, mais son usage, dès lors qu’il assure sa durabilité et performance. Ce changement ne va pas de soi, mais il requiert un saut culturel qui doit être appris dès la plus jeune âge pour agir et réussir.