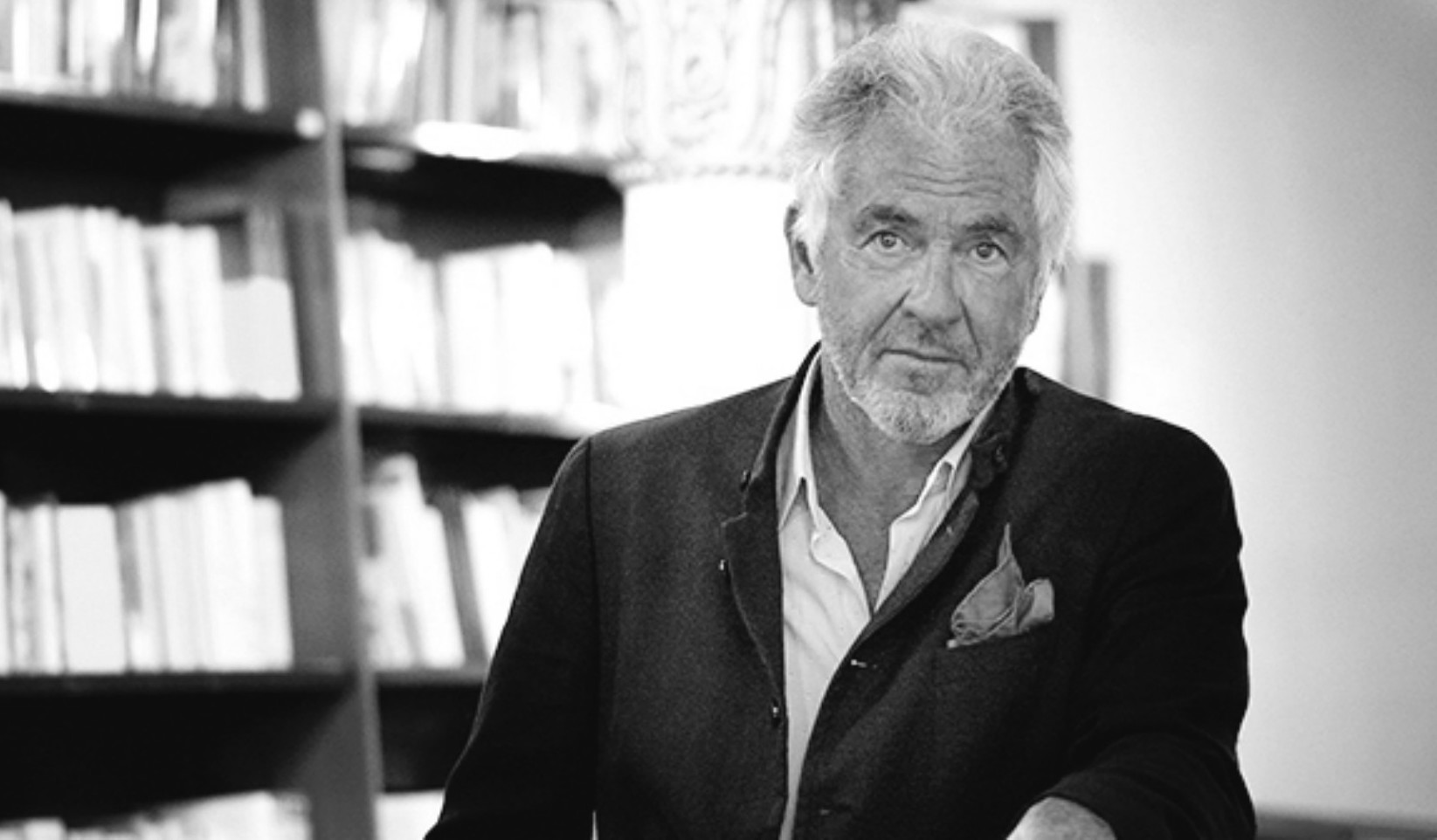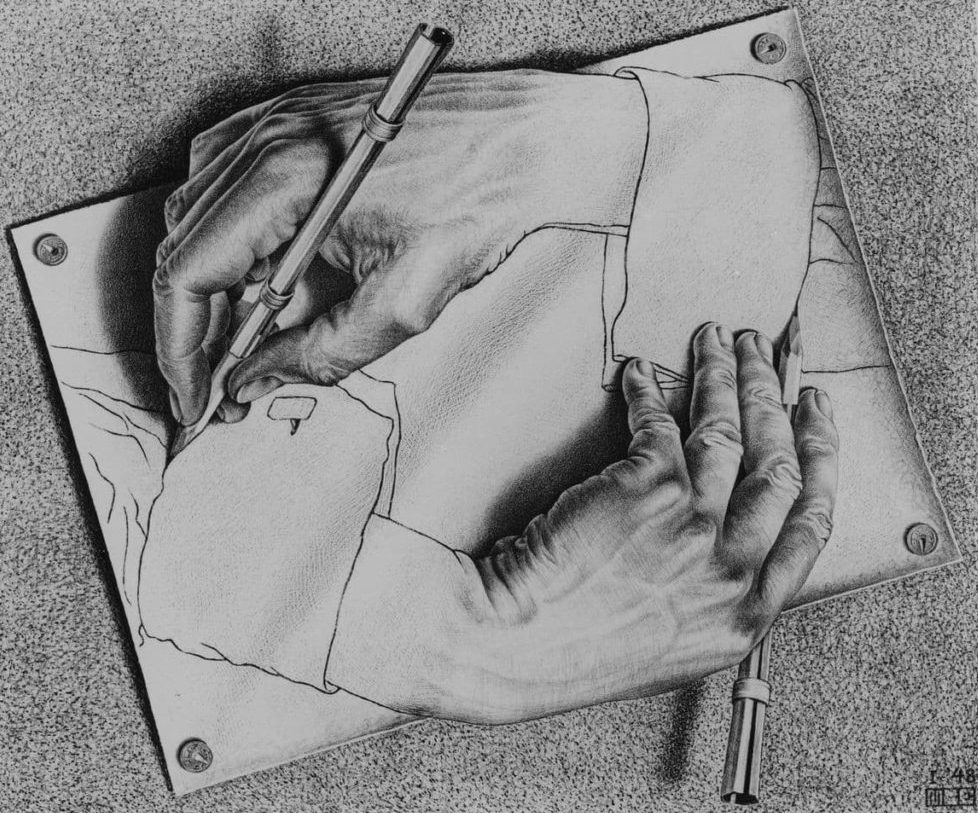Un pas de côté.
Je gagne ma vie à l’exercice de la psychanalyse. J’avais auparavant fait les Beaux-arts, puis des études de philosophie, enfin des études de lettres modernes, chaque fois convaincu de n’avoir pas les compétences requises pour transformer l’essai. Et c’est au cours de mon premier bail chez un psychanalyste que d’abord l’idée, puis l’envie, me sont venues de gagner ma vie en prenant place dans un fauteuil semblable à celui depuis lequel mon analyste m’écoutait.
Mais bien avant que je ne m’enrôle chez les lacaniens, c’est la littérature qui m’avait exilé dans son royaume, en même temps qu’elle me donnait les moyens de mettre en cause le monde. La première certitude qu’elle me donna fut que la logique des mots avait le pouvoir de tisser les rets où se prend celle des choses, certitude qui fit de moi quelqu’un d’extrêmement arrogant. N’ayant pas de légende dorée à faire valoir, je me consolais en me pénétrant de la conviction d’avoir un avis éclairé à offrir sur toute chose. Il n’était rien sur quoi je n’eusse une expertise à proposer, même quand on ne me demandait rien, ce qui était évidemment plutôt irritant. Et ridicule. Ceci pour faire écho à l’autodérision dont fait souvent preuve Jean-Paul, par exemple dans le très bel avant-propos de ses Saisons de papier. On peut en effet très facilement s’enivrer de soi-même, embellir son existence des plaisirs de la vanité, tourner autour de son nombril. Mais on peut aussi très vite déchanter. Car si on peut se vouloir aussi joueur, aussi libre, imprévisible et inventif que possible ; si on peut vouloir garder à sa pensée la souplesse, la vivacité et la grâce de la pensée de l’enfance ; si on peut se convaincre que l’on doit réapprendre à respirer et vivre (ce qui est beaucoup, et difficile, et long, ainsi que les enfants en font l’expérience), on se rend vite compte qu’il n’est pas si aisé de moduler son souffle sur la parole. S’engager dans une lutte contre la mors immortalis de la bêtise n’est pas mince affaire. Tous ses livres en témoignent. C’est ainsi qu’il m’a semblé reconnaître dans ce qu’il écrit la même conviction que celle qui animait déjà le très jeune homme que j’ai été, à savoir que le monde est privé d’esprit, c’est-à-dire de ce qui fait vivre : le souffle. Que nous avons eu, qu’on nous a imposé, beaucoup d’idées, beaucoup de notions, beaucoup de savoirs et de représentations ; que l’esprit s’est essoufflé dans la computation ; qu’on peut redouter le pire. Ses livres témoignent encore de ce que, de manière assez générale, les fièvres de l’anxiété et celles de la compétition se combinent pour aiguiser les volontés de puissance, entraînant l’état fragile et incertain de notre civilisation rationnelle et opératoire. Alors, pour se consoler, pour se rassurer, pour faire mine d’être libre, de n’être plus de ce monde fragile et incertain, il lorgne vers des paradis moins visibles que la coupole du Panthéon, il cherche à construire à sa guise l’utopie de sa propre vérité, pensant qu’il échappera ainsi au contrôle de l’auctoritas. À chacun, après tout, le droit égal de tirer le vin de sa vérité, de délivrer en gaudriolant les plus sublimes oracles, de s’enivrer en composant comme Rabelais l’avait fait des « fanfreluches antidotées ». Sauf que l’affaire n’est pas simple car une incertitude violente s’attache aussi loin qu’il remonte (et ceci est plus évident dans ses romans) à l’essence des choses, y compris celle en quoi il soupçonna très tôt qu’il consistait. Aussi n’est-il pas impossible que la quiétude, ou la légèreté, à laquelle il aspire lui semble parfois la dernière chose que ce qu’il a trouvé soit susceptible de lui donner. Peut-être même avait-il très tôt déjà soupçonné qu’il pourrait y avoir maldonne, que ses penchants, son attente plus ou moins bien inspirée, comme toute attente, n’étaient qu’une incongruité, ou l’inverse, un démenti à l’espérance apportée avec sa naissance. Allez savoir.
*
Il reste des cuites de l’adolescence ce qui reste quand il ne reste rien : un goût amer, des souvenirs imprécis dont on ne sait ni comment ni pourquoi ils sont restés. Les amis d’alors s’en sont allés comme il est normal qu’on s’en aille quand on est allé jusqu’au bout des ambitions furibondes dans lesquelles on avait mis tout son cœur, qui soufflent où elles veulent et n’ont pas de résidence. Rien n’est plus beau que cette houle forte qui vous fait croire que vous vivez ce que personne n’a vécu, que vous n’êtes pas qu’un fils incertain, qui vous fait vous étonner d’exister. Et pourtant cela s’en va et cela vous laisse désemparé. C’est un renoncement qui ne renonce pas ; le oui et le non n’y sont pas démêlés ; et penché là-dessus, plein du ressentiment que vous ne vous soyez pas accompli, interminablement vous essayez de désintriquer le oui de ce non. Vous vous entourez alors d’un rideau de bouderie opaque, ou vous riez haut ; vous faites tout ce que vous pouvez jusqu’à ce qu’il vous devienne possible enfin de broder le travail ténu qui vous affranchira de votre statut de pauvre fils, qui vous donnera l’outrecuidance de passionnément embrasser une seule manie, un art comme on dit, mais un seul, de vous y tenir, de férocement vous enfermer avec, comme dans un sac au fond de quoi vous avez jeté vos origines, les conventions et les attendus qui y sont associés et qui pèsent sur vous. Il s’agit de ne pas avoir peur d’être par cette manie, par cet art, dévoré ; il s’agit de ne pas se disperser, de ne pas s’atteler à toute sorte de besognes, de ne pas renoncer à devenir ce que vous savez devoir être. Il y a en chacun de nous un individu inachevé, déterminé à nous interdire d’accéder à nous-mêmes. Jean-Paul en a parlé à propos de Stendhal[1]. Il y témoigne de la difficulté à trouver le courage d’aller à soi, sans vanité et sans honte. Ce courage se gagne lentement. Il faut pour y réussir aller à son pas, décourager les familiarités, et remercier pour la solitude qui pourtant blesse. Mais il faut aller, nu, à son risque. L’amitié, quand elle a lieu, y aide. C’est elle qui me fait écrire ces pages. Elle nous aide à nous découvrir à nous-mêmes étrangers, parfois à nous constituer neufs ; à concevoir quelque chose sur quoi il serait possible de mettre le pied. Il s’agit de trouver sa voie, de ne pas tourner en rond dans les sentiers des autres. D’éviter les lubies, les fausses licences. De n’être pas raide, crispé dans une contention douloureuse. Il s’agit de s’aider mutuellement.
Il me souvient d’avoir lu (je ne sais plus où, chez Claudio Magris peut-être) qu’il est abusif d’avoir la prétention d’entrer dans les pensées et les sentiments de quelqu’un d’autre. Le psychanalyste que j’essaye d’être ajouterait : même quand ce quelqu’un nous les confie. Tout au plus peut-on chercher à comprendre, ou à imaginer. Saint Paul disait que nous voyons comme dans un miroir, et par énigmes. C’est très certainement ce que je fais ici. Qu’ai-je donc reconnu chez Jean-Paul ? De quoi me suis-je tout de suite senti si proche ? Me revient ici le souvenir d’une conversation téléphonique, la première que nous avions eue. Nous avions parlé de choses et d’autres pendant près d’une heure, laissant flotter nos pensées. Comme il m’avait prévenu la veille être d’humeur lourde, c’est par là que j’avais entamé la conversation, lui demandant à quoi était due cette lourdeur. Sa réponse m’avait rappelé un commentaire, presque un avertissement, qu’il m’avait fait suite à l’annonce de mon prochain déménagement : « Les déménagements », m’avait-il dit, « sur l’échelle des causes de la mélancolie, viennent tout de suite après les chagrins d’amour et le chômage. » Je n’avais pas accordé grande importance à ces mots, pensant qu’il ne parlait après tout peut-être que de lui-même. Mais j’avais très vite dû me rendre à l’évidence de mon erreur car, malgré mon bonheur d’avoir trouvé l’appartement que j’occupais désormais, malgré la joie intense que j’éprouvais à son installation, j’avais en effet le plus grand mal à m’y poser. Je le lui dis. Il me rappela alors le conseil qu’il avait ajouté à son avertissement : je devrais lire, ou relire, La mort d’Ivan Ilitch. Car c’est bien suite à un déménagement que celui-ci meurt. « Alors », me demanda-t-il, « Que faites-vous pour votre mélancolie ? » Et l’évidence s’imposa : c’était bien pour la soigner que j’avais entrepris d’écrire ce que vous lisez.
*
J’écoutais le 5 juin dernier un entretien avec Martin Amis et Elmore Leonard (surnommé le Dickens de Détroit). Nous sommes en 1999. Il y est question du pacte que chacun fait avec la littérature. L’exigence première de Leonard était (il est décédé en 2013) que ce qu’il écrivait fût, justement, le moins écrit possible. Amis disait de lui qu’il avait l’oreille absolue et regrettait de n’être lui-même pas capable de la sobriété dont faisait preuve Leonard. Je parlai de cet entretien à Jean-Paul à peine eus-je terminé la lecture de Ce que nous avons eu de meilleur[2]. Car, comme dans tout ce que j’avais alors lu de lui, c’est à mon avis d’abord de ce pacte qu’il s’agit dans ce roman ; c’est en tout cas à cela que j’avais été le plus sensible. Il y a chez Jean-Paul quelque chose comme un devoir d’écriture, un engagement passionné, une ferveur. Et il m’avait semblé qu’il était ici plus que dans ses autres romans pris à la gorge par quelque chose que j’avais du mal à identifier mais qui a à voir avec, entre autres, la solitude. J’avais du mal à saisir à quelle nécessité ce livre répondait. Je le lui ai donc demandé. Il m’a simplement répondu ceci : « Il fallait que je raconte cette saison de ma vie, voilà tout… ». Rien, donc, que le besoin de dire, sans que jamais pourtant le texte ne naisse d’un quelconque spontanéisme, en s’installant au contraire mordicus dans le goût de la langue maîtrisée, tenue et jouissant d’être tenue.
Jean-Paul ne fait jamais l’écrivain, ne prend jamais la pose. Les textes de lui que j’aime le plus sont des partitions, ils ont chacun leur propre rythme, leur propre tempo. Ils viennent en même temps du corps et du plus haut esprit. Les drums, les solos, la volonté d’une phrase et son rythme, rendent évident qu’il s’agit de la mise en place d’un dispositif du désir. Je pense qu’il se demande sans cesse : comment fait-on ça ? Comment fait-on pour que la langue dans laquelle on écrit donne un signe de vie ? Comment faire pour que la langue fasse place à l’idiome, au nom, et peut-être à la chair de qui écrit ? Ses essais, ses portraits, ses critiques (auxquels je suis plus sensible qu’à ses romans – comme c’est de toute façon le cas de manière générale), sont écrits dans une langue capiteuse, souvent somptueuse. Ce sont des textes très doux mais qui portent en eux une violence tout aussi profonde que leur douceur. Et c’est par cette douceur que Jean-Paul le plus souvent, pas toujours, fait pacte avec la vérité. La douceur est une éthique redoutable, disait Anne Dufourmantelle. Elle ne peut se trahir, sauf à être falsifiée. Ce que fait Jean-Paul en témoigne. De l’animalité, la douceur garde l’instinct ; de l’enfance, l’énigme ; de la prière, l’apaisement ; de la nature, l’imprévisibilité : de la lumière, la lumière. Ce qui fait la force de ses textes, c’est qu’ils procèdent d’une nécessité, ce ne sont pas des artefacts. Ils donnent le sentiment qu’écrire est vraiment pour lui une porte de sortie, que cela le délivre de quelque chose. Il s’y accorde le droit à l’« égoïsme supérieur » dont parle Nietzsche (qui est tout autre chose que le narcissisme), sans lequel on ne fait rien de bon. Je me demande parfois s’il lui arrive en écrivant, ne serait-ce que très brièvement (nous n’en avons jamais parlé), de s’ancrer en lui-même presque rageusement et de se croire unique, irremplaçable, dans le seul but de faire du beau ; de se surévaluer, puis de se dévaluer, d’abandonner toute juste mesure. Je veux le croire, je l’espère pour lui. Et cela, je le répète, n’a rien à voir avec « faire l’écrivain ». C’est s’engager corps et âme. C’est prendre le temps sur tout le reste. Je songe en écrivant ces mots à Francis Ponge. Il disait qu’il écrivait pour se laver. C’est peut-être vrai pour quiconque écrit, c’est en tout cas vrai pour moi. Jean-Paul, lui, est encore plus radical : il dit vouloir se désinfecter de ce qui l’avait de naissance, en Algérie, contaminé. Par exemple, de la saleté qu’il a toujours associée à l’expression pied-noir.
Il me paraît conséquent de ne pas me livrer sans prudence, sans inquiétude, sans défense même, à une quelconque demande d’identification. D’avoir la conscience la plus lucide possible de tout ce qui peut piéger dans une telle demande. Même si je souhaiterais, bien entendu, ne fût-ce que pour moi-même, pour ma propre tranquillité, qu’il y eût un langage, des modes d’anamnèse sûrs, un récit fiable pour rendre compte de mon histoire, de mon héritage. Mais cette histoire, cet héritage, sont multiples, peu homogènes, pleins de greffes de toute sorte, de contrastes, d’emprunts, de mélanges, de croisements. De telle sorte que je suis toujours dans mes échafaudages, que des voix multiples s’entr’empêchent, que soudain je ne suis plus, que je ne puis plus être qui j’avais coutume d’être, que c’est quand les autres parlent, et pas moi, mon île, comme dit Henri Michaux. Alors je me demande, comme Jean-Paul se le demande peut-être, où cela me conduira. Je ne peux absolument pas savoir, prévoir, prédire, ni ce qui adviendra de moi, ni quelle place je pourrai faire mienne et depuis laquelle il me deviendrait possible d’entr’apercevoir comment pourrait éventuellement se nouer mon « destin ». Il faudrait d’ailleurs que je me renseigne et tire cela au clair : qu’appelle-t-on, au juste, et avec tant d’obstination, destin ? Chose certaine, depuis Les enfants de Saturne jusqu’à son dernier livre paru au moment où j’écris ces pages, Si le soleil s’en souvient, Jean-Paul revendique le droit, ainsi que Marc Lambron le souligne[3]de s’inventer un destin.
Chacun est confronté à cette question aussi simple que difficile : pourquoi ai-je ce rapport-ci et non un autre à ce dont j’ai malgré moi hérité, à ce qui m’arrive sans que je l’aie demandé, sans même que je m’y sois le moins du monde attendu ? Avec ce que je découvre m’avoir été, justement, destiné. Le destin, disait quelqu’un que Jean-Paul a fréquenté – Jacques Derrida, à propos de qui nous avons parfois parlé, et pas toujours en arrivant à nous entendre –, c’est une manière singulière de ne pas être libre, un croisement de chance et de nécessité, une ligne de vie, dirai-je, pour faire écho au titre de son livre, ligne de vie imposée et qui n’est jamais pure. Ce qui fait que je me retrouve (en partie malgré moi) engagé sur toutes sortes de chemins qui sont autant de détours pour rejoindre cette écriture idiomatique dont je sais la pureté inaccessible mais dont je continue de rêver.
Mon rapport à cet héritage m’installera inévitablement dans une position, dans une posture paradoxale : je verrai cet héritage tantôt comme une chose surannée jusqu’au ridicule, tantôt au contraire comme une chose incontestable, presque sacrée. Je voudrai tantôt m’y soumettre, me fondre dans le moule, et à d’autres moments au contraire le dépasser, inventer de nouvelles normes, me refonder, comme dit Lambron.
Se refonder ? Comment ? En se mettant ailleurs. Il faut se mettre ailleurs, quitter sa terre natale. C’est Hugues de Saint-Victor (1096-1141) : celui qui trouve de la douceur à sa terre natale est un tendre débutant ; celui à qui toute terre est natale est déjà fort ; celui pour qui toute terre est étrangère est parfait. C’est encore Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969) : il faut à tout prix refuser le monde administré ; l’écriture est la seule demeure ; c’est un devoir moral de ne jamais se croire chez soi chez soi. Voilà Jean-Paul. Il a sans doute, comme il est normal qu’on le soit, été un peu long à la détente, mis du temps à comprendre comment ça devait se passer, la vie. Il a cherché un portail, une ruse, un moyen, n’importe quoi qui le fasse passer aussi rapidement que possible, sans compromis, dans quelque chose qui vive de sa propre clarté. Ce fut la littérature, puis ce fut écrire. Il s’agissait pour lui de ne pas être déçu par ce qu’il faisait. Sa relation à l’écriture devint très vite sa seule demeure, quelque chose de presque fétichisé, de telle sorte que ne pas écrire devint un problème pour sa vie et sa survie. Alors, même s’il n’est jamais absolument sûr de son coup, il écrit, obstinément et comme naturellement. Mais personne n’est jamais sûr de son coup, n’est-ce pas ? Tous ceux qui écrivent connaissent ça très bien, ce rapport empêché, transgressé à l’écriture, jamais évident. Même si c’est leur vocation, même si c’est exactement ce qu’ils veulent faire, c’est toujours quelque chose qu’ils font en sachant, en pensant ou en fantasmant qu’ils ne peuvent pas le faire. Voyez Marguerite Duras. Alors ils rêvent d’écrire des blocs de prose impeccable, rare et sans compromis, des textes laconiques et flamboyants, mallarméens, anachroniques. Ils reconnaissent en eux le désir de prodige dont parlait Bataille. Ce serait leur portail, ce serait leur rupture, ce serait leur salut. Ainsi, je crois, pour Jean-Paul.
Pourquoi ça ? Pourquoi ce désir, puis cette volonté ? Les raisons sont pauvres, elles relèvent de leur histoire personnelle. Il y a un état du monde qui les écrase et ils le refusent. Mais ça ne suffit pas. Refuser ne suffit pas, il faut transformer le refus, il faut l’étayer de raisons objectives plus nobles que les pauvres raisons personnelles, familiales, intimes. Ou alors, il faut faire valoir la portée universelle de ces pauvres raisons, ce qui ne veut pas dire les déguiser, ce qui veut dire reconnaître que les raisons ne sont jamais que des raisons et que l’enjeu, l’objet, le primum movens est ailleurs. Il s’agit de rompre avec un état de la langue qui ne convient plus, de trouver une posture énonciatrice grâce à laquelle ils tiennent debout leur existence. Ils cherchent leur minimum vital, ils cherchent ce qui leur suffit absolument, ce qui leur est strictement nécessaire et évident. Ils cherchent leur corde raide, sur la corde ils cherchent l’équilibre, le pas rythmé, la cadence, même la danse. Ils ferment les yeux et c’est fait, ils sont hors d’atteinte du temps, ils se sont emparés de la langue, ils se trouvent l’air d’un auteur, la Littérature les reconnaîtra pour un des siens. C’est la frime, le cinéma nocturne dont ils ont besoin. Balzac le dit sans ambages. Jean-Paul a lu Balzac et comme Balzac il sait que cette frime, cette farce est aussi un combat et que ce combat, comme le dit Michon[4] est le modus scribendi et non le thème, l’objet, ou l’énoncé du livre. Chacun est rhétoricien à sa façon. Pas seulement ceux qui écrivent. Chacun essaye de parler de ses expériences, si difficiles, si intraduisibles. Chacun essaye d’accorder ses endurances de ce qu’est pour lui la vie, sa veille, ses lieux, les rôles qu’elle lui assigne, son temps et son labeur propres, avec les endurances de quelques autres. C’est par la rhétorique, même très pauvre, même presque indigente, que chacun s’éprend de sa vie et de ce qu’il en partage, de ce qu’il en montre. C’est que la langue fabrique de la transcendance, et pas que dans des circonstances exceptionnelles. C’est ce que Jean-Paul essayait de faire tout petit déjà, dès qu’il eut compris qu’appartenir ne serait jamais simple, ni même forcément possible. Ainsi il écrit, parlant de Proust : « …explorant cette Recherche, n’importe quel esprit sensible (…) se persuadera (…) que la littérature (secondée par la musique et la peinture) est l’unique forme de transcendance encore disponible dans un monde où Dieu n’existe plus. »[5] Très tôt en effet (il avait à peine vingt ans, il publiait son premier article de critique littéraire), Jean-Paul s’est retrouvé jusqu’au cou dans de l’irrémédiable, de l’incommensurable, qui l’a fait porter devant lui comme un poing de grands morceaux de langue, disproportionnés, opiniâtres, issus d’une passion ravageuse, ogresse, qui lui firent tomber dans l’oreille la grâce de phrases justes qui vous tirent en avant, au rythme juste qui vous pousse furieusement dans le dos. Il fut ébloui par ces phrases qui disent le vrai, qui profèrent le sens, elles firent grandir sa faim, lui firent se sentir des bottes de sept lieues, brûler de se mesurer à des Maîtres, en tout cas consacrer sa vie à cette grâce : « Mon programme d’alors était simple et tout d’exécution : m’acquitter au plus vite de quelques gammes avant d’envisager des partitions plus amples ; repérer des convictions, les goûter, les ajuster à ma mesure, en apprécier les conséquences ; échauffer mon style ; allonger ma foulée ; maîtriser les humeurs de la ponctuation ; m’exercer au maniement des idées, des métaphores, des incipit ; avant de voir où tout cela pourrait bien mener… »[6]
Je me plais à l’imaginer très tôt non pas calculant, car ce sont là mathématiques qu’il sait trop incertaines, mais imaginant ses effets, surveillant la braise, fécondant les cendres, voulant faire quelque chose sur quoi on pourra mettre le pied. Il faut lui accorder que son rêve n’est pas qu’orgueil, que fraude du diable.
Il n’est d’abord pas assuré qu’il pourra être des leurs : « Avais-je bondi sur un tapis volant ? Celui-ci m’emporterait-il, comme prévu, vers des séjours conformes à ce que l’imagination, les grands romans et le mimétisme m’avaient appris à désirer ? Fiévreux, j’étais en chemin vers la zone idéale où m’attendaient ceux des aînés dont je revendiquais timidement la compagnie et le parrainage… »[7]Leurs bustes sont partout, dans les parcs, sur les pianos, dans les musées, chez les antiquaires, dans les salons ou les mansardes de poseurs caves qui se rêvent en maître de la langue quand ils n’en ont qu’une petite bouture (Michon encore), partout. Certes il veut perpétuer la lignée de ces flagrants aïeux qui lui donnèrent le jour et ne le quittèrent plus, il veut garder sa place dans cette filiation canonique, mais cette volonté n’est pas pure. Car s’il entend qu’on l’en reconnaisse issu, il n’en veut pas moins pour autant couper le long cordon ombilical qui remonte loin dans l’au-delà. Il veut en finir avec les vieux modèles évangéliques, il cherche une autre voix, un rire monte aigu dans son dos, on ne le roulera pas dans la farine, il ne pissera pas dans un violon, il veut bondir dans sa danse, il le dit de sa voix vibrante, la gloire existe et il la manifestera, il est jeune et puissant, il est libre, il mènera grand raffut, sur lui des destins trébucheront. Le mot gloire vient tout droit sur lui. On dira que c’est la faute au vent et aux circonstances, manière de dire que ça ne s’explique pas et que ça oblige à parler affaires ; avec la peinture, avec la musique, avec la langue, c’est sort égal, c’est même chance ou même malheur, toutes choses étant mutables et proches de l’incertain.
[1] Cf. Les enfants de Saturne, op. cit., p.244.
[2] Grasset, 2008.
[3] In Les soleils de la vérité, Le Point, 14 mars 2024
[4] Trois auteurs, Lagrasse, Verdier, 1997, p. 30.
[5] Saisons de papier, op. cit., p.439
[6] Ibid, p.9-10
[7] Ibid, p.10