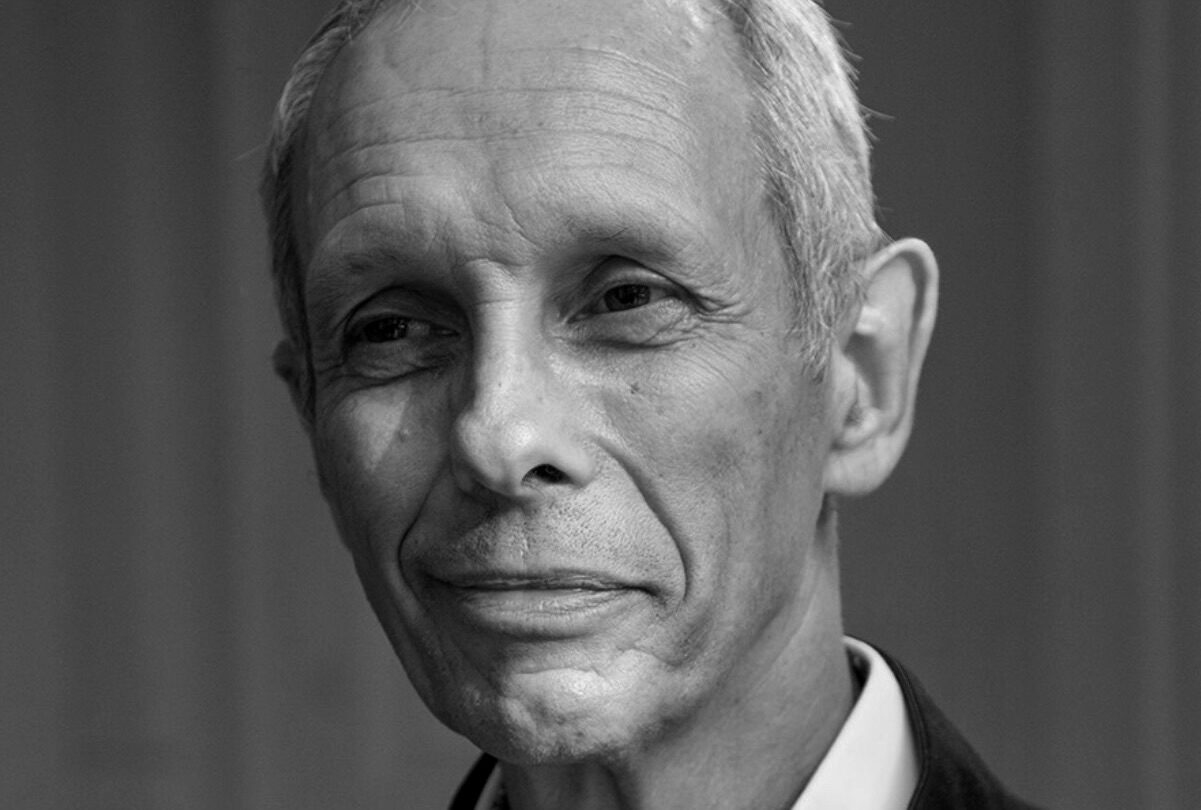Comment parler du procès des viols de Mazan, procès d’une femme seule contre cinquante et un hommes, « cinquante et un individus sur un rayon de 50 km pour profiter sexuellement, sans le moindre échange, d’un corps qu’on croirait mort et qu’il faut rouler sur lui-même pour le mouvoir », pour reprendre les paroles si fortes d’Antoine Camus, l’un des deux avocats de Gisèle Pelicot ? Comment en parler après tant de paroles admirables, d’abord de ses avocats, puis des observateurs judiciaires, d’experts, de philosophes, de psychiatres… ? Mais comment ne pas en parler ? Comment reculer devant l’amicale proposition de Maria de França, qui sait que je suis un homme obsédé par l’injustice faite aux femmes depuis la nuit des millénaires avant nous ?
Comment cinquante et un individus, au premier rang desquels Dominique Pelicot, ont-ils pu abuser d’une femme, de sa femme, qui n’était plus qu’un corps sans visage ? Comment ont-ils pu abuser d’une femme, au cours de quelque deux cents viols, entre juillet 2011 et octobre 2020, à la demande de son propre mari ? Abuser et se laisser abuser par ou pour la seule recherche du plaisir sexuel – mais quel plaisir y a-t-il à abuser d’une femme inconsciente ? – est une monstruosité. Mais quel plaisir y a-t-il pour peu que l’on soit homme, pour peu que l’on soit humain, quand on prend conscience « qu’on n’a pas été juste », comme dit Platon ? Et Socrate d’interroger Polos, c’est-à-dire chacun d’entre nous : « Quelle chose est pire, selon toi, commettre l’injustice ou la subir[1] ? » Aristote évoque ces « êtres dont la perversité est incurable[2] ».
Aborder le procès Pelicot est d’abord parler de notre responsabilité d’homme vis-à-vis des femmes en France, en Occident, dans le monde. Un chiffre : une femme est tuée par un proche toutes les dix minutes dans le monde.
L’éminente ethnologue Germaine Tillion, qui fut résistante, déportée à Ravensbrück, qui œuvra toute sa vie pour la dignité humaine, a écrit : « Très généralement spoliée malgré les lois, vendue quelques fois, battue souvent, astreinte au travail forcé, assassinée presque impunément, la femme méditerranéenne est un des serfs du monde ac uel. » Il ne s’agit pas que de la femme méditerranéenne, ce qui serait déjà effroyable, mais il s’agit d’une horreur que l’on retrouve partout, jusqu’aux abominations qui se passent parfois en Inde. En 2022, les violences contre les femmes ont fait une nouvelle victime. Ankita Singh, 19 ans, a été brûlée vive par un homme qui la harcelait pour l’épouser. Dix ans avant, en 2012, le viol collectif de Jyoti Singh dans un bus de New Delhi avait horrifié l’Inde et le monde. Ce crime d’une brutalité inouïe, qui avait causé la mort de la victime, illustrait les violences sexuelles subies par des dizaines de milliers de femmes chaque année dans ce pays.
Les violences étatiques comme les violences privées telles que le viol, l’inceste, poussent ces femmes à risquer aujourd’hui, en Iran, leur vie même pour faire valoir leur dignité. Il fut un temps où ces femmes bafouées étaient arrivées à un point de désespoir tel qu’elles en étaient réduites au silence, à n’en pouvoir crier, à n’en pouvoir se plaindre. Aujourd’hui, partout dans le monde, les femmes se lèvent, en Iran, en Afghanistan, mais aussi en Inde et dans bien d’autres pays où elles sont réduites à n’être que les esclaves de systèmes religieux tenus par les hommes, juste bonnes à la reproduction, quand ce n’est à se faire violer impunément, sans aucun droit à la dignité, à la justice qui s’applique aux hommes, la justice d’aller à l’école, à l’université, la justice d’étudier, de travailler, de s’habiller comme elles veulent.
Emmanuel Levinas, dans son sens radical de l’épiphanie du visage, écrivait : « Je pense même que craindre Dieu signifie avant tout avoir peur pour autrui. […] Je pense avant tout au pour-l’autre en eux où l’humain interrompt, dans l’aventure d’une sainteté possible, la pure obstination à être et ses guerres[3]. »
Gisèle Pelicot est devenue sous nos yeux l’héroïne d’une histoire infâme. Deux cents viols sur dix années commis par cinquante et un hommes sur la femme de l’organisateur de ces démoniaques parties, sur une femme nue et inconsciente car sédatée, est l’un des faits les plus monstrueux commis sur une femme vivante, abusée, niée, rendue à l’état de chose, incapable de se défendre, incapable de se révolter, juste bonne à provoquer le plaisir à des sadiques, à des hommes qui n’ont commis, à leurs propres yeux, qu’un banal viol, que la « banalité du mal ». Ces hommes, à commencer par le mari infâme, ont tous été ici le « bourreau » dont parle Levinas, « celui qui menace [mon] prochain et, dans ce sens, appelle la violence et n’a plus de Visage[4] ». Pour le bourreau comme pour le criminel, la victime n’a plus de visage. Ainsi, Gisèle Pelicot était-elle devenue un corps à plaisir sans visage. Aristote avait déjà prévenu : « si faire un acte qui est bon dépend de nous, il dépendra de nous aussi de ne pas faire un acte qui est honteux[5]. » Comment ces criminels peuvent-ils prétendre, pour certains, avoir été dans l’ignorance ? Le premier acte intentionnel fut dans le seul fait d’avoir répondu à Dominique Pelicot et d’avoir sciemment abusé de sa femme. Aristote approuve totalement que les juges punissent « des actes faits sans connaissance de cause, quand l’individu paraît coupable de l’ignorance où il était[6] ». Parmi les actes les plus impensables, les plus immondes, commis sur Gisèle Pelicot, est celui de « ces “fellations” imposées avec un mari tenant grande ouverte la bouche de son épouse, au risque de l’asphyxier, pour que l’invité du soir puisse la pénétrer », comme le rapporte Pascale Robert-Diard (Le Monde, 27 novembre). Cette scène filmée fut projetée lors du procès, entraînant une aggravation des réquisitions et la répulsion de l’assistance. Cette scène fait tout simplement vomir de honte, d’indigestion de la honte commise et de la honte éprouvée.
Un précepte fut énoncé voici près de 2000 ans par la tradition juive : « Là où il n’y a pas d’homme, efforce-toi d’être un homme ! » (Les Maximes des Pères II 6, Pirkei Avot) Comment en effet parmi les cinquante hommes à avoir répondu à Dominique Pelicot, ou même si l’on excepte le pervers, le déficient mental, celui qui était sous « emprise » du mari et le schizophrène, parmi les quarante-six restants, comment expliquer que pas un ne se soit rétracté, et plus, que pas un n’ait cherché à mettre fin à ces viols sur une femme inconsciente, soumise, sans pouvoir se plaindre, sans pouvoir crier sa douleur ? Comment pas un de ceux-là ne s’est efforcé d’être simplement un homme, qui puisse se regarder dans un miroir une fois de retour chez lui ? C’est cet avilissement de l’épouse qui fait effroi.
Une femme sans visage n’est plus un sujet. Levinas avait admirablement compris qu’« Autrui me résiste par le découvert total et la to- tale nudité de ses yeux sans défense[7] ». Lorsque l’homme ne se dessaisit pas de sa superbe, de son orgueil de jouisseur criminel, alors la femme survivante doit reprendre l’autorité sur le pervers incurable, comme Judith décapitant Holopherne, dans le livre deutérocanonique de Judith. La « nudité de ses yeux sans défense », voilà le crime de s’en être pris à une femme sans visage, sans regard, sans conscience.
Jusqu’où se soucier des autres ? Jusqu’où se soucier de l’être de l’Autre et non plus du Même, car comment oublier l’avertissement de Pascal, infatigablement répété par Levinas : « Ma place au soleil. Voilà le commencement et l’image de l’usurpation de toute la terre » ? Ma place de jouisseur me fait honte. Peu importe ces questions à ces criminels.
Et puis cette parole de Dostoïevski qu’il rapportait tout autant : « Nous sommes tous coupables de tout et de tous devant tous, et moi plus que tous les autres[8]. »
« Mais à cette idée – sans la contredire – j’ajoute aussitôt le souci du tiers et, dès lors, la justice. Ici s’ouvre donc toute la problématique du bourreau, du tortionnaire, du violeur : à partir de la justice et la défense de l’autre l’homme, mon prochain, et pas du tout à partir de la menace qui me concerne[9]. » L’autre est pourtant si souvent une femme, une femme violentée, une femme violée après avoir été droguée, une femme laissée pour morte, une femme assassinée par son mari, son concubin, une femme torturée à mort à cause d’un voile mal posé.
L’histoire judiciaire française – et sans doute occidentale – retiendra la détermination d’une femme qui a tenu tête à son ex-mari et à ses cinquante violeurs, soutenue dans son combat par ses trois enfants, Florian, David et Caroline. Florian Pelicot a dit à son père, lors du procès : « Tu as toujours dit que maman était une sainte, mais toi tu es le diable en personne. »
Gisèle Pelicot a, de fait, transformé « un destin subi en destin dominé » (Malraux). Ce fut là toute sa force, tout son courage, que de garder la tête et le regard hauts face à ces hommes qui l’ont avilie, piétinée, niée en tant que femme, en tant qu’être humain. Mais pour une Gisèle Pelicot, devenue une sorte d’icône malgré elle, combien de femmes toujours victimes de viols, de tortures morales et physiques de la part d’un conjoint sadique, pervers, méchant ? Combien de femmes qui ne feront pas la une des médias et sans doute, le pire, combien de femmes dont on ne connaîtra jamais les épreuves et qui ne pourront jamais ni accuser ni se reconstruire ?
Au-delà du caractère indiscutable de la victoire morale de Gisèle Pelicot, Philippe Bernard, dans son éditorial (Le Monde) du 8 décembre écrit : « La voix de Gisèle Pelicot ne doit pas se perdre dans l’offensive qui veut interdire à l’école la question des rapports hommes-femmes. » Oui, tout commence à l’école autant que dans la famille et quand la famille est déficiente sur le plan de la morale, l’école doit prendre son rôle fondateur de lieu de transmission de la morale, du civisme, autant que de la laïcité.
Comment faut-il procéder pour en finir avec la banalité du viol, si souvent son impunité ? Au- jourd’hui, les incantations « Il faut que », les vœux pieux « Puisse faire que… », n’ont plus de place dans nos discours. La seule, la dernière chose qui puisse en avoir est de tout mettre en œuvre pour que nos sociétés prennent ici leur part de responsabilité – c’est-à-dire chacun d’entre nous – et pour ce qui est de la prise de conscience des crimes commis contre une femme et pour ce qui est du verdict de ce procès d’exception. La dernière chose qu’il nous reste à faire, à nous, à la société dans laquelle nous vivons, est de tenter de rendre la confiance à tant de millions de femmes qui ont été réduites à l’état d’esclave sexuel, en leur rendant leur visage, leur regard, leur dignité.
[1] Gorgias, trad. par Monique Canto-Sperber, GF Flammarion, 1987, p. 186.
[2] Op. cit., p. 228.
[3] Emmanuel Levinas, Entre nous, LGF, Biblio essais, p. 127 et 243.
[4] Ibid., p. 115.
[5] Ethique à Nicomaque, trad. par Alfredo Gomez-Muller, LGF, « Classiques de la philosophie », 1992, p. 123.
[6] Ibid., p. 124.
[7] Œuvres 4, édition de Dan Arbib et Danielle Cohen-Levinas, Grasset, 2024, p. 650.
[8] Les Frères Karamazov, traduction Henri Mongault, Gallimard, La Pléiade, 1952, p. 310.
[9] Entre nous, op. cit., p. 115.