Benoît Duteurtre m’avait envoyé récemment un gentil mail : il me remerciait pour les choses gentilles que j’écris sur lui dans le premier tome de mon Journal. Mais c’était la moindre des choses : ami puissant, il était lui-même la gentillesse incarnée. C’était à vrai dire un pèlerin : il voyageait de littérature en opérette, d’opéra en articles, d’émissions de radio en pamphlets, d’éditoriaux en conférences. Avec cette même touche, toujours : la modestie de l’écolier, dont il possédait l’immarcescible allure. Ce Pic de la Mirandole était aussi notre Dorian Gray. Tout l’intéressait, presque tout le passionnait. Il jouait Debussy en écoutant James Brown, qu’il comparait à Bach. Il m’avait fait découvrir Poulenc. Maintenant que son histoire est tout à fait finie, on va j’espère découvrir ses livres, adoubés par Beckett et Kundera, qui l’aimaient, qui le respectaient, qui le protégeaient. Benoît, affable et poli, discret et souriant, n’était évidemment pas exempt d’une certaine agitation, d’une magnifique violence : elle se devinait un peu sous sa douceur, mais surtout se manifestait dans ses romans, qui tous désespéraient de l’époque. Duteurtre était fidèle à son passé : il ramassait dans ses œuvres les misérables débris qui subsistent encore de la France des années soixante et soixante-dix, et cernait les vicissitudes de la modernité pour les dire simplement, frontalement, cliniquement. C’était une sorte de fantôme, à ceci près qu’il n’était pas mort avant nous : il mourrait après, car l’agonie n’était pas faite pour cet amoureux de la vie, toujours entre deux rencontres, deux concerts, deux découvertes, deux sidérations, deux romans. Je ne crois pas qu’il se prenait au sérieux ; mais, comme tous les écrivains qui méritent ce nom, il prenait au sérieux l’écriture, ses romans, ses textes, ses livres. Il avait l’espoir, mérité, de graver son nom sur le linteau de la littérature contemporaine : le public le suivit peu, mais la critique dévorait ses parutions, pour les encenser.
Il avait tout pour être de gauche, mais il ne l’était pas. Maurice Szafran nous avait baptisés, Duteurtre et moi, « l’aile de droite » de Marianne. Nous étions alors en train de préparer le premier numéro. Je me souviens de Benoît après les réunions, chaque jeudi je crois, quand nous marchions longuement dans Paris à parler de Paulette Dubost, de Maurice Chevalier, de Philippe Sollers ou de Phi-Phi. Son savoir, encyclopédique, était incarné. Pas scolaire, jamais. Cet éternel gamin aux taches de son et aux dents du bonheur, sorte de Gavroche sorti d’un Collège de France personnel et buissonnier, ne maîtrisait que ce qui lui faisait du bien. La vie, selon lui, était trop courte pour s’infliger du Boulez : la mélodie était plus importante, plus vitale, plus simple, que les intellectualismes et les snobismes. Il était simple, mon ami Duteurtre. Il aimait le vin, la cigarette, un joint de temps en temps, et écouter de vieilles émissions de radio sur des bandes magnétiques des années de Gaulle. Il était subtil, il était drôle, raffiné et fin : il semblait ne jamais souffrir, ce qui n’est pas normal et, sans doute, n’était pas vrai. Ses souffrances, disons qu’il les taisait.
Ce que je puis dire aujourd’hui, là, maintenant, c’est que je souffre, moi, de sa disparition. La mort lui va particulièrement mal. Je commence à en avoir marre, de la mort. Elle se trompe sans arrêt de destinataire. Quand je pense à tous ceux qui la méritent et qu’elle épargne, je m’insurge. Je suis scandalisé : pas lui, pas Benoît. On avait fini par le croire éternel à cause de son éternel visage poupin. Les traits sont trompeurs. J’ai une seule satisfaction. Elle est minuscule. Elle est dérisoire. Moi qui me brouille systématiquement au moins une fois avec mes amis, Benoît échappe à cette logique, c’est l’exception qui confirme ma règle. Je suis heureux que cela tombe sur lui.
Je vais relire ses livres. Je les possède presque tous, gentiment dédicacés. A-t-on encore le droit de dire que cet adolescent de soixante-ans dépassés était « charmant » ? Je sais qu’il fut meurtri par ses échecs à l’Académie française. Ce n’était pas si grave : la vie est ailleurs, comme l’écrivait l’un de ses maîtres et amis. N’empêche que c’est bel et bien terminé, Duteurtre : plus de dîner sur des toiles vichy, plus de sa piquette de l’île Saint-Louis, à critiquer Mme Hidalgo et se tracassant sur la notion de style : « Je ne suis pas certain d’avoir trouvé le mien. J’hésite encore. Du coup, je préfère opter pour la ligne claire, comme Hergé. » Cela tombe bien : il y avait en lui quelque chose de Tintin.
Je suis au comble de la stupéfaction. Je suis au comble de la sidération. Je suis au comble du chagrin. Il ne faisait de mal à personne. Il travaillait dans son coin. Il aimait ses amis. Il sortait sans brailler. Il voyait tout, et ça ne se voyait pas. On s’en apercevait après coup, en le lisant : rien ne lui avait échappé. Et le voici tombé dans la misère de la mort, sans musique et sans mots, sans aucun livre à ouvrir, sans aucun roman à commencer. Il y a désormais une date de fin pour Benoît. Une conclusion, une péremption, une démission, une interruption. Je ne veux pas le croire parce que c’est insupportable. Je ne peux pas le croire : parce que, tout simplement, c’est injuste et c’est idiot. La dernière fois, l’ultime fois où je le vis en vrai, c’était aux obsèques de Philippe Sollers. Lequel aurait dû lui déconseiller de le rejoindre aussi tôt. C’est un enfant qui est parti. Cet enfant était notre ami. Mon ami.
Son émission radiophonique du samedi matin s’intitulait « Étonnez-moi Benoît » (meilleure émission de France, de très loin). A toi, Benoît, je propose cette phrase de Léon Bloy parlant de ce qui t’attend maintenant : « Tu vas entrer dans un monde nouveau pour toi. Ne t’étonne de rien et ne tremble pas. »


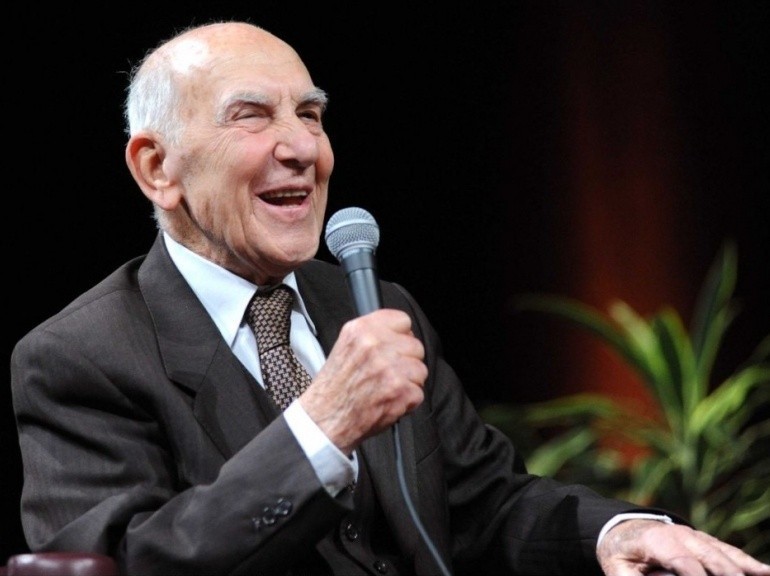




Bonjour,
Je n’ai jamais rien lu de Benoit Duteurtre. Par quel livre faut-il commencer ?
Cordialement,
Frank La Salvia.
Un auteur qu’on aimait beaucoup… Très bel hommage !
Tristesse, il va me manquer tous les samedis matin
Monsieur Yann Moix,
Votre hommage à l’ami puissant, Benoît Duteurtre
Avec mes remerciements,
Th. Arditti