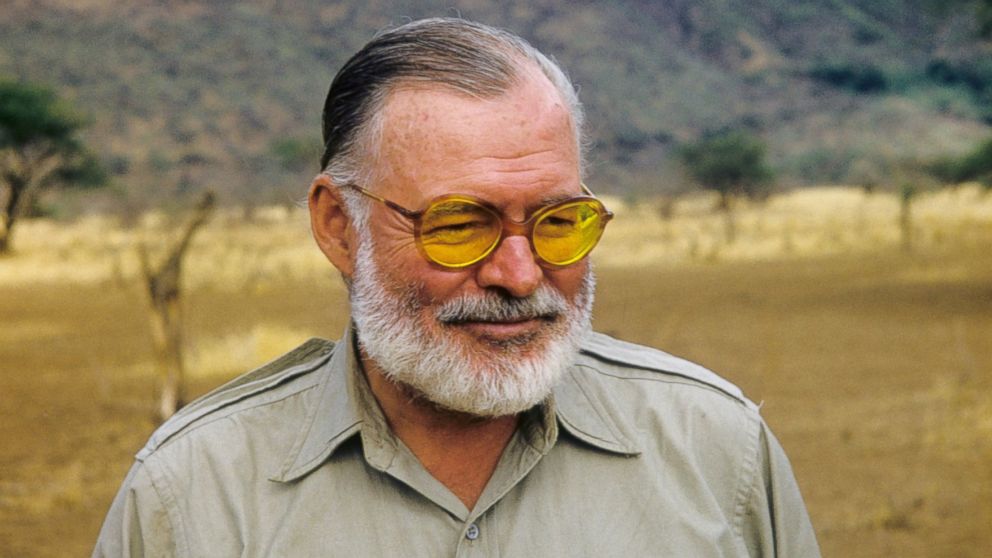C’était à Mascara, petite ville d’Oranie, un soir d’été de 1960.
L’Algérie était encore aux couleurs de la France. Plus pour longtemps, et l’épilogue serait sanglant. L’insurrection faisait rage, qui se conclurait d’ici deux ans par l’indépendance du pays aux mains du FLN et l’exode des Européens.
Ce soir-là, un jeune homme – Jean-Paul Enthoven, devenu soixante ans plus tard le narrateur de son enfance algérienne – assiste à l’inauguration du cinéma Vox qu’Edmond, son père tant admiré, un homme puissant et sûr de lui, a voulu, en dépit des « Événements », qu’il soit du dernier cri. Salle climatisée, sièges de velours grenat, ouvreuses permanentées, lustre à pampilles et fontaine de limonade dans le hall d’accueil, Come prima en fond d’ambiance, photos Harcourt des vedettes de cinéma aux murs. Pour cette opening night où se pressent les notabilités de Mascara, le maître des lieux a choisi Moby Dick, de John Huston, d’après le livre-culte de Melville, avec, dans le rôle du capitaine Achab à la poursuite de la fameuse baleine blanche, Grégory Peck, dont Edmond passe auprès des dames de Mascara pour avoir la même allure mélancolique.
Sauf que les jusqu’au-boutistes de l’Algérie française, les racistes, antisémites, anti « crouilles », les vociférateurs du Café Riche, leur QG en ville, tiennent Edmond, ami des Arabes, pour un traître, et inversent, entre deux rasades de pastis, Moby Dick en Maudits Biques, qu’ils lancent à la cantonade.
L’affront se répand comme une trainée de poudre dans le Souk des Arabes, la vengeance se prépare.
L’attentat au Vox le soir de l’ouverture, en pleine projection, fera cinq morts. Le carnage, vu par Jean-Paul Enthoven du balcon du Vox, est dantesque.
Éclaboussées de soleil noir, les deux dernières années de l’Algérie française seront à l’avenant, jusqu’au départ définitif de la famille de Jean-Paul en France.
Mitraillage sur les routes ; Mademoiselle, la professeure de piano de Jean-Paul Enthoven, assassinée dans un autocar ; fomenté par les sbires du Café Riche, attentat à l’explosif contre la maison familiale d’Edmond, qu’une bibliothèque en merisier et son rempart de livres sauvent de l’écroulement ; vignes et orangers de la propriété sciés en masse ; animaux de la ferme égorgés.
On pourrait penser que le jeune Jean-Paul vécut ces soubresauts macabres sur un mode traumatique, qu’il en resterait marqué à vie. Marqué certes – à preuve ces Confessions d’un voyeur solitaire – mais vivant ces épisodes comme un vivant repoussoir, comme l’occasion impérieuse d’un deuxième commencement.
Leur succession mortuaire, telle une tragédie antique, est pensée par Jean-Paul Enthoven comme autant de pas irrépressibles vers la délivrance, comme autant de pièces militant pour le divorce d’avec cette terre gorgée de sang, et surtout comme la promesse de l’apatriement prochain dans une France parée de tous les prestiges, où naître enfin une seconde fois, par les livres, l’écriture, les femmes aimées.
Né par mégarde une toute première fois au mauvais moment, au mauvais endroit, sous une mauvaise étoile, substitut d’un frère qu’il n’a pas connu, sur la tombe de qui, pélerinant chaque jour au cimetière avec sa mère inconsolée, y lisant, gravé en lettres d’or, son propre prénom comme s’il gisait là lui aussi, ou n’était que la réincarnation du disparu, Jean-Paul Enthoven va tôt trouver une parade fort subtile au désêtre et à la déréliction ambiante, la polir tout au long de sa vie. Il en a fait ici sa boussole. Elle consiste à partager le genre humain en deux. Il y a ceux qui naissent une fois pour toutes, restent vissés à leur origine, leur souche, leur enfance, leur généalogie, leur paradis perdu. Genre Le petit Prince, ou encore Le grand Meaulnes. Pitoyables exemples. (Mais direz-vous, n’en va-t-il pas ainsi de Proust ?) Et puis il y a ceux qui s’inventent, se construisent, font peau neuve, se recommencent, se nettoient du passé, l’exorcisent, se désinfectent.
Jean-Paul Enthoven, on s’en serait douté, est de ces derniers, et de très bonne sorte. De fait, notre born again, anti-pied noir conséquent, camusien modéré, est allé loin, il a conquis Paris, il est l’un des derniers dandies littéraires de la place, ou plutôt l’un des tous premiers, les Premiers Paris, aurait dit Balzac.
A preuve, s’il en était besoin, ce dialogue posthume entre Herman Melville (1819-1891) et Jean-Paul Enthoven (1949-) à propos de Moby Dick, de la gloire, de l’oubli et du reste, où cet éternel sceptique qu’est Jean-Paul Enthoven met bas les armes devant la grandeur désespérée de Melville.